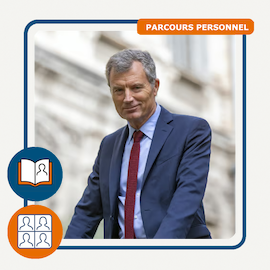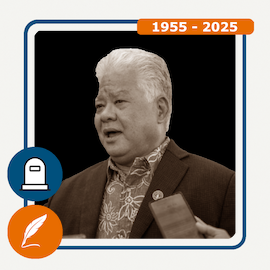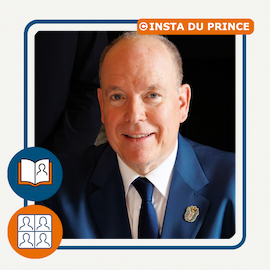HISTOIRE D UN JOUR - 31 JUILLET 1991
HISTOIRE D UN JOUR - 31 JUILLET 1991
START I : le grand tournant des arsenaux

Le 31 juillet 1991, à Moscou, la scène mondiale bascule. Ce jour-là, deux figures majeures du XXe siècle, George H.W. Bush, président des États-Unis, et Mikhaïl Gorbatchev, président de l’Union des républiques socialistes soviétiques, signent le traité START I (Strategic Arms Reduction Treaty). L’événement est solennel, presque irréel, tant il incarne la fin d’une ère, celle de la confrontation nucléaire totale entre les deux grandes puissances. Mais comprendre la portée de cet acte, c’est remonter le fil d’une histoire longue, marquée par la peur, la course aux armements, et l’usure progressive d’un système bipolaire.
En cet été 1991, le monde regarde Moscou avec attention, presque avec fébrilité. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’équilibre de la terreur a suspendu au-dessus des peuples l’ombre d’une apocalypse nucléaire. Les arsenaux accumulés, les têtes nucléaires pointées en permanence, les doctrines d’anéantissement mutuel, tout cela a façonné l’existence même des sociétés, jusque dans la culture, la psychologie collective, et la diplomatie internationale. L’acte de signature du traité START I vient donc rompre, ou du moins fissurer, le cycle infernal inauguré avec l’explosion de la première bombe atomique en 1945. Mais il faut s’attarder sur les logiques qui ont mené à ce sommet.
La Guerre froide, ce long affrontement sans affrontement direct, a généré une prolifération vertigineuse de l’armement nucléaire. Dès la fin des années 1940, la logique de surenchère s’impose. Chacune des deux superpuissances, États-Unis et URSS, cherche à dépasser l’autre en nombre d’ogives, en puissance de feu, en portée des missiles. Les années 1960 voient s’installer la doctrine de la « destruction mutuelle assurée ». L’escalade nucléaire devient presque absurde : les arsenaux sont alors capables de détruire la planète à maintes reprises. À chaque crise – blocus de Berlin, guerre de Corée, crise de Cuba – la menace atomique pèse comme une épée de Damoclès. Les populations vivent dans l’angoisse d’une frappe soudaine, d’un emballement incontrôlé.
Mais ce sont aussi les réalités économiques et sociales qui, peu à peu, entament la course. L’URSS s’essouffle sous le poids de l’effort militaire. Le modèle soviétique, usé, ne peut plus soutenir l’accumulation sans fin d’armes stratégiques. Les États-Unis eux-mêmes doivent arbitrer entre le financement de leur supériorité militaire et les exigences d’une société en mutation. La lassitude de la confrontation s’installe, dans une époque marquée par les mutations technologiques, la montée des aspirations individuelles, la circulation des idées.
Dans ce contexte, les premiers pourparlers sur la limitation des armements nucléaires s’amorcent dès la fin des années 1960. Les traités SALT (Strategic Arms Limitation Talks), signés dans les années 1970, posent les jalons d’un contrôle, certes limité, des arsenaux. Mais ils n’entraînent pas de diminution réelle. La décennie suivante, celle de la relance Reagan et de la montée de l’initiative de défense stratégique, voit une nouvelle poussée de la course aux armements. Pourtant, la logique de l’apaisement et la conscience du risque, chez certains dirigeants, s’imposent peu à peu.
L’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 marque un tournant. Porté par la volonté de réformer le système soviétique, Gorbatchev introduit la perestroïka (restructuration) et la glasnost (transparence). Mais il comprend aussi la nécessité de sortir de l’impasse militaro-industrielle. Les discussions s’intensifient avec l’administration Reagan puis Bush. Les sommets de Genève, Reykjavik, Washington, signent le retour au dialogue, malgré des tensions persistantes. On s’accorde sur des principes, on se confronte sur des chiffres, on cherche la voie d’un désarmement crédible.
C’est ainsi que naît l’idée d’un traité qui ne se contenterait plus de plafonner, mais imposerait de vraies réductions. START I sera ce traité. Négocié âprement pendant près d’une décennie, il prévoit une réduction de 25 à 30 % du nombre d’ogives nucléaires stratégiques, un contrôle mutuel rigoureux, des inspections sur site, et une transparence inédite. Au total, chaque partie doit ramener ses têtes nucléaires déployées à un maximum de 6 000, et ses vecteurs à 1 600, sur une période de sept ans.
La cérémonie de signature, le 31 juillet 1991, revêt une dimension à la fois politique et symbolique. Bush et Gorbatchev, côte à côte, incarnent la volonté de tourner une page. Pour la première fois, les deux principaux acteurs de la rivalité nucléaire s’engagent publiquement à réduire de façon significative leurs arsenaux. Le texte du traité est volumineux, précis, complexe dans ses modalités de vérification. Mais l’essentiel réside dans le geste : la volonté de réduire, de desserrer l’étau, de rendre au monde une part de sécurité.
La portée de l’événement ne se limite pas à la question des armes. START I marque une avancée majeure vers la fin de la Guerre froide, une ère qui, depuis 1947, a structuré l’ordre mondial, les alliances, les économies, les imaginaires. En 1991, l’URSS vit ses derniers mois. Gorbatchev, affaibli, voit l’Union vaciller sous les pressions nationalistes, économiques et politiques. Les États baltes proclament leur indépendance, les Républiques fédérées s’éloignent du centre, le Parti communiste est en crise profonde. Les putschs de l’été 1991, quelques semaines seulement après la signature du traité, illustrent la fragilité du pouvoir central. En décembre, l’URSS n’existe plus. Les engagements pris à Moscou sont alors repris par la Russie, héritière principale du traité, mais aussi par l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie, désormais dotés d’arsenaux sur leur sol.
Dans le camp occidental, la signature du traité est reçue comme un succès diplomatique et politique. Bush, héritier d’une Amérique triomphante, peut s’afficher comme l’artisan de la paix, le garant d’un monde plus sûr. Mais l’enthousiasme reste prudent. Si la menace d’une guerre nucléaire généralisée semble s’éloigner, la prolifération demeure, et d’autres puissances – la Chine, la France, le Royaume-Uni, bientôt l’Inde, le Pakistan – possèdent ou développeront l’arme atomique. START I n’est qu’une étape dans un processus incertain et jamais totalement achevé.
Au niveau international, l’impact du traité est profond. Il fixe une norme de coopération et de transparence, qui servira de modèle aux traités suivants, notamment START II et New START. Il encourage la mise en place de systèmes de vérification, d’échanges d’informations, de contacts réguliers entre militaires et inspecteurs. Il contribue aussi à désacraliser l’arme nucléaire, à montrer qu’elle peut être discutée, limitée, réduite. Mais il ne fait pas disparaître l’angoisse fondamentale qui accompagne la détention de ces armes par l’humanité.
Pour les sociétés civiles, le traité START I apparaît comme un soulagement. Dans les capitales européennes, on célèbre la réduction du risque, on espère l’ouverture d’une ère de paix. Mais la mémoire des décennies de tension, des alertes, des incidents, reste vive. Les mouvements pacifistes, qui ont tant œuvré pour le désarmement, rappellent la nécessité d’aller plus loin. La peur du feu nucléaire a marqué toute une génération, et l’annonce des réductions n’efface pas la crainte des menaces nouvelles, du terrorisme, de la prolifération non contrôlée.
Le traité START I s’inscrit aussi dans la transformation du monde d’après-Guerre froide. Il accompagne l’effacement de l’ordre bipolaire, l’émergence de puissances régionales, la circulation accrue des capitaux, des technologies et des modèles politiques. Les années 1990 voient le retour de conflits locaux, de tensions identitaires, mais aussi la montée d’une idée nouvelle : la sécurité globale, pensée non plus seulement en termes militaires, mais aussi économiques, écologiques, sanitaires. START I, en réduisant les arsenaux stratégiques, rend possible la réorientation de ressources, l’allègement de la tension, l’espoir d’un monde moins menacé.
Pourtant, l’histoire du désarmement reste une histoire inachevée. Après la signature, la mise en œuvre du traité rencontre des obstacles. Les inspections doivent s’adapter à la dissolution de l’URSS, à la multiplication des acteurs. L’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie accepteront finalement de transférer leurs armes vers la Russie, en échange de garanties de sécurité. Mais de nouveaux défis apparaissent : la modernisation des arsenaux, la persistance de la dissuasion, la tentation de la prolifération dans d’autres régions du globe. Les espoirs de désarmement total s’éloignent à mesure que les équilibres se déplacent.
Le 31 juillet 1991 restera, dans la mémoire des relations internationales, comme le moment d’un basculement. En signant le traité START I, Bush et Gorbatchev ont offert au monde une pause, une brèche dans le mur de la méfiance et de la peur. Ce n’est ni la fin de l’arme nucléaire, ni la disparition des rapports de force, mais le signal d’une possibilité : celle de maîtriser, de réduire, de penser autrement la puissance. Une page s’est tournée, mais d’autres restent à écrire, dans la longue marche vers une sécurité partagée, toujours incertaine, jamais tout à fait atteinte.