 PAKISTAN - ANNIVERSAIRE
PAKISTAN - ANNIVERSAIRE
Shehbaz Sharif, le pragmatique du Pendjab
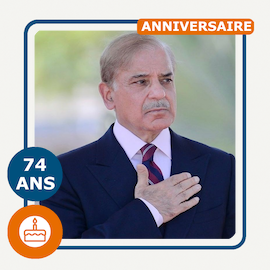
Shehbaz Sharif est né le 23 septembre 1951 à Lahore, au cœur du Pendjab, dans un Pakistan qui n’avait que quatre ans d’existence et qui cherchait encore ses repères après la partition du sous-continent indien. Il fête aujourd'hui ses 74 ans.
Sa naissance survient dans une famille de notables commerçants, les Sharif, dont les racines plongent dans une bourgeoisie industrieuse et conservatrice. Cette origine familiale est déterminante : elle le place au sein d’un milieu où la prospérité économique, la discipline religieuse et l’ambition politique s’entrecroisent.
Son enfance se déroule dans les ruelles encombrées de Lahore, ville alors marquée par l’empreinte coloniale britannique mais aussi par la vitalité d’un islam politique en plein essor. Ses premières années d’éducation se font dans les écoles de la ville, puis il poursuit des études supérieures au Government College University de Lahore, où il obtient un diplôme en littérature. Ce parcours académique l’ancre dans l’élite intellectuelle locale, même si son avenir se dessinera surtout dans les affaires puis en politique.
Le jeune Shehbaz n’est pas un enfant isolé. Il est le frère cadet de Nawaz Sharif, futur Premier ministre, et cette fraternité devient l’un des fils conducteurs de sa trajectoire. Ensemble, ils s’inscrivent dans la continuité familiale en s’investissant dans le développement industriel. Leur père, Muhammad Sharif, a fondé une entreprise sidérurgique, Ittefaq Group, qui devient un acteur majeur du secteur. Shehbaz prend place dans la direction de cette entreprise, apprenant très tôt les mécanismes de gestion, d’investissement et d’expansion. Cette immersion dans les affaires forge son goût pour la rigueur et l’efficacité, deux traits qu’il conservera dans sa carrière politique.
Son entrée dans la vie politique se fait au tournant des années 1980, une époque où le Pakistan vit sous la férule du général Zia-ul-Haq. Le pays est plongé dans une islamisation autoritaire, en même temps qu’il devient un terrain de manœuvres dans la guerre froide. C’est dans ce contexte que la famille Sharif s’oriente vers la politique, voyant dans l’alliance avec le pouvoir militaire un moyen de consolider son influence. Shehbaz suit la voie tracée par son frère Nawaz, et tous deux rejoignent la Ligue musulmane du Pakistan (PML), qui deviendra le PML-N après la scission menée par Nawaz.
Shehbaz est élu pour la première fois député à l’Assemblée provinciale du Pendjab en 1988. Ses talents d’organisateur et sa réputation de gestionnaire rigoureux lui ouvrent rapidement les portes du pouvoir provincial. En 1997, il devient ministre en chef du Pendjab, la province la plus peuplée et la plus riche du pays. Dès lors, son nom se confond avec l’histoire contemporaine de cette région. Il y applique une gouvernance marquée par la centralisation, l’autorité et la volonté de moderniser les infrastructures. Routes, écoles, hôpitaux : son empreinte se matérialise par une frénésie de projets. Sa méthode, parfois qualifiée d’autoritaire, repose sur une supervision étroite des administrations et une tolérance limitée pour la contestation.
Le coup d’État militaire de 1999, mené par le général Pervez Musharraf, interrompt brutalement cet élan. Shehbaz et son frère Nawaz sont contraints à l’exil en Arabie saoudite, terre d’accueil traditionnelle pour les dirigeants pakistanais destitués. Durant ces années d’exil, il observe à distance les évolutions de son pays, consolidant ses réseaux et attendant le moment de son retour. Celui-ci a lieu en 2007, lorsque le régime militaire s’affaiblit et que l’espace politique s’ouvre de nouveau.
De retour au Pakistan, Shehbaz reprend son rôle de chef du gouvernement provincial du Pendjab. Sa seconde période de gouvernance, de 2008 à 2018, s’impose comme la plus marquante. Il s’illustre par son obsession du développement, lançant des projets emblématiques comme le métro de Lahore et divers programmes d’électrification et d’éducation. Les partisans louent son efficacité et son énergie, allant jusqu’à le surnommer « Shehbaz Speed » pour sa rapidité à lancer et superviser les chantiers. Ses adversaires, en revanche, dénoncent son autoritarisme, son favoritisme envers certains cercles économiques et son incapacité à lutter contre la corruption endémique.
Lorsque son frère Nawaz est contraint de quitter le pouvoir en 2017 à la suite d’affaires judiciaires liées aux Panama Papers, Shehbaz se retrouve en première ligne. Il devient président de la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N) et se positionne comme l’héritier politique de son frère. Cependant, son style diffère. Là où Nawaz privilégie la confrontation avec l’armée, Shehbaz adopte une posture plus conciliante, cherchant le compromis avec les puissants généraux. Cette attitude lui vaut des critiques au sein même de son parti, mais elle contribue à sa survie politique dans un système dominé par l’institution militaire.
En avril 2022, dans un contexte de crise politique majeure et après la destitution d’Imran Khan par un vote de censure, Shehbaz Sharif devient Premier ministre du Pakistan. Ce moment est l’aboutissement d’un long parcours, mais il arrive dans un environnement marqué par l’instabilité. Son mandat s’ouvre sous le signe de la fragilité : économie en crise, inflation galopante, pressions du FMI, tensions avec l’Inde et montée des violences internes. Shehbaz tente de jouer le rôle d’administrateur pragmatique, mais son pouvoir reste limité par l’influence de l’armée et par les divisions politiques.
Son passage à la tête du gouvernement se distingue par une volonté de restaurer la crédibilité internationale du Pakistan. Il engage des négociations ardues avec les bailleurs de fonds, notamment le FMI, pour éviter la faillite financière du pays. Sur le plan intérieur, il s’efforce de maintenir une coalition fragile entre diverses formations politiques, une tâche rendue difficile par les rivalités anciennes et les ambitions personnelles. Sa gestion est critiquée comme hésitante, plus technocratique que visionnaire, et son gouvernement peine à enrayer les difficultés structurelles du pays.
En 2023, il organise les élections législatives qui débouchent sur une recomposition partielle du paysage politique. Face à l’élan populiste d’Imran Khan et à l’usure de son propre parti, Shehbaz joue la carte de la continuité et du compromis. Ses partisans mettent en avant son expérience et son sens de la gestion, tandis que ses opposants dénoncent une soumission aux militaires et une incapacité à proposer un projet mobilisateur.
La personnalité de Shehbaz Sharif apparaît comme un mélange de technocratie et d’autoritarisme. Son style direct, parfois brutal, l’a souvent fait comparer à un chef d’entreprise davantage qu’à un politicien classique. Son obsession pour la rapidité et l’efficacité l’a rendu populaire auprès d’une partie de la population du Pendjab, mais elle a aussi nourri des accusations de gestion clanique et centralisée. Sa relation complexe avec l’armée reflète la difficulté de tout dirigeant civil pakistanais à s’imposer durablement dans un système où le pouvoir militaire reste prépondérant.
À l’échelle de l’histoire longue, Shehbaz Sharif incarne le destin d’une élite issue des affaires, transformée en dynastie politique. Son parcours illustre la fusion entre capital économique et pouvoir politique dans un pays où les lignées familiales dominent la vie publique. Son autorité sur le Pendjab a façonné une grande partie du développement de cette province et a contribué à faire de Lahore un symbole de modernisation. Mais son action au niveau national révèle aussi les limites de ce modèle : efficacité locale, impuissance face aux grands équilibres géopolitiques et aux crises structurelles.
Aujourd’hui encore, Shehbaz Sharif demeure une figure incontournable du Pakistan contemporain. Ni véritablement aimé comme un leader charismatique, ni totalement rejeté comme un tyran, il se situe dans cet entre-deux où l’autorité se mêle au pragmatisme. Son héritage se dessine dans les infrastructures du Pendjab, dans la consolidation du PML-N et dans la démonstration des contraintes pesant sur tout Premier ministre pakistanais. Son histoire, entamée en 1951 dans une Lahore encore marquée par la partition, reste celle d’un homme qui a cherché à incarner l’ordre et la gestion dans un pays traversé par le tumulte des passions politiques et militaires.

