 ISLANDE - ANNIVERSAIRE
ISLANDE - ANNIVERSAIRE
Halla Tómasdóttir, de Reykjavik à Bessastadir
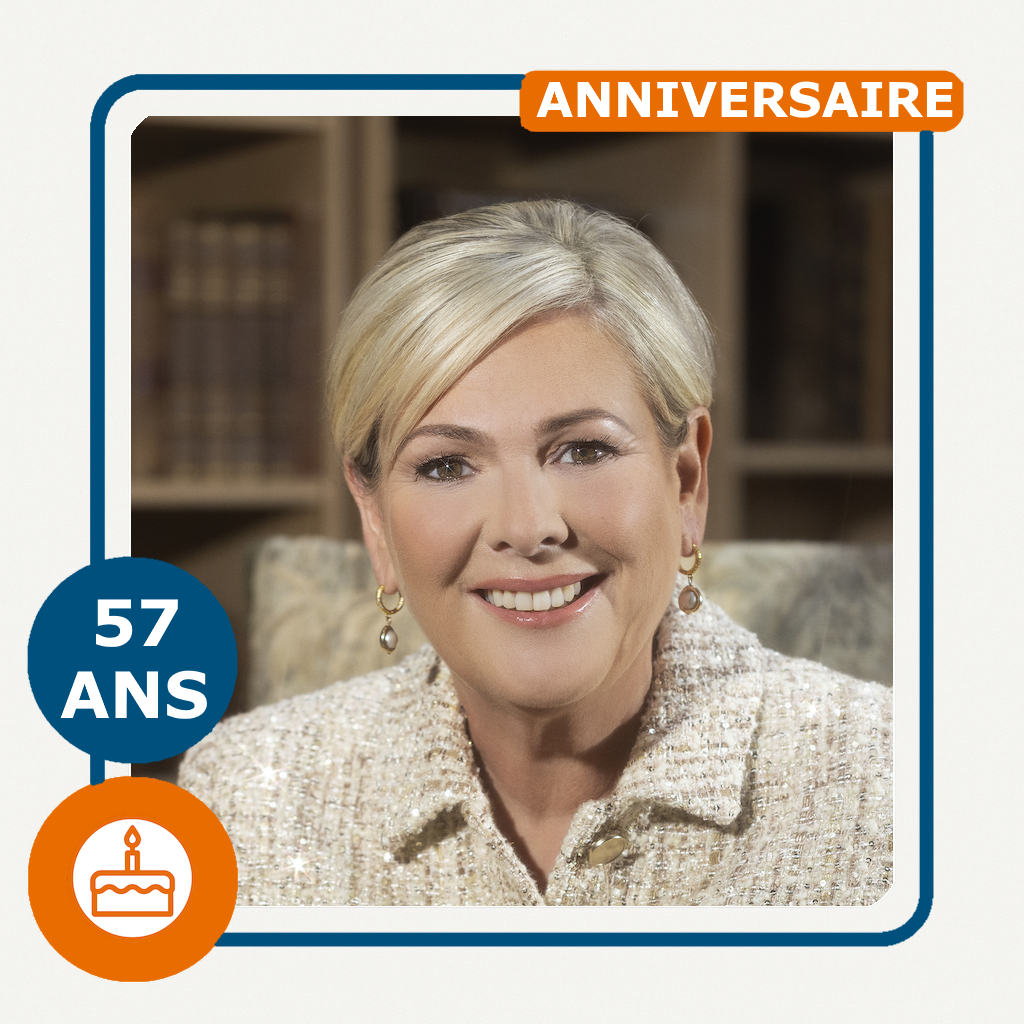
Née le 11 octobre 1968 à Reykjavik, Halla Tómasdóttir grandit dans une Islande de vents et d’entraide, où la modestie des moyens fait des vertus civiques des habitudes quotidiennes. Elle célèbre aujourd'hui ses 57 ans.
Sa mère, Kristjana Sigurðardóttir, éducatrice spécialisée, exerce un métier de patience et de pragmatisme. Son père, Tómas Björn Þórhallsson, maître plombier disparu en 2008, transmet la rectitude simple des artisans et une idée exigeante de la responsabilité individuelle. L’enfance se déroule entre école publique, sports, bibliothèques et travaux partagés, dans un pays où la mer fixe la mesure des jours et où les communautés locales apprennent à résoudre plus qu’à attendre. Ces années posent une base : la confiance se mérite et la liberté suppose la prévoyance.
Très tôt, l’ouverture au monde s’impose comme une évidence. Après le Collège commercial d’Islande, Halla traverse l’Atlantique. Elle obtient à Auburn University at Montgomery un diplôme en études commerciales, orienté vers la gestion et les ressources humaines, puis, en 1995, un MBA à la Thunderbird School of Global Management. Ce parcours, banal pour les étudiants américains mais encore rare pour des Islandais de sa génération, lui donne une méthode et une langue : tableaux, indicateurs, processus, goût de l’évaluation et de l’amélioration continue. Elle apprend à tenir ensemble ambitions et limites, à lire les chiffres sans leur confier le monopole du réel.
La première décennie de carrière se déroule en entreprise. Dans les ressources humaines et le développement organisationnel, elle travaille chez M&M/Mars puis chez Pepsi Cola. Elle y apprend la mécanique des grandes firmes, l’art discret des organisations et la discipline de l’exécution. À la différence des trajectoires qui s’enivrent d’ascension, la sienne reste attentive aux systèmes et à ceux qui les font tenir. Revenue en Islande à la fin des années 1990, elle devient directrice des ressources humaines de la radio?télévision publique, où la précision des procédures soutient la mission d’un service destiné à tous.
L’Université de Reykjavik lui offre alors un terrain d’expérimentation. Membre de l’équipe fondatrice en 1999, elle crée et dirige l’Executive and Continuing Education, développe un programme d’autonomisation et d’entrepreneuriat féminin, enseigne l’organisation, la conduite du changement et l’esprit d’entreprise. Dans une société petite et instruite, l’université devient plus qu’un lieu de savoir : un atelier de compétences partagées. Elle accueille des adultes en reconversion, des cadres qui reprennent souffle, des entrepreneurs qui ajustent leurs outils. La formation tout au long de la vie se transforme en politique implicite de nation.
En 2006, Halla devient la première femme directrice générale de la Chambre de commerce d’Islande. Le symbole est fort mais le contexte se détériore. L’endettement extérieur enfle, les banques grossissent au?delà de leur profondeur domestique et les illusions d’enrichissement rapide masquent la fragilité. En 2007, elle quitte la Chambre pour co?fonder, avec Kristín Pétursdóttir, Auður Capital. Le pari n’est pas moraliste, il est technique : remettre de la prudence, de la transparence, de l’horizon long et du respect du risque dans une finance qui s’emballe. L’idée d’« investir avec des principes » détonne avant de paraître simplement raisonnable.
L’effondrement de 2008 offre une preuve par le réel. Auður Capital traverse la tempête sans pertes sur les fonds de ses clients et sans renier ses principes. L’expérience attire l’attention et conduit à un fonds de capital?risque lancé avec la musicienne Björk, destiné à des entreprises ancrées dans les ressources humaines et naturelles de l’île. Dans la foulée, Halla participe à Mauraþúfan, l’Anthill, collectif qui organise en 2009 une Assemblée nationale rassemblant un échantillon de citoyens tirés au sort pour discuter des valeurs et des orientations du pays après l’effondrement. Le pays, soudain, réapprend à parler de finalités et pas seulement d’outils.
Cette séquence nourrit une idée simple : la confiance est lente et politique. Elle se cultive dans les institutions comme dans les marchés. Aussi, quand elle se présente à la présidence en 2016, Halla s’appuie sur cette grammaire. Campagne sobre, explications patientes, écoute des objections : elle arrive deuxième, autour de 28 pour cent des voix, derrière Guðni Th. Jóhannesson. Ce résultat, pour une candidature sans parti, installe durablement son nom dans la conversation nationale et fixe un style : dédramatiser, décoder, relier.
De 2018 à 2024, elle dirige The B Team, coalition internationale de dirigeantes et dirigeants d’entreprise et d’acteurs civiques, dédiée à une économie responsable. De New York à Reykjavik, elle travaille sur la transparence fiscale, les droits humains dans les chaînes de valeur, la prise en compte du climat dans l’investissement et la gouvernance. Ce rôle international lui apprend la diplomatie des coalitions : l’art de relier des intérêts parfois divergents autour d’objectifs précis et mesurables, et de préférer des engagements vérifiables aux proclamations.
L’élection présidentielle de 2024 ouvre une fenêtre. Le président sortant renonce à se représenter, l’ancienne première ministre Katrín Jakobsdóttir entre en lice, et un nombre inédit de candidats se déclarent. Halla présente une plate?forme qui s’articule autour de trois sujets ancrés dans le présent : l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, la maîtrise d’un tourisme devenu massif sur un territoire fragile, et la lucidité face aux promesses et aux risques de l’intelligence artificielle. Elle propose non des remèdes miracles mais une méthode : identification des problèmes, dialogue avec les professionnels, expérimentation, évaluation.
Elle l’emporte avec environ un tiers des voix et prend ses fonctions le 1er août 2024. La fonction islandaise, peu dotée en pouvoirs exécutifs, pèse par sa capacité de rassemblement, par l’usage réfléchi du droit de veto et par la parole publique. Dès les premières semaines, les éruptions de la péninsule de Reykjanes rappellent que l’agenda national se règle souvent sur la géologie. La présidente veille à la cohérence des messages, à l’alignement entre experts, municipalités et services de secours, et à la reconnaissance du travail discret qui permet à un pays de continuer de tourner pendant la menace.
La diplomatie nordique donne la profondeur de champ. Les visites d’État au Danemark, en Norvège puis en Suède ne sont pas que cérémoniales. Elles réaffirment une communauté de pratiques autour de l’État social, de la compétitivité par l’innovation, des droits égaux et de la sécurité collective. Elles confirment aussi un style de représentation : gravité sans emphase, sobriété des mots, attention aux signes. À l’intérieur, la présidente cultive un rapport précis aux institutions, reçoit les partis, veille à la continuité et à la stabilité symbolique du cadre commun.
La vie privée n’est pas un décor. Halla Tómasdóttir partage sa vie avec Björn Skúlason, chef et entrepreneur de l’alimentation nordique ; ils ont deux enfants, Auður Ína et Tómas Bjartur. La famille a connu les allers?retours avec les États?Unis, les inscriptions universitaires, la logistique des déménagements et les reconstructions de routines. Ces expériences nourrissent une hygiène de vie qui place la santé, la marche, l’alimentation et le sommeil au service de l’endurance. Dans un pays où l’on se croise souvent, cette simplicité protège la fonction et maintient la distance utile.
Si l’on cherche la cohérence, on la trouve dans une éthique opératoire. L’éducation tout au long de la vie, initiée à l’université, se poursuit au sommet de l’État par la pédagogie des décisions expliquées. La finance de principe, promue chez Auður, devient une manière de parler de l’économie réelle sans la flatter ni la blâmer. La délibération citoyenne, expérimentée à l’Anthill, se traduit par une écoute active et par une attention aux mots, à leur poids et à leurs effets. La présidence n’invente pas des politiques publiques ; elle en garantit la lisibilité, la cohérence et, parfois, la limite.
Cette histoire appartient aussi à une génération. Des Islandais nés à la fin des années 1960 et au début des années 1970 ont étudié, travaillé et vécu à l’étranger avant de revenir. Ils ont rapporté des méthodes, des réseaux et une habitude de la comparaison. Halla en est l’une des figures. Elle incarne une élite qui n’oppose pas centre et périphérie, qui lit les rapports d’audit, qui comprend les talents des petites équipes, et qui sait que l’autorité vient de la compétence, du service et de la décence.
Le pays, lui, continue de se transformer. La pression du tourisme impose de nouvelles infrastructures et des règles d’accès plus fines ; la transition énergétique croise la géothermie, l’hydroélectricité, l’hydrogène et les usages industriels ; la diversification loin des cycles de l’aluminium et des pêches reste un impératif ; l’intelligence artificielle questionne la productivité, l’école et les médias ; les éruptions imposent des priorités de court terme et des reconstructions patientes. La présidence, à distance des arbitrages, peut contribuer par la clarté, la constance et l’encouragement à la coopération.
Il ne s’agit pas d’ériger une statue mais de décrire une dynamique. L’enfance, la formation, l’entreprise, l’université, la finance, la scène civique et la magistrature composent un continuum. Chacune de ces étapes a déplacé la frontière entre ambition personnelle et bien commun. Chacune a rappelé que l’éthique n’est pas un supplément d’âme mais une technique de prévention des erreurs graves. Chacune, enfin, a installé l’idée que la politique réussit quand elle prend au sérieux la lenteur nécessaire des apprentissages collectifs.
À l’échelle du temps long, tout converge. Une enfant de Reykjavik, née en 1968, a pris en 2024 la charge d’une présidence de lien et de vigilance. Sa biographie raconte une île qui s’est modernisée sans renoncer à la simplicité, un capitalisme qui cherche ses garde?fous, une démocratie qui privilégie la discussion à voix basse. Rien ne garantit l’absence d’accidents, mais une méthode se dessine : regarder loin, parler net, protéger les conditions de la confiance, préférer la preuve à l’effet. Dans une époque bruyante, cette retenue peut paraître timide ; elle est souvent efficace.
Dans la symbolique des États, les signes comptent aussi. La prise de fonctions à Bessastadir s’est accompagnée d’honneurs traditionnels, islandais et nordiques, qui disent l’ancrage d’un pays dans sa région. Mais la reconnaissance la plus décisive reste intérieure : elle tient à la stabilité des attentes, à l’exigence d’exemplarité, à la capacité de parler clair lors des crises et d’écouter dans l’ordinaire. Ce capital patient, difficile à acquérir, peut se perdre vite ; il se cultive jour après jour avec constance. C’est un cap.
