 FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
Alphonse de Lamartine, un poète face aux temps longs
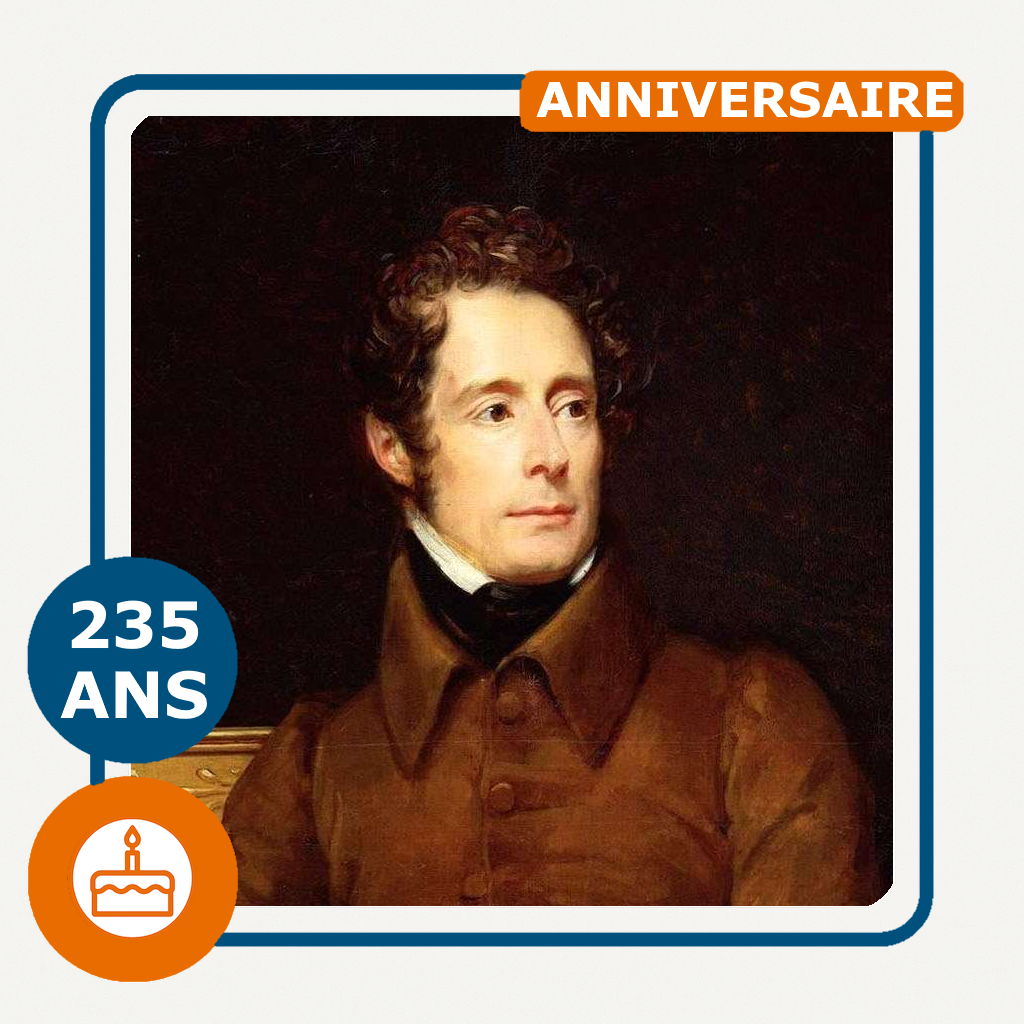
Né le 21 octobre 1790 à Mâcon, Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine naît dans une France qui sort à peine des secousses révolutionnaires et entre dans les recompositions de l’Empire. Nous célébrons aujourd'hui le 235ème anniversaire de sa naissance.
Sa famille, petite noblesse provinciale enracinée en Bourgogne, lui offre un monde où la religion, les saisons, les vignobles et les mémoires familiales dessinent une première géographie du temps. Entre Milly et Saint-Point, l’enfant apprend la régularité des jours, la liturgie domestique, le poids des traditions et la promesse d’une modernité encore lointaine. Les lectures, nombreuses et précoces, creusent un espace intérieur où s’assemblent les récits de l’Antiquité, la poésie française et les grands auteurs italiens. Dans cette enfance à la fois protégée et traversée par les échos du siècle, se forme un regard de longue durée sur la France des terroirs, sur l’économie silencieuse des paysages, sur la continuité des mœurs que les régimes ne parviennent jamais à effacer totalement.
La jeunesse s’ouvre par la découverte de l’Italie. Henrissant son goût des arts, Lamartine y perçoit un autre rythme du temps, plus monumental, plus méditatif, où les villes et les ruines enseignent la profondeur des siècles. En 1816, la rencontre avec Julie Charles, sur les bords du lac du Bourget, imprime la matrice d’une vie poétique : l’amour menacé, la maladie, la perte, puis la métamorphose de la douleur en chant. De cette expérience intime naît un rapport singulier à l’histoire : le passé n’est pas seulement ce qui s’éloigne, il est une ressource active pour dire l’espérance et gouverner les émotions. Lorsque paraissent en 1820 les Méditations poétiques, la France reconnaît une voix nouvelle, où l’aveu du sujet ne se confond pas avec le narcissisme et où la prière devient souffle profane. Le public, saisi, offre à Lamartine un succès immédiat qui le fait entrer dans les salons et l’expose à la sociabilité politique du temps. La même année, à Chambéry, il épouse Mary Ann Elisa Birch, artiste d’origine britannique que l’on appellera Marianne. Le couple, soudé par une curiosité esthétique commune, s’installe entre Paris et le Mâconnais. Deux enfants naissent ; le fils meurt en bas âge, puis Julia, leur fille, s’éteint à Beyrouth en 1832. Ce deuil, au cœur d’un voyage en Orient, marque à jamais l’écriture du poète, et imprime à sa prose un ton de méditation grave.
Avant le tribun, il y a le diplomate. Lamartine sert en Italie, observe la délicate mécanique des cours, les impatiences nationales et les compromis de l’ordre continental. Il voit de près combien l’Europe hésite entre restauration et réformes. Parallèlement, l’écrivain déploie son œuvre : Harmonies poétiques et religieuses élargissent le souffle des Méditations, tandis que Voyage en Orient (1835) ouvre un champ où la description du monde devient examen moral. L’Académie française l’accueille en 1829 ; la Légion d’honneur souligne la place désormais publique du poète. Mais c’est à Saint-Point que s’ordonne l’existence : le château, aménagé, devient atelier, refuge, maison d’hospitalité intellectuelle, et bientôt lieu de sépulture désiré, signe d’une fidélité aux siens et au sol.
Sous la Monarchie de Juillet commence la seconde vie, politique. Élu député à partir de 1833, d’abord dans le Nord, puis le plus souvent pour Mâcon, Lamartine se tient à distance des factions, mais plaide la dignité des humbles, l’instruction populaire, la liberté de la presse et la réforme graduelle. Conseiller général, président du Conseil général de Saône-et-Loire à plusieurs reprises, maire de Milly, il pense que la France se gouverne aussi depuis ses provinces, par la lente épaisseur des institutions locales : écoles, routes, travaux utiles, arbitrages concrets. En 1847, son Histoire des Girondins relit 1793 et ses promesses inabouties ; l’ouvrage, largement diffusé, saisit l’opinion et réactive un imaginaire républicain tempéré, attaché à la loi, à la fraternité et à l’éducation. C’est déjà une politique par l’histoire : Lamartine s’y exerce à convertir les passions en récit pour rendre possible la réforme.
Puis 1848 déchire le voile. Les journées de février font chuter Louis-Philippe, et la Deuxième République s’esquisse dans l’urgence. Lamartine entre au gouvernement provisoire comme ministre des Affaires étrangères et, de fait, figure directrice. Le 25 février, sur les marches de l’Hôtel de Ville, il refuse le drapeau rouge au nom d’une continuité nationale : la République choisira le tricolore, héritage de la Révolution et signe d’unité. Le geste, plus qu’un symbole, traduit une méthode : attacher l’ordre à la liberté, tenir ensemble le peuple et la nation, ouvrir la République au plus grand nombre sans la livrer à la vengeance sociale. Dans ces semaines brèves, la France proclame des libertés, abolit la peine de mort pour les délits politiques, inscrit le suffrage universel masculin, et s’oriente vers l’abolition de l’esclavage dans les colonies. La politique se fait ici pédagogie : expliquer, convaincre, pacifier, puis décider. Lamartine parle longuement, écrit sans relâche, reçoit, arbitre. Il tente d’éviter la guerre extérieure et d’apprivoiser les colères intérieures.
Mais la République est une épreuve. La misère ouvrière et les ateliers nationaux divisent, la peur de la guerre civile grandit, l’insurrection de juin ensanglante Paris et ferme un cycle d’illusions. À l’élection présidentielle de décembre 1848, Lamartine porte l’idée d’une République sociale, éducationniste et légaliste. Le suffrage universel se porte ailleurs ; Louis-Napoléon Bonaparte l’emporte, signe que le pays recherche protection et clarté plutôt que nuances. Le poète-ministre, un temps auréolé, s’éloigne des premiers plans. Représentant du peuple, il siégera encore, mais la scène change et sa voix porte moins face à la poussée césarienne et au retour d’un ordre autoritaire.
Commence alors le temps des livres et des comptes. À Saint-Point, Lamartine écrit pour vivre. Romans, poèmes, souvenirs, vastes fresques historiques se succèdent, à un rythme que commandent autant les dettes que l’exigence de coherence intime. La maison devient un atelier permanent où Marianne, peintre et sculptrice, veille aux dépenses, organise l’accueil, entretient les correspondances. Leur nièce, Valentine de Cessiat, se fait archiviste des jours, gardienne des papiers et médiatrice attentive. Les deuils resserrent encore le cercle : la mort de Marianne en 1863 plonge Lamartine dans une vieillesse laborieuse, faite de relectures, de dictées, d’arrangements avec les éditeurs, de promenades lentes dans le parc. Le monde continue sans lui atourner ses décisions ; lui, poursuit l’effort de mémoire, tente de donner sens au siècle qu’il a traversé.
L’homme public n’a jamais séparé poésie et politique. Chez lui, gouverner suppose une anthropologie : on administre des hommes, donc des imaginaires, des souvenirs, des impatiences. D’où l’importance qu’il accorde à l’école, à la presse, aux symboles. La nation, pour durer, a besoin d’un langage commun ; il faut donc travailler la langue, non pour la figer, mais pour la rendre habitable à chacun. Ainsi s’éclaire l’unité d’une œuvre où le lyrisme ne s’oppose pas à la loi : les Méditations, les Harmonies, les récits d’Orient, les histoires de la Révolution forment un seul chantier, celui de la pacification des âmes par la parole juste. Sa religiosité évolue, du catholicisme fervent de l’enfance à une spiritualité large, où l’on cherche Dieu dans l’ordre du monde et la fraternité, sans renier l’Église ni idolâtrer la politique. Cette métaphysique modérée nourrit Jocelyn et La Chute d’un ange, grandes épopées de conscience, et traverse ses discours, où la morale n’est jamais coupée des conditions matérielles de l’existence.
Reste le poète. Si Hugo occupe la tribune et la scène, Lamartine demeure le maître d’une musique intérieure qui a modifié la diction française. Le « je » qu’il invente n’est ni caprice ni plainte ; c’est une chambre d’échos où le paysage, l’histoire et la prière entrent en résonance. Les lacs, les routes d’Italie, les rivages d’Orient, les vignes du Mâconnais forment l’atelier d’une géographie sensible qui donne aux Français des mots pour habiter le temps. Loin d’un retrait égotiste, c’est une politique de la langue : établir entre les individus un régime d’attention, de pudeur et de fraternité. Par là, Lamartine accompagne la modernité française non en agitateur d’images, mais en ordonnateur de rythmes.
Le 28 février 1869, il meurt à Paris. Sa dépouille est menée à Saint-Point, selon son vœu : il ne voulait pas « dormir sous l’herbe sordide du Père-Lachaise ». Dans le caveau familial, près de l’église romane, il rejoint sa mère, sa femme, sa fille. Le cortège, nombreux, dit moins l’actualité d’une gloire que la fidélité d’un territoire à l’un des siens. La tombe, simple, renvoie au château, devenu lieu de mémoire autant que demeure ; les visiteurs y lisent les traces d’une vie tenue par des exigences qui ne se démodent pas : dignité, travail, mesure.
Que reste-t-il ? Un double héritage, inséparable. L’œuvre poétique a offert aux Français une éducation sentimentale qui n’ôte rien à leur raison ; elle a su convertir la douleur en style et l’espérance en discipline. L’action publique, brève au sommet mais constante dans la durée, a proposé une République sans fureur, amie de l’école et des symboles, prudente avec l’économie, exigeante avec l’État, confiante dans les communes. Le personnage, enfin, a incarné la France des provinces lorsqu’elle entre en politique : un pays de bourgs et de vignes, de petites villes laborieuses, de châteaux modestes et d’églises romanes, capable d’envoyer à Paris non seulement des colères mais des projets.
Ainsi se clôt la trajectoire d’Alphonse de Lamartine, né à Mâcon en 1790, poète devenu acteur puis témoin d’un siècle inquiet. De l’intimité blessée aux vastes scènes, du vers à l’édit, il aura poursuivi une même cohérence : donner forme au temps, par la langue et par la loi. Loin d’un destin d’inflexible vainqueur, c’est l’histoire d’un homme qui cherche la mesure juste, entre la fidélité aux lieux et l’ouverture au monde, entre la mémoire des morts et la responsabilité des vivants, entre le symbole qui unit et l’institution qui dure. Dans la longue durée, sa défaite électorale et ses dettes n’effacent pas son apport : il a appris à la France que la liberté ne se tient qu’en société, que les drapeaux ne valent que par les consciences, et que la poésie, lorsqu’elle soigne les âmes, peut préparer les lois.
