 ISRAEL - ANNIVERSAIRE
ISRAEL - ANNIVERSAIRE
Benjamin Netanyahou, après Gaza le temps du jugement
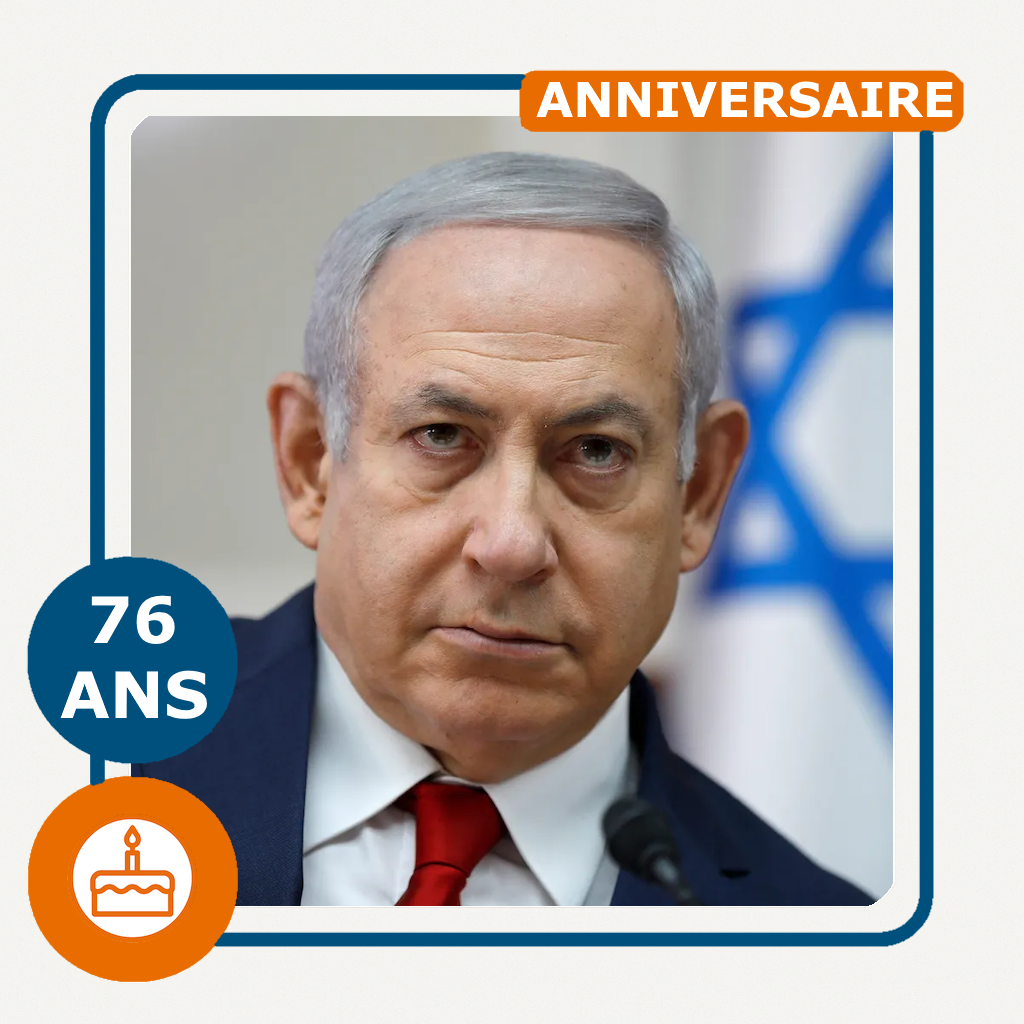
21 octobre 1949, Tel-Aviv. Benjamin Netanyahou naît dans un foyer où la conscience historique est un héritage quotidien. Il fête aujourd'hui ses 76 ans.
Son père, Benzion, historien du judaïsme médiéval, lui raconte un temps juif scandé par les ruptures et la persistance. Sa mère, Tsila, donne la mesure du réel. Très tôt, la famille partage sa vie entre Israël et les États-Unis. L’enfant apprend à circuler, à changer d’école, à passer d’une langue à l’autre. Il assimile deux syntaxes, celle du sabra formé par l’insécurité régionale et celle de l’Amérique des campus. À l’adolescence, la discipline des lycées israéliens se mêle à l’ouverture des banlieues américaines ; ce double ancrage structure son rapport au monde, entre réflexe de forteresse et méthode d’ingénieur.
Vient le temps des armes. Comme beaucoup de sa génération, il sert dans une unité d’élite et apprend la patience tactique, la coordination, la gestion de l’incertitude. La mort au combat de son frère aîné, Yonatan, héroïsée par l’État, inscrit le deuil dans son identité publique. Cette marque intime nourrit un ethos de fermeté et une conviction durable que la force conditionne la survie. Au sortir des armes, il file à Boston et s’immerge dans l’université. Au MIT et à Harvard, il fréquente l’architecture, la gestion, les matrices de décision. Il découvre la scène intellectuelle américaine, ses think tanks et ses colloques, l’art de la note stratégique. Ces années l’outillent : parler deux langues politiques, celle, franche, du risque existentiel, et celle, rationnelle, du calcul coût-bénéfice. S’annonce déjà l’homme de télévision, concis, binaire, efficace.
Sa vie privée s’imbrique à cette ascension. Trois mariages, trois enfants, une famille exposée à l’attention médiatique. Avec Sara, sa compagne depuis la fin des années 1980, il forme un duo soudé qui accepte la confrontation. L’intime se confond avec l’adresse du pouvoir ; les appartements officiels deviennent citadelle et la citadelle un style. Les fidèles s’agrègent, les critiques persistent. Au fil des ans, des affaires judiciaires frôlent ou traversent le cercle domestique, accentuant le réflexe d’encerclement. Dans ce huis clos, l’homme politique forge une méthode de défense : contre-attaquer, délégitimer l’accusateur, saturer l’espace public.
Le professionnel précède puis absorbe le politique. Dans les années 1980, représentant d’Israël à l’ONU, il apprend la grammaire des votes, la mécanique des coalitions, le poids du mot calibré. Il perfectionne l’art de la caméra. De retour à Jérusalem, il devient député, puis en 1996 le plus jeune chef de gouvernement de l’histoire du pays. Le premier mandat est heurté, pris dans l’usure d’Oslo finissant et l’entropie des coalitions. Viennent ensuite des années de ministère, dont les Finances au début des années 2000 : libéralisation vigoureuse, privatisations, discipline budgétaire. La thérapie de choc polarise, mais elle consolide le socle entrepreneurial et prépare l’essor de la tech. À partir de 2009, il reprend durablement la tête du gouvernement. Son récit tient en trois axes : l’obsession iranienne qui structure sa diplomatie et son lien privilégié à Washington ; l’économie d’innovation, qui fait de Tel-Aviv une place de capital-risque ; la normalisation régionale, couronnée par des rapprochements avec plusieurs capitales arabes. Sur ce socle, il gagne du temps, use ses rivaux, et transforme la durée en ressource.
Parallèlement s’ouvre un chapitre judiciaire. Enquêtes puis procès pour corruption, fraude et abus de confiance. Netanyahou nie, dénonce une entreprise politico-médiatique visant à l’abattre. Le procès devient climat. Au terme des élections répétées de 2019 à 2022, il revient au pouvoir avec une coalition plus à droite et plus religieuse. Dès janvier 2023, une réforme judiciaire est lancée pour réduire l’emprise de la Cour suprême et remodeler les contre-pouvoirs. Le pays se cabre. D’immenses manifestations hebdomadaires rassemblent des centaines de milliers de personnes, les réservistes menacent de ne plus se présenter, l’économie s’inquiète. L’exécutif fait passer une première loi limitant la « raisonnabilité » du contrôle juridictionnel, mais l’onde de choc entame la cohésion nationale et installe l’idée d’un illibéralisme israélien en gestation.
Le 7 octobre 2023 déplace brutalement l’axe du temps. L’attaque venue de Gaza frappe des localités civiles, tue massivement et enlève des centaines d’otages. Le traumatisme est abyssal. La riposte est immédiate et totale. Bombardements, siège, incursions terrestres successives, opérations urbaines dans des zones densément peuplées : l’objectif affiché est la destruction du Hamas et la restauration de la dissuasion. Sur le terrain, l’enclave s’effondre ; des quartiers sont nivelés, des hôpitaux hors d’usage, l’aide humanitaire longuement entravée, la population déplacée en cycles répétés. La guerre devient une géographie de la faim et de la peur. Le pouvoir affirme frapper des objectifs militaires et impute au Hamas la responsabilité de l’exposition des civils ; la réalité statistique montre une mortalité de masse et un tissu social pulvérisé. Le drame des otages, fil noir du conflit, fracture l’agenda politique intérieur.
Cette conduite de la guerre ouvre un cycle de condamnations internationales rarement égalé. L’Assemblée générale des Nations unies adopte des résolutions exigeant trêve, puis cessez-le-feu, insistant sur l’accès humanitaire et la libération des otages. La Cour internationale de Justice ordonne des mesures conservatoires, intime à Israël de prévenir les actes visés par la convention sur le génocide, de laisser entrer l’aide, et, au printemps 2024, de cesser l’offensive sur Rafah. Le parquet de la Cour pénale internationale dépose des requêtes de mandats d’arrêt visant des dirigeants du Hamas et les plus hauts responsables politiques israéliens ; des juges délivrent des mandats, que le gouvernement conteste sans les faire annuler. Des rapports d’organisations de défense des droits documentent les attaques contre des infrastructures civiles et le nombre inédit d’humanitaires tués. Des alliés traditionnels se disent « préoccupés », puis « opposés », certains reconnaissent l’État palestinien, d’autres restreignent des livraisons militaires ou conditionnent l’aide. La dérive gouvernementale contre Gaza prend ainsi une dimension normative : elle isole Israël et son chef sur la scène du droit.
À l’intérieur, la coalition tient par des fils. Des partenaires ultranationalistes exigent une main plus lourde, s’opposent à des échanges de prisonniers jugés excessifs, visitent l’esplanade des Mosquées et revendiquent la primauté de la souveraineté israélienne « du fleuve à la mer ». Le cabinet de guerre improvise des pauses, relance les opérations, accepte puis suspend des convois d’aide. Les familles d’otages imposent leur cadence morale, saturent l’espace public d’une interpellation simple : ramenez-les. Netanyahou gouverne entre injonctions contradictoires, arbitrant au plus court, préservant la coalition, misant sur la lassitude et l’oubli. La victoire totale promise recule à mesure que l’enclave s’enfonce dans l’irréparable. L’armée alerte sur les limites de l’outil militaire face à une organisation disséminée et souterraine ; la stratégie politique demeure lacunaire.
La dérive s’observe techniquement. L’exception devient pratique ordinaire : listes mouvantes de zones supposées sûres, ordres d’évacuation sans solution, reconductions de sièges, destructions préventives d’îlots urbains. La logique punitive s’entremêle à la finalité militaire. Les journalistes locaux paient un tribut massif, les humanitaires comptent leurs morts, le système de santé est décapé. La famine s’installe par poches, confirmée par les mécanismes internationaux de classification. La rhétorique officielle insiste sur la nécessité, l’intention et la proportionnalité ; les images et les données nourrissent l’accusation d’un usage excessif et durable de la force. Au fil des mois, Israël gagne des batailles tactiques et perd la bataille narrative, en Israël même où se multiplient les critiques sur la préparation défaillante du 7 octobre et la conduite du conflit.
Reste la longue durée. Netanyahou est le produit d’une matrice où guerre, diaspora et technologie forment un triangle. Il a porté une croissance réelle, signé des normalisations régionales et entretenu un lien particulier avec Washington. Il a aussi abîmé la confiance intérieure, affaibli l’indépendance judiciaire et arrimé la sécurité à des choix qui ont fait de Gaza un champ d’expériences tragiques. Son style, fait de durée, de communication serrée et d’opportunisme tactique, a déplacé le centre de gravité du pays vers un national-conservatisme assumé. La question palestinienne, que sa diplomatie avait contournée par la périphérie, revient au centre, lestée d’un coût humain et politique inédit.
Revenir au 21 octobre 1949 éclaire encore la trajectoire. L’enfant de Tel-Aviv est devenu l’architecte d’un Israël robuste et controversé, un stratège de coalition devenu chef de guerre. L’enfance a livré la peur et la discipline ; la jeunesse, la méthode ; la maturité, l’endurance. Il aura occupé le pouvoir assez longtemps pour imprimer une forme au temps politique israélien. Son œuvre restera indissociable d’un paradoxe : avoir solidifié l’État et, en même temps, avoir conduit son pays au bord d’une rupture avec ses alliés et avec le droit international. Si une issue se dessine pour Gaza, elle exigera reconstruction matérielle, recomposition politique palestinienne et réancrage d’Israël dans un cadre légal compatible avec ses alliances. Elle exigera aussi un examen des responsabilités sur la conduite de la guerre et sur l’échec initial du 7 octobre. À ce rendez-vous, l’homme des plateaux et des coalitions éprouvera la seule épreuve qu’il a toujours seek à différer : la reddition de comptes. Alors seulement, la biographie basculera du temps de l’action au temps du jugement, et la trajectoire personnelle rejoindra la profondeur d’un pays contraint de repenser sa sécurité, son droit et sa place dans le monde.
