 RWANDA - ANNIVERSAIRE
RWANDA - ANNIVERSAIRE
Paul Kagame, la stabilité comme projet
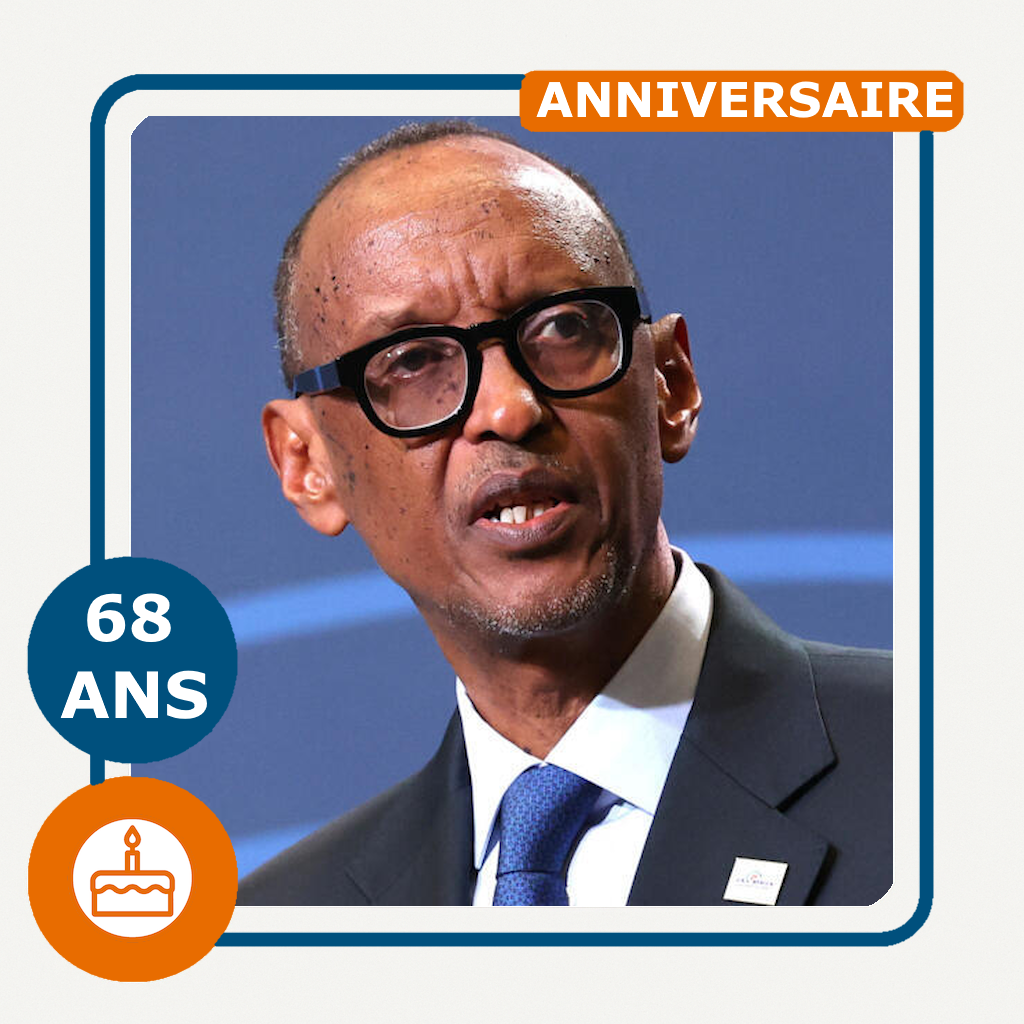
Né le 23 octobre 1957, Paul Kagame grandit d’abord dans un Rwanda encore sous administration belge, puis très vite hors de ses frontières, chassé avec les siens par les violences de 1959 qui projettent des dizaines de milliers de Tutsis vers l’Ouganda. Il fête aujourd'hui ses 68 ans.
L’enfance se déroulera dans les camps et les écoles de brique crue, au rythme des distributions de vivres, des migrations saisonnières et des solidarités d’exil. De cette précarité naissent des réflexes durables : économie des mots, discipline du corps, refus de la plainte. L’école apprend l’anglais et l’arithmétique, mais l’exil enseigne les hiérarchies, les humiliations et la patience stratégique. À Ntare puis à Old Kampala, l’adolescent intériorise une règle simple : survivre se joue dans la maîtrise de soi et la lecture froide des rapports de force.
Au début des années quatre-vingt, Kagame rejoint la guérilla de Yoweri Museveni. Il y sert au renseignement et à l’organisation, apprend la méthode des colonnes mobiles, l’art d’agréger des réseaux, le sens tactique des alliances. Quand Museveni accède au pouvoir en 1986, l’officier rwandais exilé devient un cadre respecté de l’armée ougandaise. Parallèlement, la diaspora tutsie se structure. En 1987, la création du Front patriotique rwandais donne un instrument cohérent à l’idée du retour. L’offensive d’octobre 1990 depuis l’Ouganda échoue d’abord avec la mort de Fred Rwigyema; Kagame, rappelé d’une formation aux États-Unis, prend le commandement. Suivent des mois de guerre d’usure, de cessez-le-feu fragiles et de pourparlers. Le 6 avril 1994, l’attentat contre l’avion du président Habyarimana ouvre cent jours d’horreur : le génocide contre les Tutsis et l’assassinat de Hutus modérés emportent des centaines de milliers de vies. Le FPR reprend l’offensive, prend Kigali en juillet et met fin par les armes au système qui a basculé dans le crime de masse. La victoire militaire ne clôt pas l’histoire ; elle l’ouvre sur une tâche écrasante : reconstruire un État, une justice et des sociabilités après l’abîme.
La paix qui s’impose n’est pas un relâchement mais un ordre à reconstruire. En 1994, un gouvernement d’union est formé. Kagame devient vice-président et ministre de la défense, véritable pivot sécuritaire, tandis que Pasteur Bizimungu préside la transition. S’ouvre alors une entreprise d’État qui mêle justice, sécurité et administration. Les juridictions gacaca, à partir de 2001, tenteront d’absorber l’immense contentieux pénal en mobilisant communautés et aveux publics. La réforme de l’armée neutralise les factions et impose une chaîne de commandement resserrée. Les administrations reprennent, les finances se normalisent, l’aide internationale est sommée de financer des politiques plutôt que des rentes. À partir de 2000, quand Bizimungu démissionne, Kagame est élu président par le Parlement de transition et établit une doctrine lisible : sécurité d’abord, performance ensuite, discours de l’unité nationale surplombant les identités et mettant à distance l’ethnicisation de la vie publique.
Sa vie privée épouse ce temps d’austérité. Kagame a épousé en 1989 Jeannette Nyiramongi, également issue de l’exil. Le couple aura quatre enfants, Ivan, Ange, Ian et Brian. La maison est protégée, les apparitions comptées, le récit familial aligné sur une morale de devoir. La première dame investit l’éducation et la santé communautaire ; le président affiche une réserve constante, sans confessions publiques. Cette sobriété intime explique le ton du pouvoir : peu de mots, des objectifs chiffrés, une vigilance constante. Elle traduit aussi l’expérience fondatrice de l’exil : l’espace privé reste un refuge soumis aux impératifs de sécurité, à la discrétion, à la préparation de l’avenir.
Sur le terrain institutionnel, le régime avance par chantiers numérotés. Les politiques publiques visent l’accès aux soins primaires via les mutuelles communautaires, la scolarisation de base, la professionnalisation de l’administration, la formalisation foncière, la lutte contre la corruption. Vision 2020 puis Vision 2050 dessinent une marche de l’agriculture de subsistance vers les services, l’industrialisation légère et l’économie numérique. Kigali devient vitrine : voiries propres, réglementation stricte, urbanisme planifié, conférences internationales. La représentation des femmes au Parlement se hisse au plus haut niveau mondial et sert d’étendard d’une modernisation présentée comme inclusive. La croissance se maintient sur la longue durée, l’extrême pauvreté recule par paliers, les bailleurs saluent la capacité d’exécution de l’État et la relative stabilité macroéconomique, malgré des chocs venus des cours mondiaux et des aléas climatiques.
Mais la consolidation a son revers. Les élections de 2003, 2010 et 2017 donnent des scores écrasants au président, dans un paysage politique organisé autour du RPF et d’alliés. Une révision constitutionnelle valide la possibilité de nouveaux mandats. En juillet 2024, Kagame est réélu pour un quatrième mandat avec un résultat quasi total, dans un scrutin que des observateurs internationaux décrivent comme sans véritable compétition. L’espace public demeure étroit : presse encadrée, société civile surveillée, opposants marginalisés. Des affaires précises cristallisent la critique extérieure : l’arrestation en 2017 puis l’acquittement en 2018 de Diane Rwigara, la condamnation en 2021 du dissident Paul Rusesabagina suivie d’une commutation de peine et d’une libération en 2023 après médiation internationale, les violences contre des exilés dont l’assassinat à Johannesburg en 2013 de l’ancien chef du renseignement Patrick Karegeya. Le pouvoir nie tout rôle dans ces faits, récuse l’étiquette d’autoritarisme et oppose un argument constant : la priorité absolue à la sécurité, à l’unité et au refus de la haine.
L’ombre longue de la frontière ouest structure aussi ce pouvoir. Les expéditions rwandaises au Congo à la fin des années quatre-vingt-dix, la présence de groupes armés hostiles, les cycles de guerre au Kivu nourrissent un contentieux régional persistant. Kigali affirme agir en légitime défense contre des milices qui visent son territoire ; des rapports onusiens et des sanctions étrangères ciblées — en 2025 contre un proche responsable militaire — soutiennent au contraire l’existence d’appuis rwandais à des rébellions. Les autorités congolaises accusent Kigali d’alimenter l’insécurité pour contrôler des routes minières ; Kigali répond qu’elle protège ses frontières et ses populations. Sur ce théâtre mouvant, les médiations s’empilent, les cessez-le-feu vacillent, les civils payent le prix le plus lourd. La géopolitique y rejoint l’économie politique des minerais, et le Rwanda se voit sommé de concilier impératif de sécurité et respect des souverainetés.
À côté de ce front, Kagame pratique une diplomatie d’efficacité. En 2018 il préside l’Union africaine, pousse une réforme administrative, soutient la mise en route de la zone de libre-échange continentale et promeut une culture de résultats au sein des organes panafricains. Le pays multiplie les partenariats avec l’Europe et l’Asie, accueille des sommets, investit l’aviation civile, l’hôtellerie, l’événementiel sportif et les services numériques. Cette stratégie d’ouverture vise à contourner l’étroitesse du marché intérieur, capter des capitaux, stabiliser les comptes et ancrer l’image d’un État efficace. Les institutions financières internationales relaient ce récit ; les organisations de défense des droits humains en contestent les angles morts. Entre célébration de la « success story » et dénonciation d’une autocratie moderne, le pays poursuit une trajectoire singulière : la priorité absolue à l’ordre, à l’efficacité administrative, à l’investissement planifié.
La mécanique du pouvoir repose sur une centralisation assumée. Le Rwandan Patriotic Front gouverne avec des alliés loyaux ; la haute fonction publique est recrutée, formée et évaluée avec soin ; les services de sécurité disposent d’une large latitude ; la justice suit des lignes directrices de fermeté. L’ensemble produit une administration capable de délivrer des politiques à grande vitesse, mais aussi un espace politique restreint où la compétition est encadrée. Kigali concentre les investissements et sert de laboratoire normatif ; les provinces s’alignent. La société, elle, avance à la vitesse des programmes : campagnes de vaccination, scolarisation, promotion de l’entrepreneuriat, développement des infrastructures. Le pays s’inscrit peu à peu dans des routines de gestion publique qui consolident la légitimité par les résultats, au prix d’une parole critique limitée.
Au miroir de la longue durée, Kagame apparaît comme l’homme d’un basculement historique. Il est celui qui a mis fin au génocide par les armes et qui a imposé la reconstruction d’un État fonctionnel ; il est aussi celui qui a transformé cette reconstruction en doctrine de stabilité sans faille. Libérateur et architecte d’un ordre austère, ces deux rôles coexistent péniblement mais durablement. Les partisans y voient une condition de survie et de progrès ; les adversaires dénoncent une verticalité qui bride la presse, l’opposition et les contre-pouvoirs. Entre ces pôles, la réalité est plus prosaïque : des paysans qui sécurisent leur parcelle, des élèves qui accèdent à l’école, des infirmiers qui vaccinent, des fonctionnaires qui suivent des objectifs trimestriels, des entrepreneurs qui profitent d’un environnement lisible, des militants qui testent les limites du permis. Le pays se tient sur une ligne de crête où chaque concession à la pluralité est immédiatement mesurée au risque supposé pour la stabilité.
Reste la question du temps à venir. Dans une région travaillée par des failles, la stabilité demeure la ressource la plus rare. Le pari de Kagame consiste à prolonger l’État fort jusqu’à faire naître des classes moyennes, des administrations routinières et des habitudes d’obéissance civique capables de maintenir l’ordre sans coercition visible. La succession, tôt ou tard, mettra à l’épreuve cette ingénierie. L’architecture institutionnelle tiendra si les élites acceptent la circulation et si l’opinion publique peut exprimer ses demandes sans être perçue comme une menace. L’histoire du Rwanda, telle qu’elle s’écrit depuis 1959, pèse de tout son poids sur ce calcul. Le chef d’État a souvent présenté son œuvre comme une assurance contre le retour du pire ; il appartient désormais à la société de savoir si cette assurance peut s’adosser à des libertés politiques élargies. Entre mémoire, sécurité et développement, Paul Kagame aura ancré une méthode : gouverner par objectifs, justifier par les résultats, défendre par la stabilité. L’avenir dira si cette méthode peut se transmettre sans l’homme qui l’a incarnée.
