 FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
Jacques Laffitte, les saisons d'un banquier roi
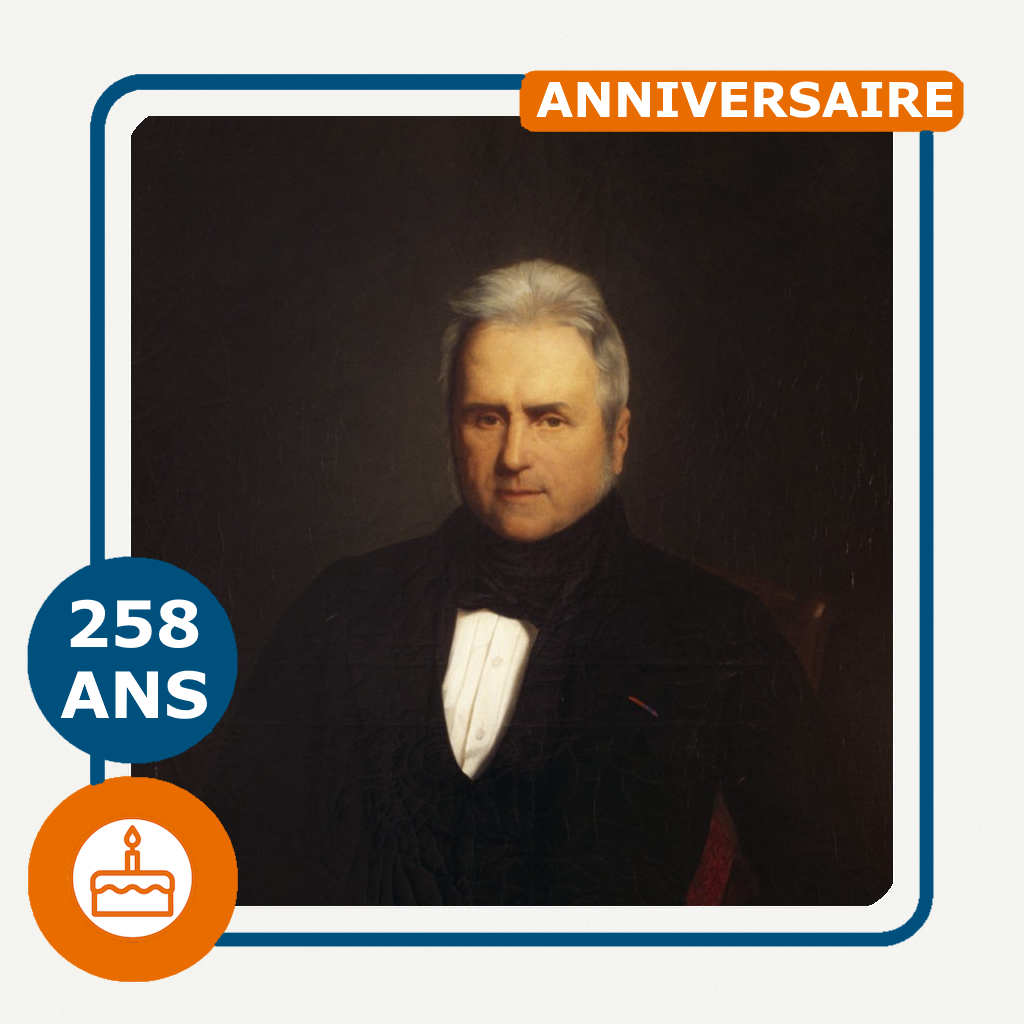
24 octobre 1767, naissance à Bayonne, au bord de l’Adour, dans une maison d’artisan où l’odeur du bois règle l’heure. Nous célébrons aujourd'hui le 258ème anniversaire de la naissance de Jacques Laffitte.
Le père, maître charpentier, enseigne l’exactitude du trait et la patience du geste. La mère tient le foyer large. L’enfant regarde les chantiers navals, écoute les négociants basques parler des routes, des monnaies, des délais. Très tôt, il passe de l’établi au pupitre et comprend que la règle, la plume et la confiance font circuler autant de puissance que les voiles. Bayonne lui apprend l’écart entre la richesse visible des cargaisons et l’invisible des écritures, la fragilité des échéances, la force des réputations. Il quitte l’atelier non par mépris mais par vocation. Le commerce attire, la ville appelle, la modernité se devine à la rigueur des colonnes comptables. Dans ce monde où l’on additionne les dettes comme on additionne les planches, il décide que la précision sera son pays.
1788, montée à Paris. Il entre chez le banquier Jean-Frédéric Perregaux, rue du Sentier. École austère, méthode précise. On trie les lettres de change, on suit les correspondants de Londres, d’Amsterdam, de Hambourg. La Révolution bouleverse les noms au fronton, mais la mécanique comptable demeure. Laffitte s’élève en silence par la régularité, par l’attention aux risques, par la fermeté quand l’enthousiasme emporte les autres. En 1800 il devient associé, en 1804 il succède au maître et dirige la maison. Il comprend que la banque ne gagne pas par éclat mais par discipline. Sous l’Empire, il prête quand il faut, refuse quand la rumeur grossit, choisit ses débiteurs. La réputation devient capital. Par touches, il assemble un réseau d’industriels, de négociants, d’agents de l’État. Il y a des profits, il y a des pertes, mais surtout un savoir de l’équilibre, qui fait les maisons durables. On vient chez lui pour l’argent, on y revient pour la parole tenue.
La vie privée suit son tempo. En mai 1801 il épouse Marine-Françoise Laeüt, fille d’un négociant du Havre. Le mariage coud ensemble les ports de l’Atlantique et la capitale. Le foyer n’affiche pas de luxe bruyant. On y lit, on y reçoit, on y calcule. En 1805 naît leur fille unique, Albine, dont on guette les talents et qu’on entoure d’une éducation exigeante. Les alliances familiales étendent le cercle des appuis. Laffitte veille à séparer l’intimité et le métier, mais les conversations glissent souvent du piano au prix des fonds publics. La maison s’orne de tableaux et de livres plus que d’or, car la fortune cherche une dignité discrète. Les peines arrivent comme partout, les craintes de maladie, les inquiétudes de paiements, et pourtant le couple tient, par sobriété et par estime. Dans cette sphère mesurée, il cherche non l’ostentation mais la durée. Il sait que la stabilité privée est le premier gage public.
Les charges publiques arrivent par les institutions. Régent de la Banque de France en 1809, gouverneur en 1814, il se place à l’articulation de l’État et du commerce. La monnaie est, pour lui, une confiance organisée et non un métal immobile. Il défend une circulation réglée, un escompte discipliné, des bilans sincères. À la Chambre de commerce de Paris, il propose de classer les risques, d’assainir les habitudes de paiement, d’éviter les emballements. Il sait que les régimes passent et que les créanciers restent. L’expérience lui donne un sens aigu du possible. Il parle peu, tranche net, se méfie des déclamations. On lui reproche de traiter la politique comme un livre de comptes. Il assume, parce que la paix civile a besoin de chiffres justes. Gouverner la monnaie, c’est gouverner les attentes, dit-il en acte. La France, encore rurale, devine déjà ses fabriques ; la banque doit préparer la route.
Vient la Chambre des députés. Élu en 1815 pour la Seine, puis pour Bayonne, Paris et Rouen, il prend place dans le camp libéral. Sa doctrine est simple et ferme. Liberté de la presse, responsabilité ministérielle, élargissement prudent du cens, sécurité juridique pour le commerce. Il combat les lois d’exception, refuse les vengeances. Sa parole, claire et peu ornée, cherche l’efficacité. Il connaît les finances publiques et sait qu’un État mal réglé renchérit l’argent privé. Il propose donc des budgets sincères, des économies utiles, des impôts lisibles. Il ne promet pas la lune ; il promet la tenue. Cela semble prosaïque, mais cela agrandit le possible. On le suit moins par ferveur que par confiance. Dans les couloirs, il écoute plus qu’il ne parle. Les projets s’arbitent à l’aune des échéances et des garanties. Il ne confond pas vitesse et précipitation. Il préfère la pente sûre à la pente raide.
L’été 1830 ouvre une séquence décisive. Les ordonnances de Juillet cassent l’équilibre. Paris se soulève. Laffitte, au cœur des échanges, parie pour l’issue orléaniste. Il veut sauver la Charte en la révisant, éviter l’isolement européen, donner au pays un roi citoyen encadré par la loi. Le choix l’emporte. En août il préside la Chambre des députés. Le 2 novembre il est président du Conseil et ministre des Finances. Il tente une politique de mouvement: amnisties pour apaiser, libertés pour rassurer, crédits pour relancer. Mais la rue veut davantage et la Cour moins. La conjoncture est mauvaise, la trésorerie contrainte, la presse impatiente. Le programme se heurte au réel. En mars 1831, il cède la place à Casimir Perier. L’expérience aura été courte, tranchante, révélatrice. Elle montre la difficulté d’installer une monarchie libérale dans un temps nerveux, et l’âpreté d’un pouvoir qui doit convaincre et contenir.
La sortie du Conseil précipite la tourmente privée. Sa maison a prêté à des industriels et à des spéculateurs fonciers dont plusieurs chutent. Les échéances se pressent, la trésorerie se creuse. Laffitte vend la forêt de Breteuil au roi, ouvre sa collection, hypothèque ses biens. En janvier 1831 il liquide la banque. Un concours de la Banque de France, garanti sur ses actifs personnels, évite la faillite judiciaire mais non l’humiliation publique. La caricature s’empare de l’événement et frappe juste par excès. Il se tait, classe, paie. Il regarde la tempête et en tire une leçon sévère: ne jamais laisser coïncider calendrier politique et calendrier bancaire. Il perd des millions, perd de l’influence, ne perd pas la tenue. Les amis s’éloignent, les adversaires exultent. Il continue pourtant de siéger, plus grave, plus sec, plus attentif aux conséquences.
Le domaine de Maisons, acheté en 1818, devient le laboratoire d’un autre art d’administrer. Il protège le château, trace des allées, établit des règlements, divise le parc en lots. Il imagine une ville de villégiature près de Paris, accessible, aérée, réglée. Les villas attirent une bourgeoisie qui veut le repos sans quitter les affaires. Les courses et le cheval donnent un emblème. On y marche, on y converse, on y lit les journaux. La ville prendra plus tard son nom, signe d’un urbanisme où le capital foncier se métamorphose en revenus réguliers et en sociabilité réglée. La pierre, au lieu de dormir, produit. Laffitte, qui a connu les banquettes des voitures de poste et les premières locomotives, voit dans ce paysage ordonné une promesse: la campagne organisée par la ville, la ville tempérée par la verdure, un compromis durable entre vitesse et repos.
La reprise institutionnelle suit. En 1836 il fonde la Caisse générale du commerce et de l’industrie, société en commandite dotée d’un capital ample, destinée à prêter à plus longue échéance et à participer aux entreprises. Le mot banque lui est refusé, mais l’outil fonctionne. Laffitte encadre, ne promet pas l’impossible, préfère des mécanismes solides à des proclamations. La Caisse finance des ateliers, envisage le rail, organise des émissions. Les résultats sont inégaux, la conjoncture reste fragile, mais l’idée travaille le siècle. Ce n’est pas encore la grande banque d’affaires, c’en est le laboratoire. L’entreprise survivra mal aux crises suivantes, mais elle aura montré la voie: faire dialoguer l’épargne et l’industrie, inventer des instruments pour la durée, préférer l’ingénierie financière à la rhétorique. La prudence demeure principe, l’audace reste méthode. Il tient les deux, autant que possible.
Redevenu député, d’abord à Rouen puis à Paris, il défend une ligne libérale tempérée. Il refuse les lois d’exception, réclame des finances claires, soutient l’instruction populaire et les libertés communales. Il ne méconnaît pas la question sociale ; il cherche des réponses par la durée, le crédit, l’emploi, non par les décrets spectaculaires. Sa parole perd de son éclat, mais gagne en gravité. Il sait que les institutions sont lentes, que la presse est impatiente, que les émeutes ruinent l’épargne des modestes. Il plaide pour des règles stables et pour des administrations tenues. Son libéralisme n’est pas une improvisation, c’est une discipline. Il a vu les paniques, les ruées, les dévaluations de réputation. Il préfère la continuité aux secousses, la clarté aux surprises. La Chambre l’écoute par respect et par utilité. Il ne cherche plus la première place ; il cherche l’effet durable.
Le temps se resserre. La santé se fatigue, une affection pulmonaire s’installe. Il lit encore, marche dans les allées de Maisons, dicte des souvenirs et des conseils. Le 26 mai 1844, à Paris, la mort clôt une trajectoire commencée dans l’atelier d’un charpentier et passée par les cabinets ministériels. L’inhumation au Père-Lachaise fixe le nom dans la pierre. Sa postérité n’est pas une doctrine, c’est une méthode: organiser la confiance par des règles, tenir ensemble liberté et responsabilité, articuler l’État et l’initiative. On mesure alors sa place dans trois temporalités. Dans le temps long des institutions, il a servi la Banque de France et la Chambre comme des cadres capables d’apprivoiser la modernité. Dans le temps moyen des pratiques, il a perfectionné les instruments du crédit et esquissé ceux de l’investissement. Dans le temps court des crises, il a plié sans rompre. Son parcours éclaire une France qui passe de l’artisanat aux fabriques, de la rente à l’investissement, du privilège au droit, et montre comment un homme de chiffres peut, un instant, tenir ensemble prudence et l’élan.
