 ETATS-UNIS - ANNIVERSAIRE
ETATS-UNIS - ANNIVERSAIRE
Michelle Lujan Grisham, une vie tenue, un État gouverné
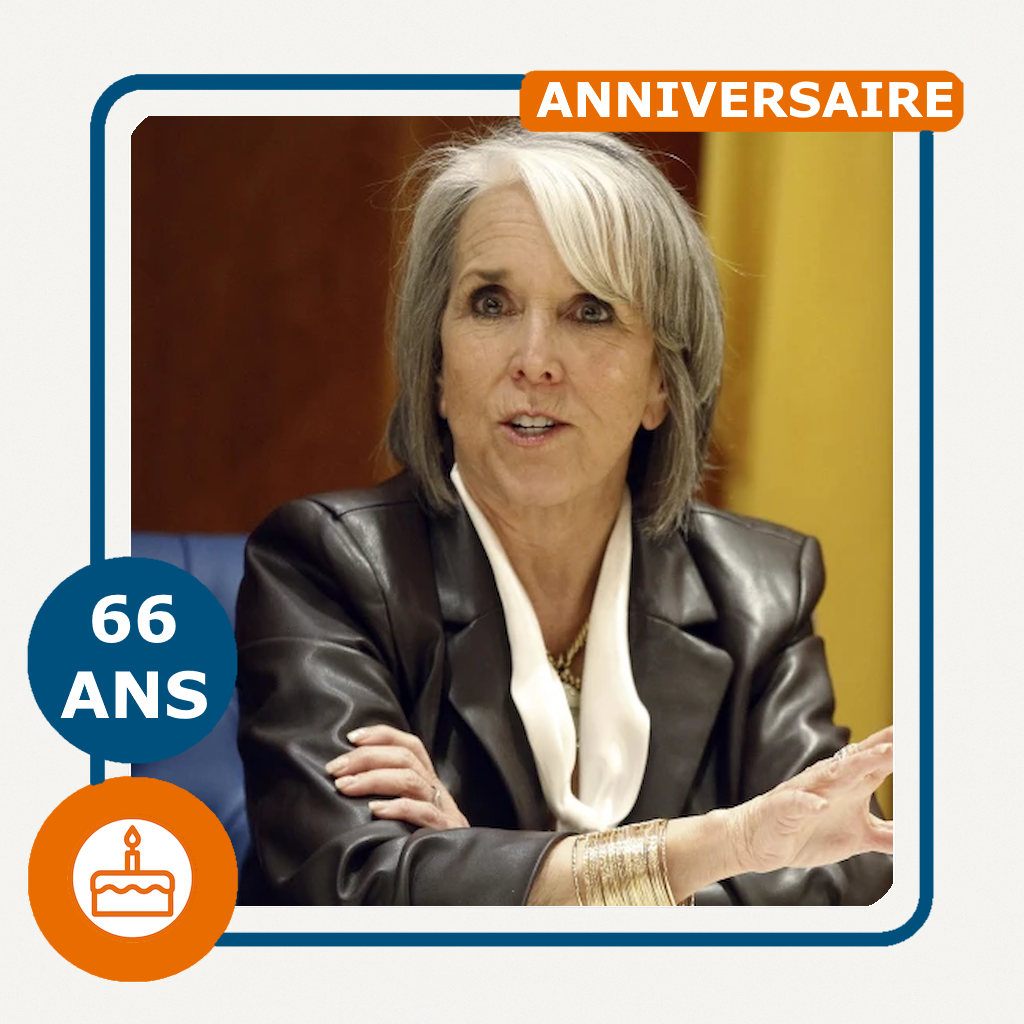
Née le 24 octobre 1959 à Los Alamos, Michelle Lujan Grisham grandit dans une famille solidement enracinée au Nouveau-Mexique, où le soin n’est pas une abstraction mais un métier et une éthique. Elle fête aujourd'hui ses 66 ans.
Son père, Llewellyn « Buddy » Lujan, dentiste attentif aux enfants modestes et aux personnes handicapées, incarne une médecine de proximité qui façonne le regard de sa fille sur l’inégalité et la dignité. Sa mère, Sonja, tient la maison et administre les liens. La fratrie est marquée par la maladie et le deuil d’une sœur, épreuve silencieuse qui installe très tôt, chez l’aînée, une gravité sans emphase. Entre Santa Fe et les établissements catholiques, l’adolescente découvre une société mêlée, hispanique et anglo, attachée aux lignages, au travail et aux rituels communautaires. Ce socle privé, fait d’attention et de contraintes, donnera plus tard à sa pratique publique un ton concret et persévérant.
Étudiante à l’université du Nouveau-Mexique, elle choisit une licence pluridisciplinaire avant d’entrer à l’école de droit de la même université. Elle finance en partie ses études, apprend la grammaire administrative, s’initie aux contentieux ordinaires qui rythment l’existence des ménages et des petites entreprises. En 1982, elle épouse Gregory Alan Grisham. Deux filles naissent. La jeune avocate s’oriente vers le secteur public plutôt que les cabinets lucratifs. Dans ces années de premières responsabilités, la vie familiale et le travail s’entrecroisent sans cesse. Puis, en 2004, la mort brutale de Gregory d’un anévrisme rompt la continuité. La veuve élève ses filles, poursuit sa carrière sans s’afficher, transforme la perte en fidélité active aux politiques de santé. Bien plus tard, en 2022, elle se remarie civilement, manière de dire que la vie privée demeure une affaire à part, préservée des joutes partisanes.
Son premier champ d’action durable est le vieillissement. Au sein des services de l’État, elle dirige des dispositifs consacrés aux aînés et au long terme. Elle y apprend le maillage des comtés, la réalité des maisons de retraite rurales, la fragilité de la main-d’œuvre soignante, la dépendance aux programmes fédéraux, l’importance de la coordination avec les nations autochtones. Ce travail discret, fait d’agréments, de normes, de remboursements et de contrats, lui donne une méthode : construire par étapes, mesurer, ajuster. En août 2004, elle devient secrétaire de la santé publique du Nouveau-Mexique. Il faut alors moderniser des systèmes d’information, soutenir les cliniques communautaires, contenir des foyers épidémiques, coordonner la prévention et les soins, composer avec des budgets étroits et des distances considérables. Ce n’est ni une tribune ni un théâtre, c’est une fabrique de politiques où l’on arbitre au plus juste.
Élue en 2010 à la commission du comté de Bernalillo, puis en 2012 à la Chambre des représentants des États-Unis pour le premier district de l’État, elle transporte cette méthode à Washington. Elle travaille au budget et à l’agriculture, suit les dossiers de nutrition et de développement rural, et préside à partir de 2017 le Congressional Hispanic Caucus, au moment où les débats sur l’immigration et les jeunes protégés par DACA s’exacerbent. Elle privilégie les coalitions patientes, les amendements utiles, les relais locaux. À l’écart des micros spectaculaires, elle se spécialise dans l’ingénierie institutionnelle qui, dans une démocratie continentale, fait passer des textes et modifie les trajectoires de dépenses.
En 2018, revenue à Santa Fe, elle remporte la course au poste de gouverneure. Son programme vise trois pivots : transition énergétique, droits et services publics. Dès 2019, l’Energy Transition Act fixe la pente des opérateurs électriques : 50 pour cent d’énergies renouvelables en 2030, 80 pour cent en 2040, et un objectif de courant entièrement décarboné en 2045 pour les grands acteurs, avec un délai supplémentaire accordé aux coopératives. La loi prévoit des fonds d’accompagnement pour les travailleurs et les comtés affectés par la sortie du charbon. Elle organise le financement de la reconversion et établit des standards vérifiables. Dans un État longtemps perçu comme périphérique, la décision propulse le Nouveau-Mexique au premier plan des politiques énergétiques occidentales.
La question du méthane suit. Dans le bassin permien, les fuites, le torchage et les équipements obsolètes pèsent lourd. Entre 2021 et 2022, des règles nouvelles imposent des contrôles réguliers, des plans de capture, des limites strictes au brûlage et des calendriers de mise en conformité. Le mot d’ordre est double : transparence et résultats. Les régulateurs sanctionnent les dépassements, obligent à corriger, publient des données. Le coût industriel est certain, mais le gain sanitaire et climatique affirme une direction lisible, qui s’accorde avec l’attraction d’investissements moins émetteurs et avec une stratégie d’emplois techniques.
Sur le terrain des droits, la priorité est de nettoyer l’arsenal hérité. En février 2021, l’État abroge la loi de 1969 qui criminalisait l’avortement. Quand la jurisprudence fédérale bascule, le Nouveau-Mexique demeure alors un lieu d’accès. En 2023, des textes protègent les soignants et patientes contre des tentatives d’ingérence extérieure, et la justice d’État confirme la prééminence des normes locales face à des ordonnances municipales restrictives. Dans cet espace frontalier où viennent des patientes de régions voisines plus restrictives, la politique menée n’est pas une posture mais un aménagement juridique complet de filières de soins sûres.
Autre réforme structurante, la légalisation de l’usage adulte du cannabis. Après une session spéciale, la loi est signée le 12 avril 2021 ; la possession adulte est autorisée à partir de l’été, et les ventes commerciales débutent le 1er avril 2022. L’objectif est économique et social : formaliser un marché existant, créer des emplois et des recettes, et réparer par l’expungement des traces pénales anciennes. Le département de régulation installe un cadastre des licences, organise la traçabilité, contrôle la qualité et accompagne les petites entreprises. Une nouvelle filière se déploie dans les villes et les petites agglomérations, avec ses promesses et ses frictions.
La pandémie constitue un tournant. Le Nouveau-Mexique choisit des restrictions fermes, des masques, des fermetures ciblées et des réouvertures graduées, puis une campagne de vaccination attentive aux territoires ruraux et tribaux. Les oppositions existent, la fatigue sociale aussi, mais l’exécutif assume un principe de précaution, qu’elle connaît pour avoir dirigé la santé publique. En 2023, face à une série de drames impliquant des armes à feu, elle déclare une urgence de santé publique et tente une suspension temporaire du port d’armes dans certaines zones d’Albuquerque et du comté de Bernalillo. La décision suscite contestations et ajustements judiciaires. Elle illustre un usage assumé de l’outil sanitaire pour répondre à une violence qui frappe des enfants et des adolescents.
Gouverner un État vaste impose une géographie des compromis. À Santa Fe et Albuquerque, le discours porte sur le logement, l’école, la santé mentale et les transports. Dans le sud pétrolier, il s’attache aux routes, aux formations et aux investissements productifs. Avec les nations autochtones, la gouverneuse multiplie accords et programmes conjoints sur la santé, l’eau et l’éducation bilingue. Les budgets excédentaires issus des hydrocarbures financent hausses salariales, recrutements d’enseignants, infrastructures hydriques et numériques. La ligne est constante : utiliser la rente présente pour financer l’avenir et amortir la transition.
Cette pratique des politiques publiques s’enracine dans un tempérament plus gestionnaire que tribunitien. Chez Michelle Lujan Grisham, la parole est sobre, les annonces ont des échéances et des métriques. On y lit l’empreinte d’une carrière commencée dans les dossiers du vieillissement, continuée par des années d’administration et consolidée à Washington. Rien n’y est instantané ; l’action se mesure par la mise en œuvre. Ce style peut déplaire dans un temps saturé de communication, mais il explique la continuité d’un agenda malgré les cycles médiatiques.
Réélue en 2022, elle affronte un environnement pris entre inflation, volatilité de la production, sécheresse structurelle et attentes sociales élevées. Elle capte des fonds fédéraux pour les infrastructures, encourage l’implantation d’industries moins émettrices, renforce des programmes d’apprentissage et d’ingénierie, et tente de réduire des écarts territoriaux persistants. Dans un État de peuplement dispersé, la question des services de base demeure centrale, de la clinique locale à la garde d’enfants, des bus scolaires à la fibre. La transition énergétique, déjà cadrée par la loi, se transforme progressivement en chantiers concrets.
La sphère privée reste tenue à distance. La disparition de son premier mari en 2004 a façonné un rapport lucide au temps, à la fragilité et aux priorités. Ce lien aux lignages locaux, revendiqué depuis douze générations, n’est pas un totem identitaire ; il décrit une sédimentation d’expériences collectives dans un pays de frontières et de migrations au plus près. Ainsi se dessine, au fil des décennies, la figure d’une responsable publique qui a choisi les leviers à effet durable. Son expérience a lié services de santé, technique législative et pilotage d’État, pour arrimer transition énergétique, droits protégés et sécurité quotidienne. Cette continuité compose moins un roman personnel qu’une mécanique de gouvernement. Dans le long temps du Nouveau-Mexique, fait d’altiplanos, de pueblos et de bassins d’extraction, elle aura cherché à convertir la rente en capital humain, à transformer des normes en résultats, à tenir ensemble héritage et modernité. Sa biographie, commencée dans une ville-laboratoire et nourrie par les métiers du soin, raconte une manière de faire qui préfère la durée aux éclats et l’exécution aux slogans.
