 FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
De la Garonne aux océans, la longue durée de Georges Leygues
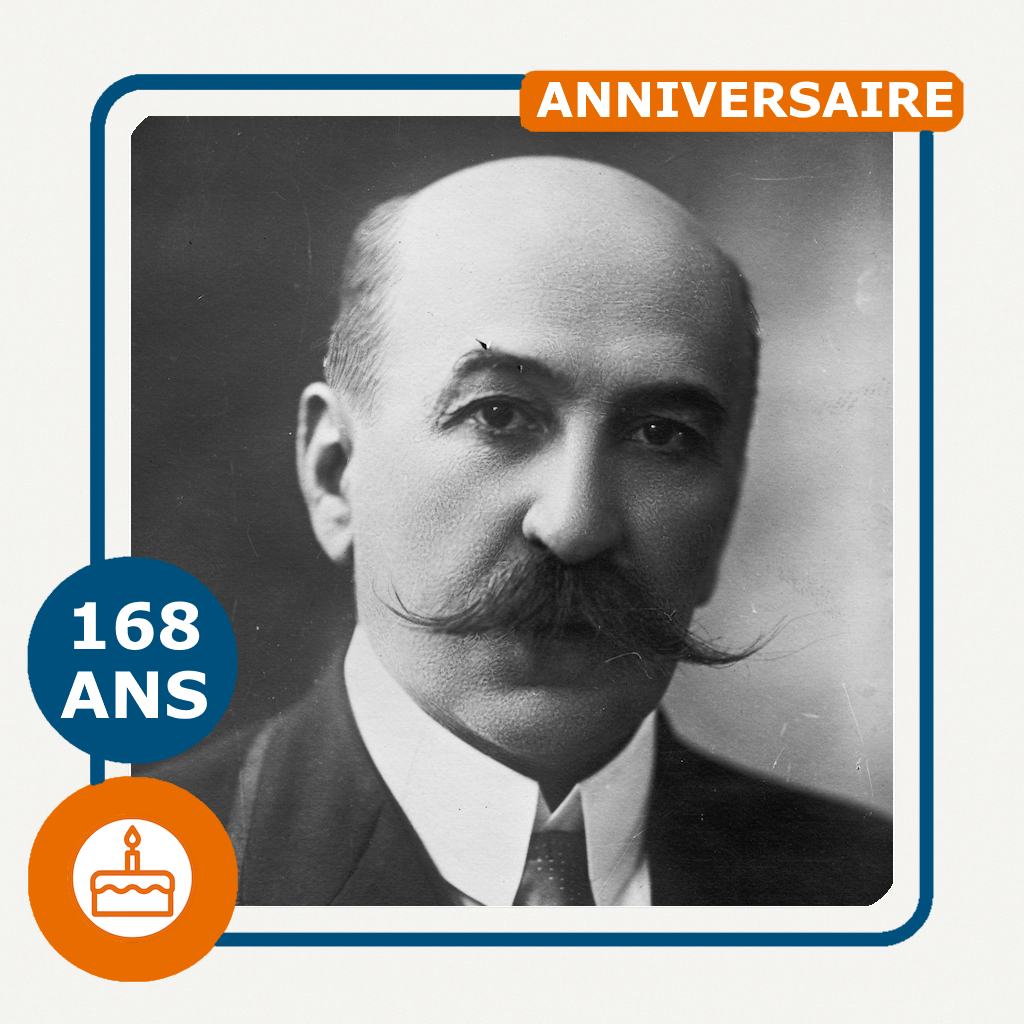
26 octobre 1857, Villeneuve-sur-Lot. Dans une bourgade gasconne qui regarde la Garonne comme une voie d’échanges et de départs, naît Jean Claude Georges Leygues. Nous célébrons aujourd'hui le 168ème anniversaire de sanaissance.
Il grandit dans une famille bourgeoise de tradition républicaine, attentive à l’instruction et aux arts. L’enfant aime la poésie, fréquente tôt les livres, rêve un moment d’un uniforme de marin avant que la volonté maternelle n’écarte la mer. Il choisit le droit, passe par Paris, devient avocat. Le goût des lettres ne le quitte pas, il cultive la fréquentation des milieux littéraires, s’essaie à l’écriture, et se fait une place discrète parmi les hommes de plume qui gravitent autour des académies et des salons parisiens.
Sa vie privée se tisse à l’échelle d’un pays qui se modernise et s’urbanise. Marié, père, il garde un ancrage constant dans sa ville natale. À Villeneuve-sur-Lot, il s’entoure de compagnons d’arts et de métiers, anime l’Association des Cadets de Gascogne, cercle d’entraide et de rayonnement où se croisent musiciens, sculpteurs, administrateurs et journalistes. Sa maison demeure une halte, son accent une signature. En 1909, la fortune d’Alfred Chauchard, fondateur des Grands Magasins du Louvre, lui est en partie léguée, épisode commenté dans la presse et au Palais-Bourbon. L’événement nourrit autant de soupçons que de jalousies, mais il fixe aussi l’image d’un notable qui met sa richesse au service d’œuvres locales et culturelles. Dans cette sociabilité provinciale et parisienne, il apprend l’art des fidélités longues, indispensables à qui veut durer dans la République.
La carrière politique commence très tôt, presque naturellement. À vingt-six ans, il devient adjoint au maire. En 1885, il est élu député de Lot-et-Garonne et conservera ce siège jusqu’à sa mort, traversant la Troisième République d’un pas régulier. Cette longévité dit l’enracinement local et la maîtrise des coalitions mouvantes. Il navigue parmi les républicains modérés, rejoint puis quitte des groupes parlementaires, sans renoncer à une image d’homme de dossiers. Le Palais-Bourbon est son atelier, la commission sa scène, l’hémicycle son théâtre mesuré. Il n’est ni chef de parti ni grand tribun, mais un négociateur patient, rompu aux équilibres d’une Chambre fragmentée. À mesure que les décennies passent, il gagne la confiance des administrations et des états-majors, qui trouvent en lui un ministre de continuité plus qu’un fondateur d’école.
Le premier ministère confirme l’intuition. En 1894, il reçoit l’Instruction publique et les Beaux-Arts. Il y revient en 1898, au moment où l’affaire Dreyfus déchire la société. Sa réforme de 1902 marque l’enseignement secondaire français. Elle rapproche le primaire et le secondaire, revalorise les sciences et les langues vivantes, ordonne des cursus plus adaptés aux exigences de l’industrialisation et de la compétition internationale. Le lycée cesse d’être un sanctuaire figé et s’ouvre davantage aux réalités techniques et scientifiques du temps. Leygues tente aussi une réforme prudente de l’orthographe, à laquelle l’Académie française oppose une résistance tenace. Cette tentative avortée n’efface pas l’empreinte du ministre qui, par décrets et circulaires, a équipé l’école d’une architecture plus souple, mieux articulée, capable d’accueillir des cohortes nouvelles d’élèves.
L’homme occupe aussi l’Intérieur en 1895, où il apprend la mécanique sensible de l’ordre public et des libertés, puis les Colonies en 1906, portefeuille où il s’intéresse aux ports et au maillage administratif, de Bizerte à Dakar, de Djibouti à Saïgon. À travers ces expériences, il administre plus qu’il ne proclame, convaincu que l’État doit tourner rond, que la République tient d’abord par ses services. Les années suivantes le voient au Parlement, en réserve active. Lorsque la guerre éclate en 1914, il s’engage comme capitaine de chasseurs alpins, mais la Chambre le rappelle vite à ses fonctions d’arbitre et de président de commission, tant la continuité des rouages politiques devient cruciale sous l’épreuve.
En novembre 1917, Clemenceau l’appelle à la Marine. La flotte, éprouvée par la guerre sous-marine, doit protéger l’Atlantique et la Méditerranée, escorter les convois, réparer, se rééquiper. Leygues rationalise les arsenaux, priorise les constructions utiles, stimule l’aéronavale naissante et les défenses anti-sous-marines. Il réorganise la logistique, défend des crédits parfois ingrats, veille aux liaisons avec la Royal Navy et l’US Navy. Sa manière est sèche, procédurale, sans effets de tribune. Cette méthode, qui privilégie la continuité des services, rassure les marins et fixe des priorités compatibles avec l’économie de guerre. Au sortir de la victoire, il maintient l’effort jusqu’en janvier 1920, moment où la reconstruction exige des arbitrages budgétaires et où la tentation du démantèlement guette tous les départements.
Le 24 septembre 1920, il accède à la présidence du Conseil et cumule les Affaires étrangères. Le gouvernement Leygues est de courte durée, mais il s’inscrit dans une séquence de stabilisation après l’épisode Deschanel et l’élection de Millerand à l’Élysée. La Chambre lui vote une large confiance. La politique extérieure reste prudente, orientée vers l’exécution des traités, la recherche d’équilibres européens et la protection des intérêts français sans aventures. À l’intérieur, la priorité demeure le redressement économique, la maîtrise de la dépense, la sécurité des frontières et des transports. Rien de spectaculaire dans ce ministère bref, mais la marque d’un style : tenir l’appareil, éviter les surenchères, faire passer les textes indispensables.
Il regagne surtout son port familier, la rue Royale. À partir de 1925, il retrouve le ministère de la Marine et y reviendra en 1926, 1930 puis 1932, jusqu’à ses derniers jours. Entre-temps, la France entre dans la logique internationale de limitation des armements. Le traité naval de Washington de 1922 fixe des ratios qui mettent Paris à parité avec Rome et loin derrière Londres et Washington. Leygues n’était pas à la table de Washington, mais il en assume l’héritage. Il s’efforce d’adapter doctrine et flotte à un cadre contraint, en misant sur des séries cohérentes, sur la défense des côtes, sur l’aviation embarquée et sur une politique des ports qui maintienne la présence française dans l’Atlantique et la Méditerranée. Dans les commissions, il plaide le cas français, partageant la conviction que la France doit tenir deux mers quand l’Italie n’en affronte qu’une.
Ce ministre de la mer demeure aussi un homme de culture. L’ossature de 1902 continue d’irriguer collèges et lycées. Il suit de près les institutions artistiques, soutient musées et conservations, et, dès 1900, ouvre la Légion d’honneur à des femmes de lettres, geste symbolique dans une France encore réticente. La cohérence du personnage tient à ce double attachement, l’école et la flotte, l’éducation et la puissance. Pour lui, un pays se mesure au savoir qu’il dispense comme aux navires qu’il arme. Il voit dans l’instruction une condition de la défense, dans la technique une école de la citoyenneté. Cette philosophie de la continuité associe l’élève et le marin, le professeur et l’ingénieur, le proviseur et le préfet maritime.
Sur le terrain électoral, il incarne une France de notables provinciaux qui envoient à Paris des hommes d’expérience. Sa circonscription de Lot-et-Garonne lui est fidèle. Il écoute les intérêts agricoles, défend voies ferrées et ports, obtient pour ses villes et cantons des équipements que l’État sait distribuer quand les budgets le permettent. Dans l’hémicycle, il cherche des majorités de travail. Ni doctrinaire ni velléitaire, il compose avec la Troisième République telle qu’elle est, faite de groupes, d’intergroupes et de coalitions éphémères. Il préfère les compromis opératoires aux manifestes. Cette disposition lui vaut quelques inimitiés chez les impatients, mais elle explique sa durée et son utilité dans les phases de transition.
Sa pratique de la diplomatie, brève à l’Hôtel du Quai d’Orsay, reste fidèle à cette ligne. Il mise sur la régularité des relations, soutient la coopération navale avec les alliés, garde méfiance envers les aventures coloniales ruineuses. Loin des coups d’éclat, il privilégie les plans et les calendriers. Sa méthode lui aliène parfois les impatients, mais elle parle aux administrations et aux états-majors. Elle explique que, des décennies plus tard, son nom ait été donné à un croiseur lancé en 1933 puis à une frégate de lutte anti-sous-marine qui servira jusqu’au début du XXIe siècle. Ces baptêmes disent une mémoire navale de l’État qui prolonge l’œuvre d’organisation d’un ministre obstinément attaché aux séries et aux règles.
La maison de Saint-Cloud devient un lieu de travail continu. Leygues ne recherche pas la lumière des journaux. Il convainc par des notes, des rapports, des auditions où chaque question en appelle une autre. Les témoins le disent précis, réservé, constant. Le 2 septembre 1933, la mort le surprend encore à la tâche, ministre de la Marine depuis l’année précédente. La République lui accorde des obsèques nationales. À Villeneuve-sur-Lot, un théâtre et un lycée portent son nom, témoignant d’un lien durable entre la petite patrie et le serviteur de l’État. Le monument élevé en son honneur fixe dans la pierre cette fidélité locale à un destin national.
La trajectoire de Georges Leygues illustre la longue durée d’une génération républicaine. Né sous le Second Empire, formé par les réalités de la République opportuniste, il traverse l’affaire Dreyfus, la Grande Guerre et les tâtonnements de l’entre-deux-guerres. Il croit à l’État instructeur et protecteur, à la rationalité des services, à la modestie des gestes efficaces. Son œuvre scolaire, en 1902, adapta les lycées à un siècle nouveau, en revalorisant les sciences sans renier les humanités. Son œuvre navale, poursuivie avec ténacité entre 1917 et 1933, arma la France de procédures, de chantiers rationalisés, d’une doctrine qui fit sa place à l’aéronavale et aux défenses anti-sous-marines. Cette politique de patience ne se lit pas en proclamations, mais en plans de carénage, en tableaux de tonnages, en crédits discutés année après année.
En refermant ce parcours, on voit un fil, une idée de la puissance mesurée. La poésie de sa jeunesse n’a pas disparu, elle s’est muée en cadence administrative. À la Chambre, au ministère, au conseil, il aura fait de la République une mécanique d’administration constante, où l’on réforme sans crier et où l’on construit sans se montrer. La Garonne de son enfance apprenait aux bateliers des mouvements lents et réguliers, et l’homme en garda quelque chose. À l’école, il ordonna les savoirs ; à la mer, il ordonna les flottes. Le pays, à travers lui, a appris à lier instruction et défense, culture et technique, province et capitale, rivière et océan.
C’est pourquoi son nom, discret dans les manuels, demeure vivant sur une proue, dans une salle de classe, à l’angle d’une façade municipale. Il modernisa, fixa des normes, défendit des budgets, se battit pour des ports, des programmes et des équipages, persuadé qu’une nation existe par ses infrastructures, ses cadres, ses enseignants et ses marins. Cette conviction simple résume une vie. Elle explique que, de Villeneuve-sur-Lot à Saint-Cloud, de la Garonne aux océans, l’itinéraire de Georges Leygues dise à la fois la constance d’un homme et l’endurance d’un État.
