 NICARAGUA - ANNIVERSAIRE
NICARAGUA - ANNIVERSAIRE
Daniel Ortega, du maquis à l’État
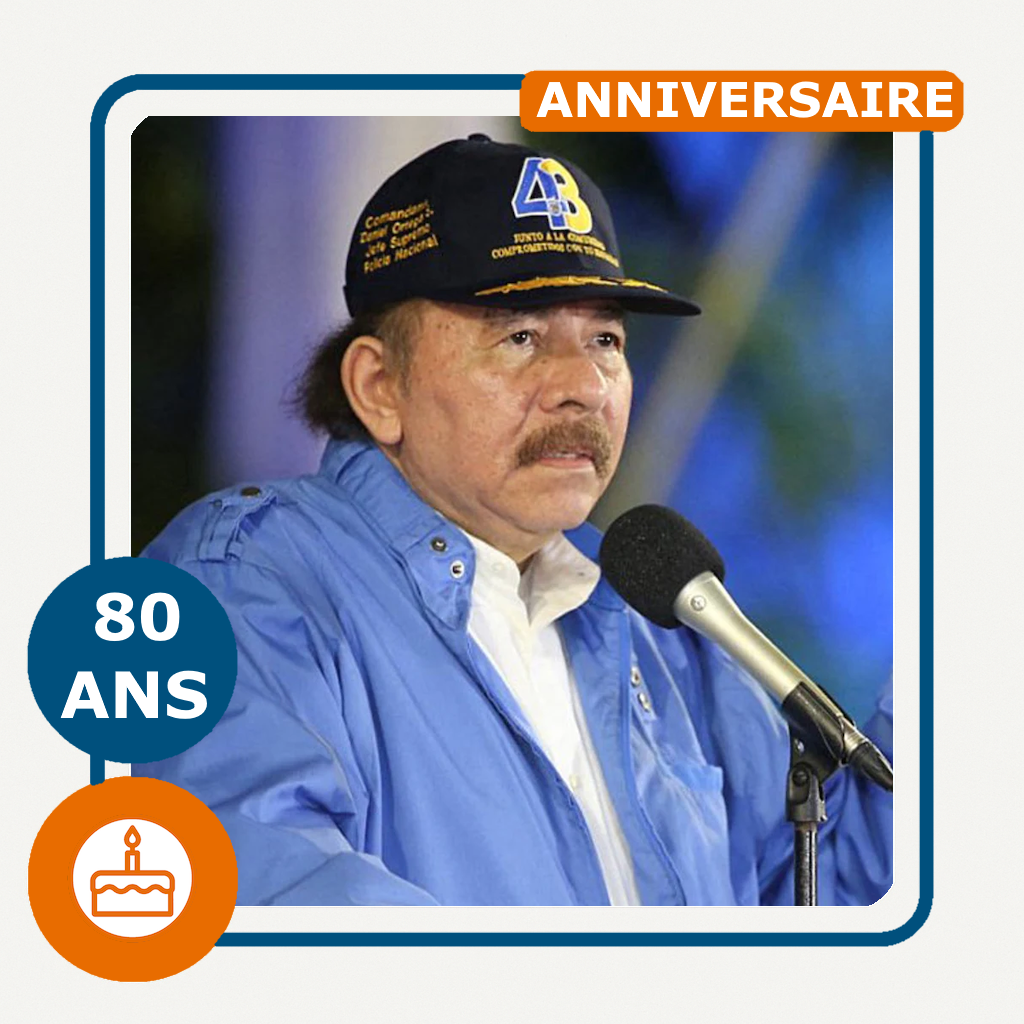
Né le 11 novembre 1945 à La Libertad, dans le département de Chontales, Daniel José Ortega Saavedra grandit au sein d’une famille où la défiance envers la dynastie Somoza tient lieu d’éducation civique. Il fête aujourd'hui ses 80 ans.
Son père, Daniel Ortega Cerda, modeste employé aux sympathies oppositionnelles, et sa mère, Lidia Saavedra, transmettent à leurs enfants la discipline, la prudence et l’idée que la politique s’enracine d’abord dans la survie quotidienne. L’enfance, d’abord rurale, glisse vers Juigalpa puis vers Managua, où l’école se mêle aux conversations d’adultes sur la mainmise des Somoza sur les banques, la terre et le commerce. Dans ce pays structuré par des dépendances anciennes, l’adolescent apprend que l’histoire pèse, que les familles gouvernent plus sûrement que les lois, et que la mobilité sociale suppose des fidélités, des réseaux, des solidarités.
À la fin de l’adolescence, l’étudiant en droit rejoint la clandestinité du Front sandiniste de libération nationale. L’apprentissage est austère : appartements sûrs, mots de passe, journaux ronéotypés, collecte de fonds, discipline d’équipe. Les arrestations ponctuent déjà le parcours. En 1967, après une opération de financement armé attribuée à la branche urbaine, Ortega est capturé par la Garde nationale et conduit à la prison d’El Modelo. Sept années d’incarcération s’ensuivent. Elles deviennent une école de cadres involontaire : lectures, cours improvisés, écriture de poèmes, liens de loyauté. La sortie, en 1974, se fait par l’échange de prisonniers obtenu après une prise d’otages qui humilie la dictature. Exilé à Cuba, Ortega reçoit une formation politique et militaire avant de revenir clandestinement au pays. La conjugaison de l’épreuve, de l’étude et du réseau le fait émerger parmi les dirigeants.
La sphère privée ne cesse alors de croiser la politique. Ortega rencontre Rosario Murillo dans ce monde de comités, de cultural centres et de radios militantes. Poète, animatrice, bientôt porte-parole, elle devient sa compagne puis sa partenaire de pouvoir. Le couple, longtemps uni de fait, se marie religieusement en 2005, geste public dans un pays où l’Église conserve un magistère moral. Famille recomposée, enfants placés dans les cercles médiatiques et économiques proches du pouvoir, usage d’un langage mêlant religiosité, souveraineté et solidarité : la maison devient un prolongement du parti. En 1998, une accusation portée par Zoilamérica Narváez, fille de Murillo, provoque une fracture intime et politique durable, qu’Ortega rejette. Ce moment souligne combien, chez lui, la vie privée est inséparable du conflit public.
Le 19 juillet 1979, la révolution renverse la dynastie Somoza. Ortega devient coordinateur de la Junte de reconstruction nationale, un pouvoir collégial qui hérite d’un État disloqué. Il faut rouvrir des écoles, rétablir l’électricité, réorganiser l’agriculture, remettre des hôpitaux en service. La croisade nationale d’alphabétisation, menée en 1980 par des dizaines de milliers de brigadistes, abaisse rapidement l’analphabétisme et crée un imaginaire d’égalité. Des campagnes de santé primaire, des politiques de titrisation foncière et des coopératives rurales redessinent la carte sociale. Mais la reconstruction se heurte à la rareté des devises et à la centralisation nécessaire à l’effort de guerre. La culture politique révolutionnaire s’installe avec ses fêtes, ses rituels, ses mots d’ordre, ses journaux.
La guerre froide s’invite de plein fouet. À partir de 1981, des groupes contre-revolutionnaires soutenus de l’étranger harcèlent l’État sandiniste. Sabotages, embargos et dépenses militaires étranglent l’économie. En 1984, Ortega remporte l’élection présidentielle et entre en fonction en janvier 1985. Le gouvernement affirme défendre la souveraineté et poursuivre la redistribution, mais l’état d’urgence limite la presse et la contestation. Les tensions sont vives avec des communautés indigènes de la côte caraïbe, révélant les angles morts d’un universalisme révolutionnaire trop sûr de lui. L’hyperinflation désorganise la vie quotidienne, la conscription pèse sur les familles, et la guerre impose une temporalité de siège. Pourtant, l’éducation et la santé continuent d’avancer, même sous contrainte.
En février 1990, contre les attentes, Violeta Barrios de Chamorro gagne l’élection. Ortega reconnaît la défaite et inaugure une longue traversée d’opposition. L’appareil sandiniste conserve des positions, des syndicats mobilisables et un capital symbolique. Le FSLN réinvestit les municipalités, conclut des pactes institutionnels, adoucit son programme économique et normalise sa relation avec l’Église. Le leader, stratège patient, comprend que le retour passera par la réforme des règles du jeu et la maîtrise des médiations. Les années 1990 voient la professionnalisation de l’armée, la recomposition du parti, la mise à distance d’une partie des anciennes radicalités, et l’apprentissage, pour Ortega, de l’opposition durable, de la négociation et du calcul.
En novembre 2006, Ortega revient à la présidence avec une majorité relative suffisante. À partir de 2007, il gouverne au nom de la stabilité et de programmes sociaux ciblés, visibles dans les quartiers et dans les campagnes. Les coopérations régionales, notamment avec le Venezuela, financent transferts, microcrédits et chantiers d’infrastructures. La pauvreté recule partiellement et la croissance réapparaît. Parallèlement, la centralisation s’accélère. En 2009, une décision de la Cour suprême lève l’obstacle à la réélection. En 2014, une réforme constitutionnelle supprime la limitation du nombre de mandats et renforce la présidence. La frontière entre parti et État s’amenuise, tandis que l’exécutif consolide sa mainmise sur la justice, l’Assemblée nationale et le Conseil électoral.
Le point de bascule intervient en 2018. Une réforme des retraites allume la contestation, vite relayée par des étudiants, des paysans et des habitants des villes. Manifestations, barricades et grèves gagnent le territoire. La répression est dure, fait des centaines de morts, des milliers d’arrestations et une vague d’exils. Des organisations non gouvernementales sont fermées, des médias privés de licence, des universités mises sous tutelle. L’Église catholique, d’abord médiatrice, devient la cible de procédures et de condamnations exemplaires. La rhétorique officielle désigne désormais l’ennemi intérieur et l’ingérence extérieure pour souder la base et justifier l’exception. L’État resserre sa police, durcit ses lois sur les « agents étrangers » et vide la sphère civique de ses contre-pouvoirs.
Les élections de 2021, tenues sans plusieurs figures d’opposition emprisonnées ou écartées, reconduisent Ortega et accentuent l’isolement international. En 2023, un geste spectaculaire libère et expulse vers les États-Unis plus de deux cents détenus politiques, tandis que des dizaines d’opposants perdent leur nationalité. La rupture avec les instances régionales se creuse, jusqu’à la sortie effective de l’Organisation des États américains en novembre 2023. Des sanctions ciblées tombent sur des responsables. L’économie tient par l’exportation, les envois de fonds et une discipline macroéconomique maintenue, mais la confiance des investisseurs dépend d’un climat politique devenu imprévisible. L’émigration, vers le nord ou les pays voisins, devient soupape et symptôme.
La figure de Rosario Murillo devient centrale. Vice-présidente depuis 2017, elle occupe la scène par des allocutions quotidiennes, une grammaire symbolique faite de religiosité, de souveraineté et de promesses de protection, et une gestion serrée des fidélités. En 2024 et 2025, un cycle de réformes allonge la durée du mandat et consacre la coprésidence du couple, tout en étendant l’emprise de l’exécutif sur les autres pouvoirs et en autorisant un appui accru des forces armées à la police. La codification d’une pratique consacre la priorité donnée à l’ordre, au contrôle de l’information et à la continuité, au prix d’une fermeture supplémentaire de l’espace politique. L’horizon d’alternance s’éloigne derrière l’architecture d’un pouvoir familial.
Dans la longue durée, l’action d’Ortega mêle protection sociale et discipline politique. La croisade d’alphabétisation, les campagnes de santé et la régularisation foncière ont laissé des traces durables. Les années 2000 et 2010 ont vu des programmes de transferts réduire certaines vulnérabilités et une stabilité relative attirer des investissements. Mais la crise de 2018 a brisé un équilibre. Les départs massifs, la fermeture d’associations, l’étiolement du débat public et la dépendance aux rentes extérieures ont fragilisé les acquis. La fusion du parti et de l’État a produit une efficacité administrative réelle dans certains domaines, au prix d’une justice instrumentalisée, d’une presse respirant mal et d’un tissu associatif raréfié. Le récit de souveraineté s’est mué en récit d’exception.
La vie privée, dans ce système, n’est pas un refuge mais un instrument. Le couple présidentiel met en scène une continuité dynastique, mêlant célébrations, hommages et pédagogies morales. Les enfants occupent des postes dans les médias et des entreprises proches, donnant à la communication une cohérence familiale. Cette familiarisation du pouvoir répond à des attentes d’ordre et de protection, tout en resserrant l’espace public. Elle nourrit la fidélité d’une base qui associe sécurité, assistance et respect, et conforte la conviction qu’un État fort protège mieux qu’un État disputé. Le prix en est la raréfaction des médiations, la fragilité des garanties et l’usure silencieuse des oppositions.
À l’international, Managua a recomposé ses partenaires et ses lignes d’approvisionnement. L’amenuisement des ressources vénézuéliennes a fragilisé la marge de manœuvre budgétaire, mais d’autres dialogues se sont noués. La doctrine affichée demeure la non-ingérence, tandis que la confrontation avec certaines chancelleries structure les postures. La sortie de l’Organisation des États américains symbolise ce repli souverainiste. Les sanctions et la réduction de certaines coopérations pèsent sur les finances, l’investissement et l’émigration. Pourtant, des secteurs exportateurs conservent des débouchés, et l’État maintient un pilotage macroéconomique qui rassure une partie du patronat local. Entre ouverture commerciale et fermeture politique, le compromis reste instable.
Reste la question du temps. Ortega traverse six décennies d’histoire nationale : militant clandestin, prisonnier, coordinateur de la junte, président élu, chef d’opposition, président de nouveau, puis coprésident. Ses partisans voient en lui l’artisan d’une souveraineté recouvrée, d’une redistribution tangible et d’un ordre stable. Ses opposants décrivent une dérive autoritaire, la fermeture des espaces civiques, la judiciarisation des conflits et l’exil comme soupape. L’ensemble laisse une empreinte paradoxale : l’élévation d’indicateurs sociaux dans certaines périodes et, en contrepoint, la contraction durable des libertés publiques. Le pouvoir se justifie par la protection, ses critiques par la mémoire de l’espérance.
Ainsi se lit la trajectoire d’un homme et d’un pays. Né dans un bourg de Chontales, formé par la prison et par Cuba, propulsé par la victoire de 1979, écarté puis revenu par les urnes en 2006, Daniel Ortega a gouverné au nom de la justice sociale et de l’ordre, puis gouverne au nom de la sécurité et de la continuité. Dans la salle des machines de l’État nicaraguayen, il a agrégé histoires familiales, fidélités partisanes, institutions subordonnées et médias alignés. Les réformes constitutionnelles de 2014 et la coprésidence instituée en 2025 ont donné un cadre juridique à la continuité personnelle. La révolution qui l’a porté au sommet subsiste comme récit fondateur et comme légitimité d’origine, mais elle s’est transformée en architecture de conservation. Biographie en cours, elle éclaire un pays où l’histoire longue continue de peser sur chaque choix politique.
Au Nicaragua, l’avenir reste ouvert encore.
