 ETATS-UNIS - NECROLOGIE
ETATS-UNIS - NECROLOGIE
Dick Cheney, un stratège de la permanence américaine
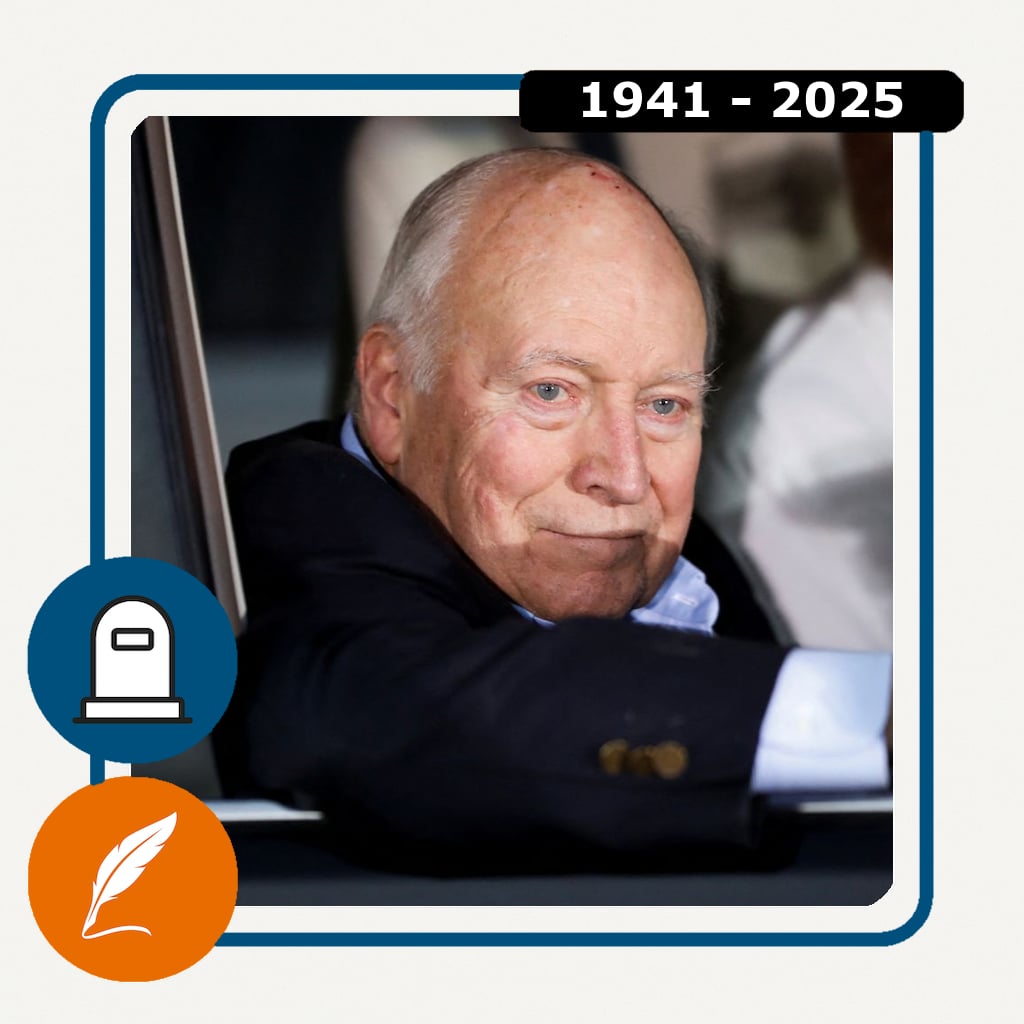
30 janvier 1941, à Lincoln dans le Nebraska, naît Richard Bruce Cheney, bientôt installé avec ses parents à Casper dans le Wyoming. Dans cette Amérique de grands espaces, la maison familiale valorise le travail calme, la frugalité et la responsabilité. Le père, agent de la conservation des sols, parle de rivières et d’irrigation; la mère transmet l’énergie du sport et du collectif. L’enfant grandit dans un pays de vent et de distances où l’on surveille les saisons et où la réussite tient au devoir plus qu’au spectacle. Cette géographie, faite de plaines, de routes longues et de voisinages clairsemés, l’orientera vers une politique de procédures et de continuités plus que d’élans oratoires. Le Wyoming lui donne une grammaire: économiser les mouvements, anticiper l’hiver, tenir son rang.
Le parcours académique commence par un faux départ. Le jeune homme entre à Yale, s’y disperse, puis quitte l’université. Le retour au Wyoming sert de redressement. À Laramie, il reprend pas à pas, obtient un bachelor puis un master de science politique. Un passage à Madison pour un doctorat avorte, mais il conserve l’essentiel: méthode, sobriété, discipline des dossiers. Cette période installe une idée simple qui ne le quittera jamais. L’État s’administre avec des notes, des calendriers et des procédures, non avec des improvisations brillantes. Il s’éprouve dans la rigueur quotidienne, s’acclimate à la patience et aux compromis, se persuade que gouverner, c’est organiser. Cette certitude, forgée loin des caméras, deviendra l’armature de toute sa carrière.
Le privé se structure très tôt. Au lycée, il rencontre Lynne Vincent, devenue Lynne Cheney, universitaire et écrivaine. Ils se marient en 1964. Le couple partage une discipline tranquille, une bibliothèque et un calendrier. Deux filles naissent, Elizabeth et Mary. L’une s’engagera dans la politique et affrontera plus tard son propre camp; l’autre, assumant publiquement son homosexualité, conduira le père à préciser sa vision des libertés familiales. La fidélité, chez les Cheney, n’efface pas les divergences; elle les ordonne. Le foyer demeure une base de repli et de réflexion, où la vie domestique pèse réellement sur la doctrine. Cette articulation entre convictions et réalités vécues expliquera plus tard des inflexions, modestes mais nettes, sur les droits privés.
L’entrée à Washington se fait par les portes techniques. Au début des années 1970, il sert dans les administrations Nixon et Ford. Il passe par l’Office of Economic Opportunity puis par le Cost of Living Council. Il apprend l’écriture réglementaire, l’art de réunir des avis et la gestion d’un agenda présidentiel. Il rencontre Donald Rumsfeld, dont il devient l’auxiliaire méthodique. En 1975, à trente-quatre ans, il devient chef de cabinet de la Maison Blanche auprès de Gerald Ford. Il y expérimente la réunion brève, la note concise et la hiérarchie assumée. La scène politique lui apparaît comme une chaîne logistique: il faut définir un but, préparer l’outil, réduire le bruit, contrôler la sortie. Cette pratique, plus administrative que tribunitienne, s’enracine et le marque durablement.
En 1978, il quitte l’aile Ouest pour la Chambre des représentants. Élu du Wyoming, il siégera onze ans. Il gravit les échelons de la direction républicaine, s’emploie aux budgets et aux questions de défense, veille à ce que l’exécutif dispose des outils nécessaires. Il n’est pas un orateur flamboyant mais un stratège parlementaire. Son conservatisme privilégie l’ordre institutionnel et la dépense maîtrisée. On le voit attaché à l’unité de commandement et à la clarté des objectifs. Cette décennie de législation et de couloirs affine un tempérament: prudence, fermeté, goût du détail utile, refus des gestes symboliques sans conséquence pratique. Il consolide des réseaux qui, plus tard, donneront à sa vice-présidence une densité singulière.
En 1989, la nomination au Pentagone change l’échelle. Secrétaire à la Défense de George H. W. Bush, il supervise l’invasion du Panama puis la guerre du Golfe. La coalition, l’architecture logistique et l’objectif limité de libérer le Koweït deviennent un cas d’école. La sortie de guerre, rapide, conforte l’idée que la force peut être précise si la politique fixe un but réaliste. Parallèlement, il conduit les fermetures de bases et l’ajustement d’une armée née pour la guerre froide. Cette expérience lui donne la conviction que la puissance exige une économie d’efforts: définir, concentrer, frapper, sortir. Elle lui donne aussi la mesure des limites, lorsque la paix ne bénéficie pas d’un plan civil adéquat. La leçon restera, mais son application ultérieure se heurtera au réel.
La décennie suivante le voit passer dans l’entreprise. En 1995, il prend la tête de Halliburton, géant des services pétroliers. Il y rencontre la mondialisation concrète: contrats lointains, fluctuations de prix, contentieux hérités de fusions, exigences d’actionnaires. Cette traversée nourrit son obsession des chaînes d’approvisionnement, de l’énergie et de l’infrastructure. Les critiques y verront plus tard une source de conflits d’intérêts. Ses défenseurs y liront une connaissance intime d’un secteur vital et d’un monde où l’État collabore avec le privé. Dans les deux lectures, demeure une constante: une attention froide aux flux matériels qui soutiennent la puissance d’un pays et la sécurité de ses engagements.
L’élection de 2000 le ramène au centre. Chargé d’évaluer des colistiers pour George W. Bush, il devient lui-même le choix. Jusqu’alors protocolaire, la vice-présidence prend avec lui une densité nouvelle. Le 11 septembre 2001 accélère ce mouvement. Les États-Unis découvrent la vulnérabilité domestique; l’exécutif étend ses prérogatives. Cheney défend une interprétation large des pouvoirs de guerre et de sécurité. Se met en place une architecture antiterroriste mêlant Patriot Act, surveillance renforcée, coordination des agences et pression continue sur les réseaux ennemis. La doctrine est claire: prévenir plutôt que subir, agir vite plutôt que tard, protéger la décision plutôt que l’exposer.
L’Irak concentre les controverses. Convaincu qu’un régime hostile peut recourir aux armes de destruction massive, il soutient l’intervention de 2003. Les lacunes du renseignement et l’absence d’armes retrouvées mineront la légitimité de l’opération. L’après-guerre, mal planifié, alimente l’instabilité. Cheney assume pourtant sa logique. Dans un monde d’incertitude extrême, dit-il, la présomption de danger devait guider l’action. Les mémos qui encadrent détention et interrogatoire renforcé portent sa marque intellectuelle. La contrepartie est lourde. L’appareil critique des libertés se cabre, les alliés doutent, l’opinion se divise. Il répond par le registre qu’il connaît: le primat de la mission, la continuité de l’État, la solitude des décideurs.
La vice-présidence Cheney n’est pas seulement guerrière; elle est matérielle. Les discussions sur l’énergie, l’accès aux ressources, les infrastructures et la sécurité des approvisionnements occupent une part considérable de son temps. Il préfère la discrétion des réunions à huis clos à l’exposition médiatique. Il revendique l’efficacité plutôt que la transparence immédiate, convaincu que la publicité entrave la décision. Ce choix nourrit une légende noire du secret, mais consolide un réseau d’influence réglé par la compétence et l’exécution. Il imprime, de manière durable, l’idée qu’un vice-président peut être une charnière opérationnelle entre sécurité, renseignement, diplomatie et économie.
La trajectoire comporte aussi des épisodes qui figent une caricature. En 2006, au Texas, un accident de chasse blesse un compagnon. L’événement déclenche moqueries et éditoriaux. Le responsable présente ses excuses, puis retourne à ses dossiers. Plus lourde est la sanction de l’opinion. L’Irak, la durée de la guerre et la crise financière de 2008 affaiblissent la majorité sortante. Cheney termine son mandat avec une impopularité record. Il s’en accommode. Sa métrique n’est pas l’instant médiatique mais l’efficacité de l’appareil d’État. Cette froideur heurte une partie du pays, en rassure une autre, et, surtout, laisse une empreinte institutionnelle que ses successeurs ne pourront ignorer.
La santé accompagne en sourdine chaque étape. Plusieurs infarctus imposent des opérations et des précautions. L’implantation d’assistances circulatoires puis une greffe du cœur, en 2012, lui redonnent des années disponibles. Il publie ses mémoires, coécrit des essais avec sa fille Liz et intervient dans le débat public. La séquence ouverte par Donald Trump le voit prendre ses distances. Il soutient sa fille lorsqu’elle s’oppose aux tentatives de renverser l’élection de 2020 et assume la rupture avec une partie de son camp. Le conservateur d’institutions en vient à rappeler que la force du pays réside d’abord dans l’État de droit, non dans la ferveur d’un chef.
Le foyer continue d’irriguer la réflexion. La place de Mary et de sa famille le conduit à admettre que les États et les individus doivent disposer d’une marge d’autonomie dans la définition de la vie privée. Ce réalignement discret ne l’éloigne pas de son conservatisme administratif, mais il rappelle que les trajectoires personnelles pèsent sur les doctrines. Chez les Cheney, la loyauté s’exprime par la tenue et le débat maîtrisé, non par l’adhésion automatique. Cette discipline explique la solidité du cercle intime et sa capacité à absorber les chocs d’une vie publique saturée de polémiques.
On ne comprend pas l’homme sans la géographie. Le Wyoming installe une pédagogie de la rareté et de l’anticipation. Washington fournit la grammaire du pouvoir. De cette combinaison naît une pratique qui privilégie chaîne logistique, commande claire et usage calculé de la force. Sa doctrine tient en quelques mots: définir un but limité, préparer l’outil, protéger la décision des interférences, sortir dès que possible. L’Irak a montré la face sombre du schéma lorsque l’objectif fut flou et que la sortie tarda. Mais la structure reste, et avec elle l’idée qu’un État doit se doter d’organes robustes pour encaisser les crises.
La fin s’écrit dans le même paysage de montagnes et de rivières. Cheney meurt le 3 novembre 2025 à Jackson Hole, des suites d’une pneumonie et d’atteintes vasculaires. L’annonce, le lendemain, rappelle une longévité traversée par la maladie et la controverse. Les hommages officiels saluent le serviteur de l’État; les adversaires rappellent les prisons, la surveillance et l’invasion de l’Irak. À l’échelle de la longue durée, son empreinte est institutionnelle. Il a rehaussé le rôle du vice-président et installé une architecture de sécurité qui structure encore les débats. La biographie s’achève, la structure demeure.
Que demeure-t-il, une fois éteint le bruit des polémiques? Des institutions modifiées, une doctrine de prévention durable, une cartographie des risques devenue centrale dans l’appareil d’État. Demeure aussi un avertissement pour les démocraties: la puissance s’épuise si le consentement décroît. La leçon Cheney, relue de loin, tient dans un balancier. Trop de secret abîme la confiance; trop de publicité paralyse l’action. Trouver l’équilibre exige des mœurs autant que des lois. Il a poussé l’aiguille vers la sécurité; d’autres ont tenté puis tenteront encore de la ramener vers la liberté.
Revenir au début éclaire la fin. À Lincoln et à Casper, un adolescent apprit que les hivers sont longs et qu’il faut rentrer le bois avant la neige. À Washington, un adulte transforma cette prudence en règles et en organigrammes. Entre les deux, la nation traversa la fin d’un empire soviétique, l’essor d’un marché mondial, le choc de 2001 et les guerres qui s’ensuivirent. Dans cette chronologie, Cheney fut moins un idéologue qu’un administrateur du risque, tenant d’un État solide et silencieux. On peut discuter la stratégie irakienne, critiquer la doctrine d’exception ou contester la culture du secret. Reste un fil, tendu de l’Ouest à la capitale: organiser le pouvoir pour durer, et tenir la barre quand souffle la tempête.
