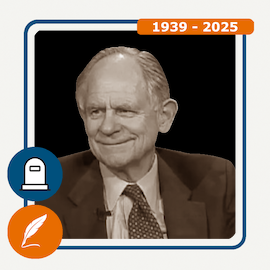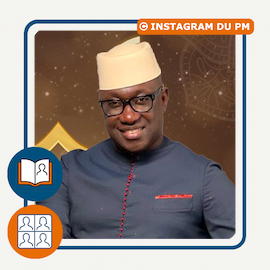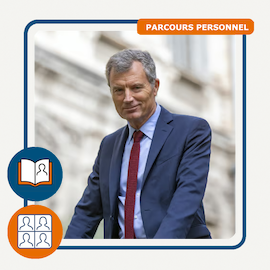FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
François Hollande, la présidence patiente au cœur des tempêtes
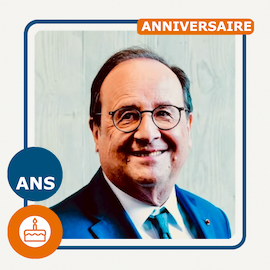
François Gérard Georges Nicolas Hollande est né le 12 août 1954 à Rouen, dans une France encore marquée par l’après?guerre, où les bouleversements économiques et sociaux dessinaient un pays en quête de modernité. Fils de Georges Hollande, médecin ORL originaire de Normandie, et de Nicole Tribert, assistante sociale venue de Bretagne, il grandit dans un foyer contrasté, traversé par des sensibilités politiques divergentes, son père étant plutôt marqué à droite et sa mère à gauche. Cette opposition domestique forge chez l’enfant un goût précoce pour le débat, une aptitude à comprendre des positions contraires et à rechercher le compromis. Rouen, puis Neuilly?sur?Seine après un déménagement, deviennent ses premières scènes d’observation des comportements sociaux et des disparités économiques, une expérience qui influencera son rapport à la politique.Il célèbre aujourd'hui ses 71 ans.
À l’école, François Hollande se montre studieux, curieux et attentif au monde qui l’entoure. Ses résultats brillants le conduisent au lycée Pasteur de Neuilly, puis à HEC Paris, où il intègre la promotion 1975. Il y découvre la rigueur de l’économie, la structuration des marchés, mais aussi les limites d’une approche strictement comptable de la société. Son passage à Sciences Po Paris et enfin à l’ENA, dont il sort en 1980 dans la fameuse promotion Voltaire, parachève sa formation. Cette promotion, qui rassemble de futurs hauts responsables politiques comme Dominique de Villepin, Ségolène Royal ou Michel Sapin, scelle un réseau relationnel qui accompagnera toute sa carrière.
Sa vie privée, longtemps associée à Ségolène Royal, commence dans les années 1970, alors que tous deux sont encore étudiants. Ensemble, ils auront quatre enfants. Leur couple, sans jamais passer par le mariage, incarne pour beaucoup une modernité assumée, mais aussi une certaine complexité de l’équilibre entre vie publique et vie intime. Leur séparation en 2007, annoncée au soir du premier tour de l’élection législative, marque la fin d’un long compagnonnage politique et personnel. Plus tard, sa relation avec Valérie Trierweiler, puis avec l’actrice Julie Gayet, fera de sa vie privée un sujet médiatique, parfois encombrant, contrastant avec son tempérament discret.
Sa carrière professionnelle débute à la Cour des comptes, où il analyse la gestion publique et affine son regard critique sur l’efficacité des politiques de l’État. Rapidement, il s’engage davantage dans la politique active. Membre du Parti socialiste depuis 1979, il participe à la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1981, année où il échoue aux législatives face à Jacques Chirac dans la 3e circonscription de la Corrèze. Ce revers ne l’éloigne pas de la politique corrézienne : il y construit patiemment un ancrage, allant à la rencontre des électeurs, cultivant un style chaleureux et accessible.
En 1988, il devient député de Corrèze, début d’un long compagnonnage avec cette terre rurale qui restera au cœur de sa carrière. Il alternera par la suite périodes de mandat et défaites, notamment en 1993 dans le contexte de la vague bleue. Mais son engagement reste constant, et il devient progressivement une figure importante du Parti socialiste. En 1997, après la dissolution décidée par Jacques Chirac et la victoire de la gauche plurielle, il accède au poste de premier secrétaire du PS. Cette fonction, qu’il exercera jusqu’en 2008, soit onze années, en fait l’un des dirigeants les plus durables du parti. Il y cultive une image de rassembleur, de stratège capable de maintenir l’unité malgré les tendances multiples qui traversent la gauche.
Son style, souvent décrit comme prudent, voire indécis par ses adversaires, correspond en réalité à une méthode : écouter longuement, éviter les affrontements frontaux, privilégier les synthèses. Cette approche, inspirée par l’idée que la politique est d’abord un art du possible, l’aide à naviguer dans un parti souvent traversé par des querelles idéologiques. Pendant ces années, il prépare aussi son propre destin présidentiel, sans jamais l’afficher trop tôt, conscient que la patience est parfois la meilleure arme.
En 2011, il se lance dans la primaire socialiste en vue de l’élection présidentielle de 2012. Longtemps outsider face à Martine Aubry et à Dominique Strauss?Kahn avant la chute de ce dernier, il mène une campagne méthodique, axée sur la proximité et la normalité. Sa victoire à la primaire le propulse candidat officiel du Parti socialiste. Face à Nicolas Sarkozy, il incarne l’alternance, promettant de réorienter l’Europe vers la croissance et de faire de la justice sociale une priorité. Le 6 mai 2012, il est élu président de la République française, devenant le deuxième chef de l’État socialiste de la Ve République après Mitterrand.
Son quinquennat (2012?2017) est marqué par des contextes difficiles. Sur le plan économique, il doit affronter une croissance atone et un chômage persistant. Ses premières mesures, comme la création de la tranche d’imposition à 75 % pour les très hauts revenus, frappent les esprits mais suscitent aussi des critiques sur leur efficacité. La politique économique, d’abord orientée vers la relance, évolue progressivement vers une ligne plus favorable aux entreprises, avec le Pacte de responsabilité et le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), choix qui divisent son électorat de gauche.
Sur le plan international, il engage la France dans plusieurs opérations militaires, notamment au Mali en 2013 pour stopper l’avancée djihadiste, puis en Centrafrique. Ces interventions, largement saluées sur la scène mondiale, renforcent son image d’homme d’État capable de décisions fermes en matière de sécurité. Mais ce sont surtout les attentats terroristes de 2015, à Charlie Hebdo en janvier puis au Bataclan et à Paris en novembre, qui marquent tragiquement son mandat. Sa réaction, alliant fermeté et recherche d’unité nationale, lui vaut un regain de popularité, mais cette embellie est de courte durée.
En matière sociétale, son quinquennat est notamment marqué par l’adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe en 2013, réforme emblématique qui provoque des manifestations massives mais qui reste un jalon historique dans l’évolution des droits en France.
Politiquement, la fin de son mandat est minée par des divisions internes, la montée du Front national et l’émergence d’Emmanuel Macron, son ancien ministre de l’Économie, qui quitte le gouvernement pour fonder En Marche. Conscient de sa faible popularité et du risque d’une défaite cinglante, François Hollande annonce en décembre 2016 qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession, une décision inédite sous la Ve République.
Après l’Élysée, il entame une nouvelle vie publique. Il publie en 2018 un livre, Les leçons du pouvoir, dans lequel il revient sur son mandat et livre ses réflexions sur l’exercice présidentiel. Il multiplie les conférences, en France et à l’étranger, s’investit dans des causes éducatives et humanitaires, et continue de peser dans le débat public, sans chercher à reprendre un rôle partisan majeur. Il soutient ponctuellement des candidats socialistes ou proches, tout en observant les recompositions politiques autour d’Emmanuel Macron et de ses opposants.
Dans sa vie personnelle, il vit désormais avec Julie Gayet, qu’il épouse discrètement en juin 2022 dans sa ville de Tulle, scellant une relation longtemps restée dans la sphère privée. Leur couple, discret mais assumé, contraste avec les tempêtes médiatiques du passé.
François Hollande, en 2025, reste une figure singulière de la vie politique française : un président arrivé au sommet après une longue marche patiente, un homme ayant gouverné dans un contexte tourmenté, et dont l’héritage, fait de réformes sociales marquantes et de choix économiques controversés, continue d’être débattu. Son parcours illustre la tension permanente entre les idéaux portés dans la conquête du pouvoir et les compromis imposés par son exercice.
À l’image des longues durées chères à Fernand Braudel, sa trajectoire ne peut se comprendre qu’en la replaçant dans l’évolution politique de la gauche française depuis les années 1980, dans les transformations économiques d’une France insérée dans la mondialisation, et dans les chocs géopolitiques du début du XXIe siècle. Son style, parfois moqué, relevait en réalité d’une tradition politique de patience et de synthèse, dont les fruits ne se mesurent pas toujours dans l’immédiateté des sondages mais dans la persistance des réformes adoptées.
Aujourd’hui encore, il demeure fidèle à ses engagements initiaux : défendre l’égalité, soutenir la construction européenne, et maintenir la France dans un rôle actif sur la scène internationale. L’histoire jugera, avec la distance nécessaire, la portée exacte de ses décisions, mais déjà, son nom s’inscrit parmi ceux qui ont marqué de leur empreinte la Ve République.