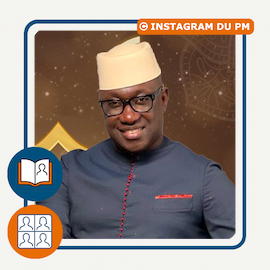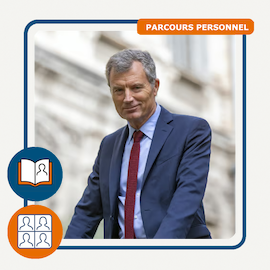ETATS-UNIS - NECROLOGIE
ETATS-UNIS - NECROLOGIE
Michael Castle, le temps des modérations
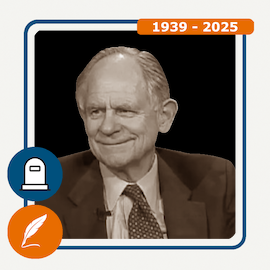
Michael Castle est décédé le 14 août 2025 à l'âge de 86 ans.
Né le 2 juillet 1939 à Wilmington, dans le Delaware, Michael Newbold Castle grandit dans un milieu où l’école, la communauté civique et l’entreprise rythment l’existence. Son père, avocat de brevets chez DuPont, renvoie l’image d’une Amérique industrielle sûre d’elle-même, patiente dans l’innovation et jalouse de sa compétence. Sa mère veille à l’étude, aux mœurs sobres, à cette idée simple que l’on appartient d’abord à un voisinage avant d’être le citoyen d’une grande nation. L’enfant passe par le Tower Hill School, une école sélective de Wilmington où l’on apprend la précision du langage, la tenue, la responsabilité. Au sortir de l’adolescence, c’est déjà un tempérament : réservé sans être distant, ordonné plutôt que flamboyant, conscient surtout que les institutions fonctionnent grâce à des milliers de petits gestes bien exécutés. C’est une manière d’habiter le temps long, d’accorder sa vie à la continuité plus qu’à l’événement.
Sa vie privée restera fidèle à cette discrétion. Catholique sans exhibition, ami des œuvres locales plus que des salons, il se marie tard, le 23 mai 1992, à la Holy Cross Church de Dover, avec Jane DiSabatino, rencontrée au croisement des sociabilités civiques de l’État. Elle devient brièvement première dame à la fin de son mandat de gouverneur ; elle demeure ensuite l’alliée des campagnes, l’interlocutrice des associations d’éducation et de santé, la présence tranquille lors des innombrables cérémonies où les petites institutions font leur autoportrait. Le couple n’a pas d’enfants ; il a des fidélités. On les retrouve à Wilmington, à des levées de fonds pour des écoles, des hôpitaux, des œuvres de quartier, à des messes où l’ordinaire s’honore. Cette part intime dit le sens d’une mesure : préférer le proche, ne pas surexposer sa vie, tenir la civilité comme un bien commun.
Pour Castle, l’étude est une rampe d’accès à la cité. À Hamilton College, il obtient en 1961 un diplôme d’économie ; à la Georgetown University Law Center, il reçoit en 1964 le doctorat en droit. La côte Est, ses campus disciplinés et ses bibliothèques en enfilade, lui enseignent une grammaire de gouvernement : la loi est un instrument d’équilibre, la négociation vaut mieux que l’exploit. Admis au barreau du Delaware et de Washington, il rejoint le cabinet Connolly, Bove and Lodge : litiges commerciaux, urbanisme, servitudes, cette cuisine du droit qui rend supportable la densité d’une petite économie régionale. Wilmington lui sert de laboratoire : on y apprend que l’efficacité politique n’est pas de promettre, mais de tenir, et qu’un compromis réussi produit autant de légitimité qu’un triomphe.
Très vite, la politique s’impose comme prolongement du métier. Adjoint du procureur général en 1965, il entre en 1966 à la Chambre des représentants du Delaware ; en 1969, il passe au Sénat de l’État, où il restera jusqu’en 1977 et terminera chef de la minorité républicaine. La géographie sociale de l’État lui devient familière : au sud, les terres agricoles et les petites villes où la frugalité fiscale est vertu ; au nord, les faubourgs financiers et industriels, soucieux d’infrastructures et d’écoles performantes ; entre les deux, des réseaux routiers, des budgets, et ces institutions qui, si elles sont prises au sérieux, rendent la liberté concrète. Après une parenthèse au barreau, le parti lui demande de revenir ; en 1980, il est élu lieutenant-gouverneur et sert de 1981 à 1985 auprès de Pete du Pont, s’impliquant dans la sécurité routière et la réforme éducative.
Gouverneur de 1985 à 1992, il gouverne sans tonnerre. La décennie exige des arbitrages : moderniser les établissements scolaires, encourager la prévention en santé publique, tenir les comptes serrés sans mutiler l’investissement. Dans un État souvent dirigé par des majorités démocrates, il travaille avec elles. Le Delaware, petite société politique où chacun se connaît, lui offre le terrain d’un centrisme opérationnel. La méthode est simple : des objectifs clairs, une évaluation régulière, une prudence budgétaire qui n’écrase pas l’ambition. Elle lui vaut une popularité solide, non d’enthousiasme mais de confiance, cette monnaie invisible qui permet aux gouvernants de traverser les cycles économiques sans secousse inutile.
En 1993, Castle gagne Washington et représente jusqu’en 2011 l’unique district du Delaware à la Chambre des représentants. La capitale a changé d’humeur : la télévision tranche, les clivages s’aiguisent, les compromis se raréfient. Il y conserve pourtant sa méthode. Dans l’éducation, il travaille aux dispositifs de responsabilisation scolaire qui culmineront au début des années 2000 ; dans la nutrition, il soutient des programmes destinés aux enfants, convaincu que l’investissement précoce produit les meilleurs retours sociaux ; sur le plan budgétaire, il défend le « pay as you go », cette règle de bonne tenue qui exige de financer toute nouvelle dépense. C’est une manière de résister à la tentation de l’instant, de rappeler que la crédibilité d’un État tient à la prévisibilité de ses choix.
À Washington, son nom s’attache pourtant à un objet inattendu : la numismatique. Castle estime qu’un pays se raconte aussi par ses pièces. Il pousse la création d’un programme de quarters dédiés aux cinquante États, et le Delaware ouvre la série à la fin des années 1990. Les pièces circulent, se collectionnent, s’alignent dans des boîtes de métal ; on les garde et, ce faisant, le Trésor encaisse des recettes. D’autres séries suivront, des présidents aux parcs nationaux. On le surnomme affectueusement le « congressman des pièces ». Ce geste, qui peut sembler mineur, révèle pourtant une intuition braudélienne : les nations se maintiennent par des récits modestes, répétés des millions de fois aux caisses des supermarchés, plus sûrement que par les grands discours.
Sur le terrain sociétal, Castle incarne un républicanisme du Nord-Est : conservateur des finances, libéral modéré pour les libertés. Il co-parraine l’élargissement du financement fédéral de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, convaincu que l’éthique peut encadrer la science au service des malades ; la Maison-Blanche opposera des vetos, mais la coalition transpartisane qui se forme donne à la question une légitimité durable. Il soutient la fin de l’interdiction faite aux militaires de servir ouvertement, estimant que la cohésion de l’armée ne s’alimente pas de secrets forcés. Lors de la crise financière, il accepte l’outil d’urgence destiné à stabiliser les marchés du crédit : réalisme plus que ferveur, mais même conviction qu’un édifice commun se protège avant de se réformer.
L’année 2010 condense les bascules d’époque. Le siège de Joe Biden au Sénat est à pourvoir ; Castle entre dans la primaire républicaine avec l’image d’un modéré expérimenté. Il affronte une candidate portée par une vague populiste conservatrice qui préfère les marqueurs identitaires aux compromis. La défaite est nette, presque pédagogique : elle signale moins l’épuisement d’un homme que la transformation d’un parti, où le centre se rétrécit. Le Delaware, lui, enregistre la leçon. Dès lors, l’État enverra à Washington des élus d’un autre bord, tandis que Castle se retire de la compétition sans renier sa manière. On peut lire dans cet épisode la victoire d’un temps court surexposé, celui des indignations, sur un temps long fait de réassurances.
Après 2011, il ne quitte pas la chose publique ; il la pratique autrement. Il conseille des institutions, témoigne lors d’auditions, s’implique dans les programmes numismatiques et les travaux de commission qu’il connaît intimement. On le sollicite sur l’éducation et la gouvernance ; il martèle l’exigence de preuves, la valeur de l’évaluation, la prudence face aux emballements. Il n’écrit pas de mémoires à scandale : il laisse des interventions calmes, des notes, et l’exemple d’une continuité. Dans un pays tenté par l’alternance de la ferveur et de la frustration, il plaide pour la modestie des instruments et la stabilité des buts, rappelant que la réforme est un verbe lent.
Le 14 août 2025, à Greenville, il meurt à quatre-vingt-six ans. Les hommages dépassent les lignes partisanes. Les gouvernants saluent un serviteur public ; les opposants d’hier rappellent une courtoisie ; les chroniqueurs notent que l’homme fut longtemps la figure la plus populaire du Delaware. On cite la pédagogie de ses pièces, la patience de ses budgets, la civilité de ses désaccords. Cette mémoire n’est pas nostalgie : elle rappelle la possibilité d’une politique qui préfère la gradation au coup d’éclat, la ligne de crête au précipice. Elle dit qu’un État tient lorsque des élus font tenir ensemble des gens dissemblables, non lorsqu’ils accablent leurs adversaires.
Pour comprendre le legs, il faut replacer la trajectoire dans une longue durée. Castle est né dans l’optimisme régulé de l’après-guerre ; il a gouverné à l’heure des transitions vers les services et le numérique ; il a siégé au Congrès lorsque les partis se sont durcis. Sa méthode n’a jamais été doctrinale. Elle fut géographique : partir d’un État minuscule, observer les interconnexions entre écoles, routes, hôpitaux et banques, puis transposer cette cartographie à l’échelle fédérale. Elle fut aussi morale : préférer l’exactitude à l’emphase, l’évaluation à la proclamation, la responsabilité à la posture. On lui a parfois reproché de trop concéder ; il répondait par la régularité des résultats. Dans la lente mécanique des institutions, c’était une manière de courage.
On caricature volontiers le centrisme en tiédeur. Chez Castle, il ressemblait à un art de bâtir. Le gouverneur a renforcé des infrastructures quotidiennes ; le député a soutenu des dispositifs éducatifs mesurables ; l’élu fédéral a cherché à stabiliser les finances sans renoncer à l’investissement collectif. La politique des pièces ne fut pas un divertissement : elle lia des millions de citoyens à l’histoire fédérale, créa des recettes et un motif partagé. La défense d’une recherche biomédicale encadrée traduisit une compassion raisonnable. Et lorsque l’armée se rendit plus transparente à l’égard de ses membres, il se trouva du côté d’une égalité concrète. On peut ne pas aimer ces arbitrages ; on doit reconnaître leur cohérence.
Ce type de carrière, sans flamboyance, paraît modeste à l’échelle des crises globales. Il ne l’est pas à celle d’un État et d’une nation qui tiennent par la confiance. L’architecture américaine fonctionne quand des élus fabriquent des majorités de travail. Castle aura incarné cette majorité à lui seul : prêt à voter avec l’autre camp si cela améliorait un texte, prêt à contrarier son parti si la cohérence l’exigeait. La tempête populiste l’a balayé d’une course ; elle n’a pas effacé l’utilité de sa méthode ni la dignité de son style. À Wilmington, à Dover, à Washington, il laisse l’image d’un praticien de l’État qui croyait que le progrès passe par des marches courtes et régulières. C’est peu à l’ère des réseaux ; c’est beaucoup pour la mémoire civique.
Ainsi se referme une vie publique commencée sur les bancs d’une école sélective, élevée par les laboratoires d’un cabinet d’avocats, éprouvée par les compromis d’un Sénat local, validée par les urnes d’un petit État et transportée jusqu’aux couloirs de la Chambre. Michael Castle ne prétendit pas changer le monde ; il s’efforça de le tenir ensemble. Il laisse l’exemple d’une politique qui ne s’excuse pas d’être professionnelle, qui prend au sérieux les comptes, les indicateurs et les effets concrets des lois. Il laisse, surtout, l’idée qu’on peut gouverner sans bruit et marquer pourtant durablement le paysage, ce qui est une autre manière de durer.