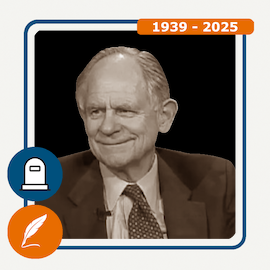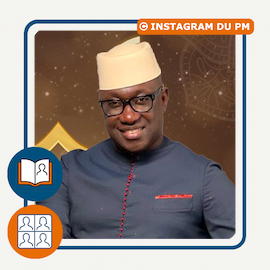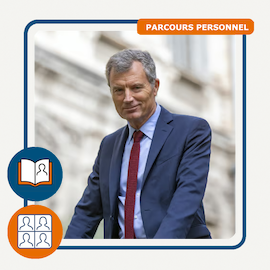HISTOIRE D UN JOUR - 15 AOUT 1947
HISTOIRE D UN JOUR - 15 AOUT 1947
L'heure partagée de l'indépendance indienne

15 août 1947, l'Union indienne s'éveille à minuit quand Jawaharlal Nehru est investi Premier ministre, tandis qu'à Karachi, la veille, 14 août, le Pakistan a reçu les attributs du pouvoir. Deux cérémonies à un jour d'intervalle, pour un même basculement : la fin d'un empire qui se retire et la naissance de deux États promis à des destins reliés et rivaux. Ce changement d'horloge concentre des durées longues : l'urbanisation du Raj, l'extension des chemins de fer, la circulation des journaux, les réformes administratives, la politisation progressive des classes moyennes et des paysanneries. Il se joue aussi dans l'épaisseur d'une géographie immense, de deltas et de plateaux, de bazars et de casernes, où les communautés apprennent depuis des générations à composer avec l'autorité, le marché et le sacré.
Depuis la fin du XIXe siècle, un nationalisme multiforme grandit. Le Congrès national indien s'organise, la Ligue musulmane affirme ses intérêts, des syndicats naissent, des associations réformistes se multiplient. La Première Guerre mondiale fissure le prestige britannique ; la seconde l'épuise. Le poids de l'effort de guerre, les réquisitions et les ruptures d'approvisionnement fragilisent les campagnes et les villes. En 1943, le Bengale est frappé par la famine, drame d'origine largement politique : des millions de vies basculent, l'autorité impériale perd sa prétention à l'infaillibilité. Dans ce contexte, Gandhi, Nehru et d'autres figures imposent l'idée d'autodétermination, tandis que Muhammad Ali Jinnah mobilise l'argument d'une nation musulmane à protéger.
La négociation avec Londres suit des méandres. Les promesses de statut de dominion faites en temps de guerre demeurent ambiguës. La mission du Cabinet de 1946 propose une union lâche avec des groupements de provinces ; la défiance réciproque entre Congrès et Ligue l'emporte. Dans la rue, la politique se déchaîne : le 16 août 1946, une journée de "action directe" à Calcutta déclenche des massacres qui gagnent Bihar et le Pendjab. Dans la mémoire collective, les images d'émeutes, de quartiers incendiés, de foules terrifiées, préfigurent la brutalité de la rupture à venir. À l'hiver 1946-1947, l'administration coloniale prend acte de son impuissance grandissante et cherche l'issue la moins périlleuse pour un retrait rapide.
Le 3 juin 1947, le plan Mountbatten annonce la partition. Le Parlement britannique l'inscrit dans l'Indian Independence Act voté le 18 juillet : deux dominions souverains, Inde et Pakistan ; division du Bengale et du Pendjab ; commissions de frontières ; transfert de pouvoir en août ; liberté laissée aux États princiers d'adhérer à l'un ou l'autre. Cette architecture administrative, conçue dans l'urgence, néglige la grammaire quotidienne des lieux : partages des eaux d'irrigation, marchés hebdomadaires, sentiers, propriétés, temples et mosquées. À la base, familles et métiers doivent convertir en gestes simples des décisions prises loin des villages, au prix d'adieux et d'arrachements irréparables.
À Karachi, le 14 août, Muhammad Ali Jinnah prête serment comme gouverneur général. À Delhi, la Constituante se réunit à onze heures du soir, écoute Vande Mataram, observe deux minutes de silence pour les morts de la lutte, puis Nehru prononce son "rendez-vous avec la destinée". À l'aube du 15, dans le Durbar Hall devenu Rashtrapati Bhavan, Louis Mountbatten assermente le cabinet. Les rues se couvrent de drapeaux, mais l'optimisme se heurte au grondement des trains venus des campagnes, bondés de réfugiés. La publication, deux jours plus tard, des décisions des commissions Radcliffe achevant de définir les limites, bouleverse des attentes et précipite les départs.
Commence alors la plus vaste migration liée à une frontière nouvelle en temps de paix. On estime à environ quinze millions le nombre de personnes en mouvement, et à plusieurs centaines de milliers le nombre de morts, même si les chiffres varient. Des colonnes s'étirent sur des routes poussiéreuses ; les gares deviennent des pièges ; des trains sont attaqués. La tentative d'une force conjointe au Pendjab pour protéger les passages échoue vite. Les femmes paient un tribut terrible, victimes d'enlèvements et de violences que les deux nouveaux gouvernements s'efforceront ensuite de réparer, imparfaitement, par des accords et des opérations de restitution. Les villes frontalières changent de visage au rythme des arrivées.
Les nouvelles frontières découpent des ensembles économiques et symboliques. Au Bengale, l'est rizicole constitue le Pakistan oriental, mais Calcutta demeure côté indien, tirant vers elle les réseaux du commerce et du crédit. Le district de Sylhet, rattaché auparavant à l'Assam, rejoint l'est à la suite d'un référendum. Au nord-ouest, le Pendjab est sectionné ; Lahore, cœur intellectuel, passe au Pakistan, Amritsar reste en Inde. Les canaux hérités des grands travaux de l'Empire sont partagés, les marchés se déplacent, les pèlerinages s'adaptent. Dans la Province frontière du Nord-Ouest, un vote a accompagné l'intégration au Pakistan, confirmant un ancrage régional spécifique.
L'Inde indépendante est d'abord un dominion, mais la Constituante travaille sans relâche. Sous la présidence de Rajendra Prasad et l'impulsion de B. R. Ambedkar, elle élabore une Constitution qui combine droits fondamentaux, répartition des compétences entre Union et États, indépendance de la magistrature et responsabilité ministérielle. Le 26 janvier 1950, le texte entre en vigueur, la fonction de gouverneur général disparaît et l'Union devient une république. Parallèlement, la première grande élection au suffrage universel prépare une démocratie de masse dont la logistique, colossal défi, consolide l'État naissant.
La question des États princiers exige adresse et fermeté. Patel et V. P. Menon obtiennent des adhésions par persuasion, garanties et parfois action armée. Junagadh, qui avait choisi le Pakistan malgré une population majoritairement hindoue, est intégré après consultation ; Hyderabad, vaste entité au centre du plateau, rejoint l'Union en 1948 après une opération militaire brève, qualifiée de police. L'intégration n'est pas seulement politique : elle harmonise des régimes juridiques, unifie des systèmes fiscaux et relie des marchés jusque-là cloisonnés.
Au nord, le Cachemire cristallise très tôt rivalités et peurs. À l'automne 1947, l'attaque de milices parties du Pakistan précipite l'adhésion du maharaja à l'Inde ; l'envoi de troupes, la guerre de positions, puis l'intervention des Nations unies conduisent à un cessez-le-feu effectif au 1er janvier 1949. Une ligne sépare désormais les zones tenues par chaque armée, sans résoudre la question politique. La frontière nouvelle, ailleurs, impose des visas, des contrôles, des négociations sur l'eau et le commerce ; des accords visent aussi à protéger les minorités restées de part et d'autre, et à retrouver des personnes enlevées au chaos des mois initiaux.
Gouverner, c'est aussi aménager la durée. L'administration héritée du Raj change d'allégeance mais assure la continuité des services essentiels. Le gouvernement adopte la planification, encourage l'industrie de base tout en soutenant l'agriculture, investit dans les barrages, l'énergie et l'enseignement supérieur. La fédération se construit par pragmatisme : concessions linguistiques, autonomie des États, mais affirmation de l'unité par le Parlement et la Cour suprême. La politique étrangère cherche une place entre blocs, appuie la décolonisation et noue des solidarités asiatiques et africaines ; cette posture de non-alignement, en devenir, participe d'une stratégie d'indépendance.
Reste la vie des gens et la mémoire des lieux. Dans les quartiers de Delhi, de Bombay ou de Calcutta, des colonies de réfugiés s'installent, devenues des villes dans la ville ; artisans, boutiquiers, fonctionnaires déplacés y recomposent des sociabilités. Dans les campagnes, on répare les canaux, on rouvre les foires, on renoue des alliances matrimoniales rompues par l'exil. Beaucoup gardent, pour toujours, une clef inutile, l'adresse d'une maison perdue, ou le souvenir d'un train sans retour. La double date des indépendances, 14 et 15 août, dit cette histoire fendue : deux aubes séparées, un même continent humain. À la fin, 15 août 1947 n'est pas un arrêt ; c'est un seuil où se rencontrent longue durée et heure décisive.
Un dernier regard replace l'instant dans ses prolongements. Les frontières attribuées par Radcliffe ne furent rendues publiques que le 17 août, ce qui nourrit l'incertitude de villages. Mountbatten demeura gouverneur général du pays jusqu'en juin 1948, relayé par C. Rajagopalachari, tandis que le Pakistan se dotait de ses propres institutions autour de Jinnah. Dans l'Union, l'ancienne fonction publique impériale, devenue service administratif indien, assura la continuité, mais dut composer avec la souveraineté populaire que consacreront les premières élections générales de 1951-1952, expérience gigantesque du vote. Si la Constitution prit effet le 26 janvier 1950, c'est aussi pour faire écho à la proclamation du Purna Swaraj de 1930, inscrivant l'indépendance dans une mémoire antérieure aux cérémonies. Sur le plan social, les gouvernements mirent en place des dispositifs pour récupérer les personnes enlevées lors des violences, notamment des femmes, et négocièrent, de part et d'autre, des mécanismes de protection des minorités. La planification ouvrit des instituts de technologie, développa des aciéries, finança des barrages ; le pays demeura néanmoins rural, marqué par l'inégalité des terres et la vulnérabilité aux aléas climatiques. Dans le voisinage, le Pakistan, partagé entre ses ailes occidentale et orientale, chercha un équilibre interne difficile. La ligne du Cachemire, devenue cessez-le-feu, figea des positions sans clore le différend. Ainsi le 15 août, loin d'être une fin, engagea des trajectoires : celles d'institutions qui s'enracinent, de souvenirs qui revendiquent une place civique, et d'une région où la politique, la géographie et la mémoire restent indissociables.