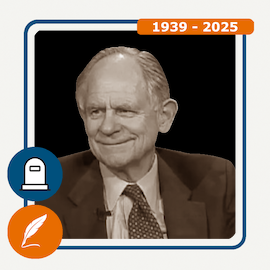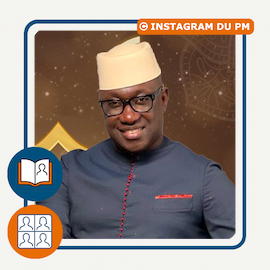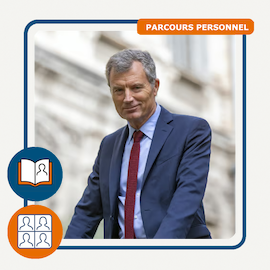HISTOIRE D UN JOUR - 16 AOUT 1960
HISTOIRE D UN JOUR - 16 AOUT 1960
Au carrefour des mers la liberté de Chypre

16 août 1960 est une date qui marque pour les habitants de Chypre l apparition d un État souverain. L île située à l angle nord est de la Méditerranée occupe un espace stratégique entre l Anatolie la Syrie et l Égypte. Depuis l Antiquité elle est un carrefour où se croisent des influences grecques phéniciennes assyriennes romaines et arabes. Plus tard les marchands vénitiens et génois y établirent des comptoirs puis les Ottomans la dominèrent pendant plusieurs siècles. Cette superposition d empires a formé une mosaïque culturelle. Au dix neuvième siècle les Britanniques prennent en main son administration et en font une base pour contrôler le canal de Suez et les voies maritimes vers l Inde. Le passé long de l île et ses multiples maîtres donnent une tonalité particulière à l événement de 1960. L indépendance ne surgit pas du néant elle est la pointe d un processus ancien.
La transition vers l indépendance est marquée par le statut colonial. En 1878 l empire ottoman confie l administration de Chypre au Royaume Uni. En 1914 la Grande Bretagne annexe l île puis en 1925 elle la transforme en colonie de la Couronne. Les habitants majoritairement orthodoxes se sentent proches de la Grèce et réclament l Enosis c est à dire le rattachement. La minorité musulmane turcophone redoute ce mouvement et préfère la continuité impériale. Dans les années quarante et cinquante la tension monte avec l émergence d organisations clandestines. La plus connue est l Organisation nationale des combattants chypriotes EOKA dirigée par George Grivas qui mène des actions armées contre les autorités britanniques. Face à elle des groupes turcs se constituent pour s opposer à l Enosis. Les britanniques répriment les insurrections et cherchent à manœuvrer entre les deux communautés. Cette période de trouble rend nécessaire une médiation internationale.
Au fil des négociations les parties acceptent de se rencontrer en Suisse et en Grande Bretagne. Les conférences de Zurich et de Londres en 1959 aboutissent à un compromis. Elles rassemblent des représentants des deux communautés et des gouvernements britannique turc et grec. Le texte préparé consacre la création d une République indépendante avec un président grec et un vice président turc. Il prévoit un parlement à majorité grecque et une minorité turque. Chacune des communautés reçoit un droit de veto. Les accords précisent que la Grande Bretagne conserve deux bases militaires à Akrotiri et Dhekelia et que des contingents grecs et turcs stationnent pour protéger leurs ressortissants. Les trois puissances garantes promettent de respecter l intégrité de l île et d interdire toute union avec un autre État.
Le jour de l indépendance la cérémonie se déroule à Nicosie devant une foule attentive. La descente du drapeau britannique et l élévation d un étendard représentant l île marquent la fin de la domination coloniale. L archevêque Makarios III est élu président et le docteur Faz?l Küçük devient vice président. Des officiers grecs encadrent la garde nationale et des soldats turcs demeurent dans leurs casernes. Dès mars 1961 la nouvelle République rejoint le Commonwealth et devient membre des Nations unies. Dans les premiers mois un climat d espoir règne et les dirigeants parlent d une ère de coopération. L élite veut moderniser l économie créer des infrastructures et donner une forme légale à des pratiques héritées de l empire. Cependant les institutions bicommunautaires apparaissent complexes et fragiles.
Les difficultés surgissent rapidement. La Constitution impose une double majorité pour adopter les lois fiscales et budgétaires et donne à chacune des communautés un droit de veto sur les affaires sensibles. Cette architecture ralentit l action publique. Des querelles naissent sur le partage des taxes des douanes et sur le contrôle des municipalités. Les turcs souhaitent des conseils locaux séparés dans les villes mixtes tandis que les grecs défendent la centralisation. Le président Makarios tente de concilier les intérêts en s appuyant sur sa double autorité religieuse et politique mais il se heurte à des rivalités internes. Les milices qui avaient combattu les britanniques ne sont pas totalement démantelées et certaines continuent d entretenir la méfiance. Les efforts pour lancer des plans économiques se heurtent à la méfiance des bailleurs étrangers qui redoutent l instabilité. La coopération entre les deux communautés se limite souvent à des accords de façade.
En 1963 le président propose treize amendements destinés à simplifier la gouvernance et à réduire les blocages. Il suggère notamment de supprimer le veto du vice président et de revoir la répartition des sièges. La communauté turque et la Turquie y voient une remise en cause du compromis. Les violences éclatent en décembre lorsque des affrontements dans la capitale dégénèrent en pogroms. Des quartiers entiers sont vidés de leurs habitants et des routes sont coupées. Les gouvernements grec turc et britannique interviennent pour imposer un cessez le feu. En 1964 le Conseil de sécurité crée la UNFICYP qui déploie des casques bleus pour séparer les combattants. Une ligne de démarcation traverse Nicosie et devient la ligne verte. Cette présence internationale se prolonge et symbolise la fracture de l île tandis que la guerre froide amplifie les tensions.
Les années suivantes sont marquées par une coexistence précaire. Au sud la majorité grecque aspire encore à l union avec la Grèce tandis qu une partie des nationalistes turcs réclame la partition. La junte militaire qui prend le pouvoir à Athènes en 1967 soutient clandestinement des groupes qui veulent réaliser l Enosis par la force. En 1974 la garde nationale chypriote appuyée par la junte lance un coup d État et remplace Makarios par un dirigeant favorable à l union. La Turquie réagit aussitôt en faisant débarquer des troupes sur la côte nord. Les combats entraînent l exode de milliers de personnes. En quelques semaines les forces turques occupent plus d un tiers du territoire. Le monde découvre des villages abandonnés des familles séparées et une capitale coupée en deux. Les négociations menées sous l égide des Nations unies aboutissent à un cessez le feu mais la division territoriale devient durable.
À la suite de l intervention turque une entité politique se constitue au nord. En 1983 elle se proclame République turque de Chypre du Nord. Aucun pays à part la Turquie ne la reconnaît. Au sud la République de Chypre reste l héritière officielle de l État né en 1960. Elle connaît une croissance rapide grâce au tourisme aux services et à l aide européenne. En 2004 la partie sud rejoint l Union européenne ce qui renforce son ancrage occidental. Sur le plan social des points de passage s ouvrent sur la ligne verte et des familles séparées se rencontrent. Les négociations internationales proposent des plans de réunification dont le plus connu est le plan Annan. Ce projet de fédération est approuvé par une majorité de chypriotes turcs mais rejeté par les grecs lors d un référendum. L espoir d une solution durable demeure car les deux communautés partagent une histoire et un territoire.
L indépendance de 1960 apparaît ainsi comme un moment charnière dans une histoire longue. Elle ne peut être dissociée de la géographie de l île qui se trouve au croisement des routes maritimes et des ambitions impériales. Elle reflète la rencontre de deux nationalismes apparus à l époque moderne et des stratégies des puissances britanniques grecques et turques. Le compromis constitutionnel de 1960 cherchait à instaurer un équilibre dans une société divisée. Sa fragilité montre que la communauté internationale ne peut imposer une architecture institutionnelle sans une adhésion profonde des acteurs locaux. Le maintien de bases militaires et de contingents étrangers témoigne de la persistance des tutelles. La lenteur des réformes et les rivalités internes montrent que la décolonisation est un processus qui s étire sur des décennies et qui ne se résout pas par un simple changement de drapeau.
Aujourd hui encore les autorités chypriotes célèbrent chaque année la proclamation du 16 août 1960. Les discours officiels rappellent l unité de l État et la souveraineté recouvrée. Des commémorations se tiennent des deux côtés de la ligne verte même si les interprétations divergent. Dans la partie sud l accent est mis sur l héritage d un pays européen et sur l injustice d une occupation. Dans la partie nord l histoire officielle insiste sur l auto détermination et la sécurité de la communauté turque. La mémoire populaire mélange nostalgie et espoir. Beaucoup de familles se souviennent d une époque où grecs et turcs vivaient dans les mêmes villages et partageaient des fêtes et des traditions. Les nouvelles générations découvrent cette histoire à l école et dans les médias. Elles aspirent à une réconciliation qui permette de dépasser les divisions et de réaliser la promesse d autonomie annoncée en 1960.
L histoire de Chypre selon une perspective de longue durée montre comment les effets du relief des réseaux commerciaux et des influences extérieures s entremêlent avec les choix des hommes. Chaque génération réinvente ses appartenances. Le chemin vers une coexistence durable reste ouvert et dépendra de la capacité des communautés à écrire un récit commun dans la paix et l égalité.