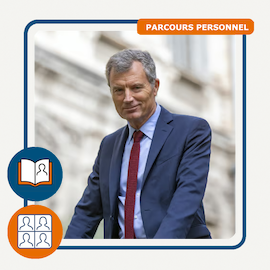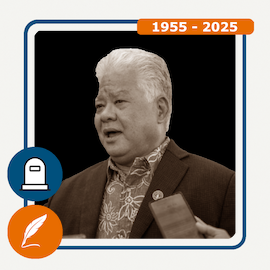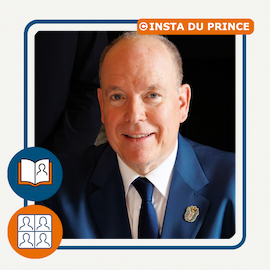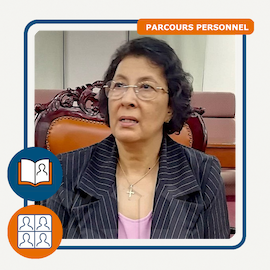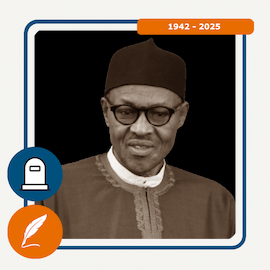FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
Albert Sarraut, le fil d'une vie entre républiques et empires
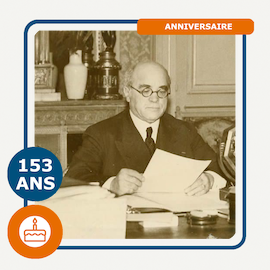
Albert Sarraut naît le 28 juillet 1872 à Bordeaux, à une époque où la Troisième République, encore fragile, cherche ses marques au lendemain des guerres et des bouleversements du siècle. Nous célébrons aujourd'hui les 153 ans de sa naissance. Issu d'une famille de la bourgeoisie provinciale, son enfance est marquée par la stabilité relative de son milieu, la rigueur de l'éducation républicaine et les premiers échos d'une France industrielle et coloniale qui s'affirme. Il hérite de son père, avocat et sénateur, le goût du débat et la passion de la chose publique. Dès ses jeunes années, la politique n'est pas un horizon lointain mais une réalité quotidienne, un sujet de conversation à la table familiale et une vocation que rien ne détourne.
C'est dans les lycées de Bordeaux puis sur les bancs de la Faculté de droit que Sarraut forge son tempérament, entre le respect de l'ordre républicain et la curiosité pour les idées neuves. Il s'attache à comprendre les mouvements sociaux, à observer les mutations économiques de la fin du XIXe siècle, et s'engage rapidement, à l'âge où d'autres hésitent encore, sur le terrain électoral. L'Aude, terre de vignobles et d'agitations sociales, devient son laboratoire d'engagement et sa circonscription fidèle. À vingt-cinq ans à peine, il entre au conseil municipal de Narbonne, bientôt maire puis député. Cette précocité n'est pas due au hasard mais à une volonté de s'inscrire dans le temps long des réformes.
La vie privée d'Albert Sarraut reste discrète, à l'image de cette génération d'hommes publics où la retenue domine sur l'exubérance. Marié à Suzanne Babut, il trouve dans ce foyer une stabilité qui tranche avec la turbulence de la vie parlementaire. Peu enclin aux mondanités, il privilégie l'efficacité du travail à l'exhibition de la réussite. Ses attaches familiales, solides, sont une ressource face aux tempêtes politiques et aux rivalités d'appareil. L'épreuve de la Première Guerre mondiale, la séparation, les pertes, forgeront chez lui une gravité nouvelle, mêlée d'une fidélité inébranlable à la République.
Dès ses premiers mandats, Sarraut incarne une figure singulière du radicalisme français : soucieux d'ordre et de justice sociale, il refuse les simplismes et les clivages trop tranchés. Dans l'Aude, il porte la voix des vignerons et des ouvriers, défendant la laïcité, l'éducation, la réforme fiscale, mais aussi la préservation de l'ordre. Sa carrière s'inscrit dans la fidélité aux grands principes de 1789, tout en se frottant sans cesse à la réalité mouvante du pays. À l'Assemblée, il s'impose par sa capacité à nouer des compromis, à tempérer les passions, à défendre les intérêts locaux sans jamais perdre de vue l'intérêt national.
L'engagement colonial marque de manière décisive le parcours de Sarraut. Nommé gouverneur général de l'Indochine en 1911, puis à nouveau après la guerre, il découvre l'Asie à une époque où la France veut faire de ses colonies un laboratoire de modernité. Sarraut croit à la mission civilisatrice, sans jamais se satisfaire des seuls mots. Il lance de grands chantiers d'infrastructure, défend l'éducation, modernise l'administration. Pourtant, il se heurte aux contradictions d'un système colonial qui prône l'émancipation sans oser l'égalité réelle. Pragmatique, il tente d'améliorer la condition des populations locales tout en consolidant l'autorité française, naviguant entre réformes et résistances, révoltes et négociations.
À son retour en métropole, il s'impose comme l'un des cadres du Parti radical. Son parcours ministériel, entamé sous la présidence de Raymond Poincaré, illustre la plasticité de la vie politique française de l'entre-deux-guerres. Ministre de l'Intérieur à plusieurs reprises, ministre des Colonies, ministre de l'Éducation nationale, Sarraut est de tous les gouvernements, ou presque. L'instabilité chronique des cabinets ne l'effraie pas ; il devient même, pour ses contemporains, un symbole de la continuité et de la compétence au sein de la République.
La période de l'entre-deux-guerres donne toute sa mesure à son action. Face aux crises économiques, à la montée des extrêmes et à la défiance envers les institutions, Sarraut privilégie toujours le dialogue et la réforme. Il refuse les aventures, combat les tentations autoritaires, tout en se montrant ferme face aux désordres. Son sens du compromis, parfois moqué comme de l'indécision, apparaît dans la longue durée comme l'un des ciments de la République. On le retrouve au cœur des débats sur la sécurité, la défense nationale, la laïcité, les rapports entre le centre et la périphérie, toujours attentif aux nuances, aux contextes, aux singularités locales.
Sarraut devient président du Conseil en 1933 puis en 1936, dans une France à la fois fière de ses traditions et travaillée par la peur du lendemain. À la tête du gouvernement, il incarne une forme de prudence active, tentant de concilier les exigences sociales et la nécessité de l'ordre. La montée du Front populaire, les conflits sociaux, les crises internationales, tout l'oblige à naviguer à vue entre les aspirations populaires et les contraintes budgétaires. Son action reste marquée par la volonté de protéger les institutions, d'éviter les ruptures et d'accompagner la société dans ses mutations, plutôt que de précipiter les ruptures ou les révolutions.
Le rapport de Sarraut à la colonisation reste complexe. Défenseur d'un réformisme colonial, il refuse autant l'abandon que l'immobilisme. Il défend une « politique indigène » d'émancipation progressive, s'efforce d'améliorer l'accès à l'instruction, à la santé, tout en maintenant la suprématie française. À l'heure où montent les revendications nationalistes, Sarraut oppose la conviction d'une modernisation venue d'en haut. Son action en Indochine, à la fois novatrice et limitée, demeure un objet de débats chez les historiens. Il illustre la tension permanente entre la promesse d'égalité et la réalité de la domination.
La Seconde Guerre mondiale vient bouleverser cet équilibre. Après l'effondrement de 1940, Sarraut, fidèle à la légalité républicaine, se retire dans la prudence, refuse de cautionner Vichy tout en gardant une distance avec la résistance active. Cette attitude lui vaut des critiques, mais aussi le respect de ceux qui voient en lui un homme de principes, réticent à céder aux passions du moment. La Libération ne le ramène pas au premier plan ; il préfère désormais l'effacement à l'agitation des nouveaux pouvoirs. Il préside néanmoins la commission de l'Instruction publique à l'Assemblée constituante, marquant par là son attachement indéfectible à l'école républicaine et à la formation des citoyens.
Jusqu'à la fin de sa vie, Albert Sarraut demeure une figure respectée, souvent consultée pour ses conseils, parfois critiquée pour sa modération. Sa longévité politique, exceptionnelle, illustre la capacité d'une génération à traverser crises et bouleversements sans jamais sacrifier l'essentiel : la continuité républicaine, le respect des institutions, la foi dans la capacité de la France à se réinventer sans rompre avec elle-même.
Le 26 novembre 1962, Albert Sarraut meurt à Paris, âgé de quatre-vingt-dix ans, laissant derrière lui l'image d'un homme d'État attaché au compromis, à la rigueur et à la justice. Son nom, intimement lié à l'histoire du radicalisme, à la défense des valeurs républicaines, à la complexité de la question coloniale, demeure aujourd'hui un repère dans le temps long de la République. Ni héros ni traître, ni révolutionnaire ni conservateur, il incarne cette France du juste milieu, où l'histoire s'écrit moins dans la fulgurance des ruptures que dans la patience des réformes, l'équilibre entre l'ordre et la liberté, la fidélité à des principes éprouvés par l'épreuve du siècle.