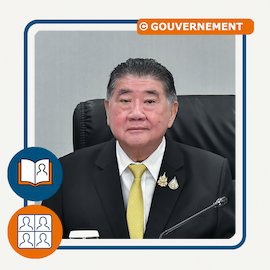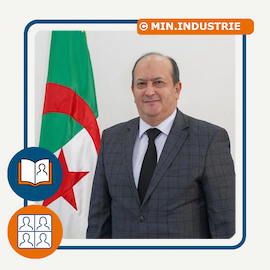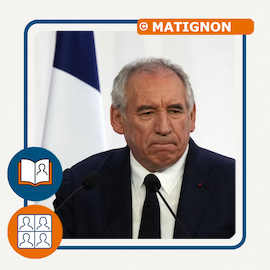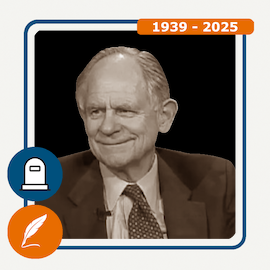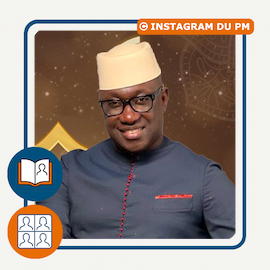HISTOIRE D UN JOUR - 3 SEPTEMBRE 1971
HISTOIRE D UN JOUR - 3 SEPTEMBRE 1971
Un émirat de mer et de désert se fait état

3 septembre 1971. À Doha, le Qatar proclame son indépendance et sa souveraineté et tourne la page du protectorat britannique.
À l’échelle de la longue durée, le Qatar est d’abord une péninsule basse avancée dans le Golfe, un monde de rivages plats, de lagunes et de vents chauds. Pendant des siècles, l’économie locale s’ordonne autour de la mer. Les boutres quittent les anses au printemps pour la pêche et surtout pour la perle. Le cabotage relie Bassorah, Mascate, Bahreïn et Bombay. Les tribus veillent sur les puits et les mouillages, et les familles marchandes articulent le commerce régional. La maison régnante des Al Thani trouve là un socle, entre arbitragistes locaux et intermédiaires de flux plus larges.
Au XIXe siècle, la projection navale britannique dans le Golfe se fixe par une série d’accords destinés à sécuriser les routes de l’Inde et à pacifier la côte. Le 3 novembre 1916, un traité confie à Londres la défense et les affaires étrangères du Qatar, tout en laissant l’administration interne au cheikh. Un nouvel accord, en 1934, renforce ce dispositif. L’encadrement impérial n’étouffe pas les autonomies locales, mais il oriente les transitions. À la même époque, l’économie perlière décline sous le choc des perles de culture japonaises et de la crise des années 1930, ce qui tarit une ressource centrale du littoral.
En 1939, on découvre un brut de qualité à Dukhan. La guerre retarde l’exploitation, mais les exportations commencent en 1949. Les années 1950 et 1960 voient surgir routes, écoles, dispensaires et ports ; elles voient aussi l’arrivée de travailleurs venus d’Iran, d’Inde, du Pakistan et d’ailleurs. La monarchie arbitre, redistribue, négocie avec les compagnies et apprend la gestion d’une rente naissante. L’État n’est pas encore souverain, mais il se fait déjà administration, multipliant règlements et services, faisant entrer la péninsule dans l’économie fossile mondialisée.
Un autre mouvement, externe, approche. À Londres, le gouvernement annonce en 1968 la fin prochaine de la présence militaire à l’est de Suez. Le cadre des protectorats du Golfe doit être démantelé d’ici fin 1971. Les entités sous protection, Bahreïn, Qatar et les sept émirats dits truciens, examinent la création d’une fédération. Sur la carte, l’idée paraît logique, mutualiser défense et représentation internationale, lisser les rivalités. Dans les salles de réunion, les questions s’accumulent. Comment régler les différends de frontières, comment répartir les sièges et les budgets, quelle capitale, quelle hiérarchie ? Au fil des mois, les délais courent et la date butoir approche.
Le 3 septembre 1971, le gouvernement qatari déclare la dissolution des engagements de 1916 et proclame l’État du Qatar. La figure décisive du moment est le prince héritier et Premier ministre, cheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, qui porte l’acte politique et administratif. L’émir régnant, cheikh Ahmad bin Ali Al Thani, demeure en retrait. Dans la perception publique, l’indépendance s’accompagne d’un recentrage du pouvoir effectif, confirmé quelques mois plus tard, en février 1972, par une transmission pacifique de l’autorité. L’État prend alors sa forme initiale, encore simple, mais résolue.
La séquence qui suit est dense. En septembre 1971, l’État est admis aux Nations unies, puis rejoint la Ligue arabe. Les représentations s’ouvrent dans les capitales clés. À l’intérieur, une constitution provisoire organise les pouvoirs ; un Conseil des ministres et un Conseil consultatif sont mis en place ; les administrations sectorielles se structurent. La dépense publique devient l’instrument majeur de la légitimation sociale. Logements, eau, électricité, santé, éducation, routes et port avancent ensemble, tandis qu’un effort de codification juridique fixe des normes nouvelles.
L’indépendance a aussi une dimension technico-économique. Les années 1960 ont ouvert de larges champs offshore de pétrole. Mais 1971 est également l’année où des ingénieurs achèvent de mesurer l’immensité d’un gisement gazier situé au nord-est de la péninsule. Ce North Field, prolongé côté iranien par South Pars, n’est pas immédiatement exploité, tant le monde regarde encore l’or noir. Il deviendra pourtant le pivot de l’économie qatarie. La logique du gaz naturel liquéfié, industrialisée plus tard, donnera au pays un atout structurel, stable et exportable à grande distance.
Dans le champ régional, le nouveau statut réordonne des dossiers lourds. Le contentieux avec Bahreïn autour des îles Hawar et de Zubarah reste vif jusqu’à ce qu’une décision internationale vienne, beaucoup plus tard, fixer une ligne. Avec l’Arabie saoudite, il faut préciser les arrangements frontaliers et organiser des coopérations de sécurité. Avec l’Iran, voisin puissant, il convient de penser les flux, d’éviter les heurts, de partager un sous-sol commun sans l’épuiser. Dans cet environnement, l’option constante est celle d’alliances de garantie et de prudence diplomatique.
La société elle-même change d’échelle. La proportion de travailleurs étrangers augmente rapidement, transformant la démographie et les pratiques urbaines. Doha s’étend, des quartiers planifiés remplacent des campements, des axes routiers structurent la péninsule, un aéroport devient nœud. De nouvelles hiérarchies salariales apparaissent, l’instruction des filles et des garçons progresse, la santé publique couvre des risques jadis banals. L’État social qui se dessine distribue rentes et services en échange d’une loyauté civique qui se concentre sur la figure de l’émir et l’efficacité de l’administration.
Sous l’angle des structures, 1971 réorganise des dépendances anciennes plutôt qu’il ne les abolit. Le protectorat avait donné cadre et protection ; la souveraineté exige désormais des capacités propres. La défense, la police des côtes, la gestion des frontières et la diplomatie deviennent des métiers nationaux. La construction d’un appareil administratif compétent s’étale sur des années, tout comme la formation d’ingénieurs, de médecins, d’enseignants et de juristes sans lesquels la rente ne se convertit pas en institutions durables.
Les incertitudes, elles, ne disparaissent pas. La démographie peu nombreuse de nationaux, la dépendance à la conjoncture énergétique, la vulnérabilité d’un territoire proche de points de friction régionaux, tout cela est visible dès l’origine. La réponse s’institue par vagues : participation accrue de l’État aux compagnies, création d’entreprises publiques, politique de subventions et d’équipements, intégration dans les organisations multilatérales, diversification prudente vers les services et la finance. La centralité de la mer demeure, mais elle s’exprime désormais par des terminaux, des navires et des accords de long terme.
Le 3 septembre apparaît ainsi comme un point de bascule. Avant, un espace protégé, maritime, périphérique, administré sous parapluie. Après, un État qui entre dans un système mondial, se dote d’instruments, se recompose au fil de ses recettes et de ses alliances. Cette transition dit quelque chose du Golfe tout entier. Dans les mois qui suivent, une fédération voisine naît à Abou Dabi et à Dubaï ; les architectures étatiques se multiplient ; le marché mondial de l’énergie donne à ces lieux une importance accrue, qu’ils convertiront en stratégies légèrement différentes.
En définitive, l’indépendance du Qatar est à la fois une rupture et une continuité. Rupture, parce qu’elle met fin à un siècle de protection et place la décision publique à Doha. Continuité, parce qu’elle prolonge des adaptations engagées depuis deux décennies et parce qu’elle reconduit la centralité de la mer et de l’énergie. Le 3 septembre 1971, un pays discret se donne un statut, puis se met à l’ouvrage. Sa trajectoire tient en une formule simple : convertir une rente en puissance d’équipement, convertir des recettes en capacités, convertir une position géographique en diplomatie.
Pour comprendre pourquoi l’union projetée avec Bahreïn et les émirats ne voit pas le jour, il faut rappeler des contraintes très concrètes qui échappent aux cartes idéales. Les frontières maritimes, encore incertaines, conditionnent l’accès à des poches d’hydrocarbures et à des bancs de pêche. Les mécanismes de représentation au sein d’une fédération soulèvent des débats sur le poids respectif d’entités inégales en taille. Les mémoires de querelles anciennes, notamment autour de Zubarah, ajoutent de la méfiance.
Les suites extérieures de l’acte du 3 septembre sont rapides. Le Conseil de sécurité recommande l’admission du Qatar aux Nations unies à la mi-septembre, puis l’Assemblée générale confirme quelques jours plus tard, et le drapeau est hissé à New York avant la fin du mois. Le pays rejoint aussi la Ligue arabe et entretient des rapports de travail avec les grandes compagnies. Dans le même temps, il consolide sa participation aux cadres pétroliers collectifs et prépare une montée en puissance de ses institutions énergétiques.
Un élément structurel pèse dès 1971 sans produire encore tous ses effets : la découverte du North Field, vaste réservoir de gaz non associé. La ressource est mesurée, cartographiée, puis apprivoisée. Quand l’ingénierie du gaz naturel liquéfié devient compétitive, le Qatar convertit ce potentiel en chaînes industrielles, ports spécialisés et flottes de méthaniers. Ce choix reconfigure sa place : moins un producteur de brut parmi d’autres, plus une puissance du gaz pour assurer livraisons.
Le 3 septembre apparaît alors comme l’origine d’un cycle long exigeant.