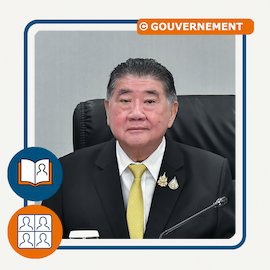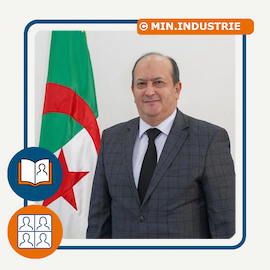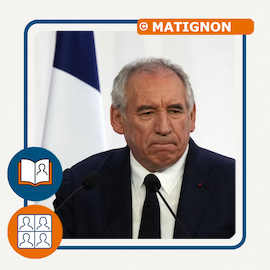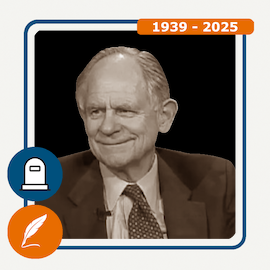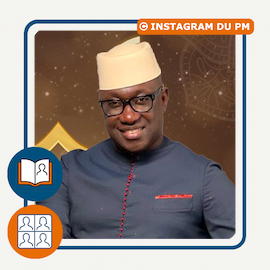ITALIE - ANNIVERSAIRE
ITALIE - ANNIVERSAIRE
Francesco Rocca, de la Croix-Rouge au Latium, l’art du possible
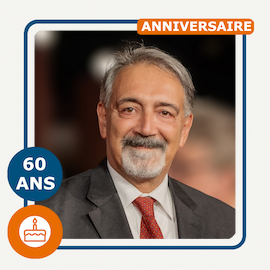
Né le 1er septembre 1965 à Rome, Francesco Rocca appartient à une génération italienne arrivée à l’âge adulte au moment où s’estompait le miracle économique et où se révélaient les fractures sociales. Il célèbre aujourd'hui ses 60 ans.
Dans la capitale, il grandit au contact de quartiers populaires où les solidarités de voisinage comptent autant que les institutions, et où l’hôpital, la paroisse et l’école dessinent encore des géographies intimes. Il parle peu de son enfance et protège sa vie privée, mais il situe volontiers ses débuts dans cette Italie centrale où Rome absorbe les énergies, attire les talents et concentre les contradictions. De cette décennie d’apprentissage lui restent un sens des réseaux, l’attention aux métiers concrets et la conviction que l’administration ne vaut que par l’exécution. Cette grammaire modeste marque sa manière de conduire les organisations, longtemps avant que la politique ne le rattrape.
Sa trajectoire n’est pas rectiligne. À dix-neuf ans, il est condamné pour une affaire de stupéfiants et purge sa peine. L’épisode, régulièrement rappelé par ses opposants, marque durablement sa réputation. Rocca l’assume comme un point d’inflexion : une faute qui n’annule pas la possibilité du rattrapage individuel par le travail et l’utilité sociale. Après des études de droit à La Sapienza, il obtient sa licence à l’automne 1990 et choisit le barreau pénal. Dans les années 1990, il défend des dossiers exposés, y compris contre des réseaux criminels, et vit une période de protection rapprochée. Le métier d’avocat lui apprend la discipline des procédures, l’art d’arbitrer entre principes et contraintes, et la nécessité de décider vite lorsque la sécurité des personnes est en jeu. Cette expérience du risque et du contradictoire nourrira plus tard sa gestion des structures sanitaires.
Parallèlement, il s’implique dans l’action sociale. Au Jesuit Refugee Service, à la Caritas de Rome et à la Piccola Casa della Divina Provvidenza, il travaille à l’accueil des réfugiés, des personnes sans abri et des malades. Il y découvre la logistique de l’aide, l’importance des bénévoles, et la valeur d’un commandement clair pendant les crises. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, il accompagne des projets hospitaliers et se forme à la gestion publique. L’Italie ayant régionalisé la santé, les administrations cherchent des profils capables d’assainir des établissements en difficulté. Rocca comprend que la bonne volonté ne suffit pas : la comptabilité, l’achat public, la gouvernance et la communication avec les syndicats forment un tout. Cette montée en compétence ferme le cycle du volontariat et ouvre celui du management.
En 2003, le président de la Région Latium, Francesco Storace, le nomme commissaire extraordinaire de l’hôpital Sant’Andrea de Rome, puis directeur général jusqu’en 2007. L’établissement, longtemps inachevé, doit être mis en service, staffé, relié aux universités et inséré dans le réseau régional. Rocca s’y forge une méthode de consolidation progressive : clarifier les responsabilités, aligner investissement et activité, publier des indicateurs simples, assumer des arbitrages impopulaires lorsque les ressources manquent. Il apprend aussi à composer avec la justice administrative, la Cour des comptes et les autorités sanitaires nationales. Cette culture de la contrainte, mêlée à un pragmatisme de terrain, deviendra sa signature. À la fin du mandat, l’hôpital a changé d’échelle et l’homme a gagné une réputation d’exécutant tenace.
En 2007, il rejoint la Croix-Rouge italienne et prend la tête des opérations d’urgence. L’année suivante, au cœur d’une réforme complexe, il est nommé commissaire extraordinaire de l’institution. En 2013, il en devient le président national et le restera jusqu’à la fin de 2022. En 2017, il est élu à la présidence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mandat renouvelé en 2022 et achevé en décembre 2023, lorsqu’il cède la place à l’Américaine Kate Forbes. Du séisme de l’Italie centrale aux naufrages en Méditerranée, de la coordination des réponses migratoires aux tensions de la pandémie, il défend une ligne faite de professionnalisation du volontariat, de transparence opérationnelle et d’appui aux sociétés nationales. Cette période internationale l’expose à la diplomatie humanitaire, aux enjeux de gouvernance d’un réseau mondial et à la communication en temps de controverse, autant d’atouts qu’il recyclera ensuite en politique régionale.
Un bref passage au Capitole complète sa connaissance des appareils publics. En 2008, sous le maire Gianni Alemanno, il dirige quelques mois le département Santé et politiques sociales de la Ville de Rome, touchant du doigt les frottements entre compétences municipales et régionales. Il assure ensuite des missions de redressement en qualité de commissaire dans d’autres structures, notamment à l’ASL Napoli 2 Nord, et siège dans des conseils d’administration hospitaliers. On le retrouve aussi à la direction d’instituts et de fondations, comme l’IDI et la Fondation San Raffaele, où il modernise des processus et assainit la gouvernance. Ce cumul d’expériences, à la frontière du social, du sanitaire et de l’administratif, dessine un profil de gestionnaire plus que d’idéologue. Indépendant, il cultive une identité d’exécutant, convaincu que la réputation d’une institution se répare par la continuité et par des résultats mesurables.
Lorsque la coalition de droite cherche fin 2022 un candidat pour reprendre la Région Latium, son nom s’impose comme celui d’un technicien de confiance. La campagne des régionales de février 2023 se concentre sur quatre leviers : désendetter, réduire les listes d’attente, fiabiliser les transports, rationaliser la gestion des déchets. Rocca l’emporte nettement, avec une majorité absolue sur fond de participation faible. Le 2 mars 2023, il est proclamé président de la Région et compose une Giunta où Roberta Angelilli devient vice-présidente chargée du développement économique, tandis que Fabrizio Ghera prend transports, mobilités et cycle des déchets. Le président conserve pour lui la Santé et la coordination des politiques sociales. Cette répartition reflète sa préférence pour un exécutif resserré, au sein duquel les dossiers structurants sont placés au plus près de la présidence afin d’accélérer les arbitrages et de lier les décisions budgétaires à des objectifs chiffrés de service public.
Dès les premiers mois, une affaire symbolique l’expose : l’allocation du patronage régional au Roma Pride 2023, puis sa révocation. La controverse porte sur le manifeste de l’événement et sur la référence à la gestation pour autrui, interdite en Italie. L’opposition crie à l’hostilité envers les droits, des associations conservatrices saluent la décision. Rocca soutient qu’il n’y a ni chasse aux minorités ni double langage, seulement une exigence de conformité aux règles posées par la Région et au cadre légal national. L’épisode politise une présidence qui se voulait d’abord gestionnaire. S’il ferme des portes avec une partie des mouvements, il renforce la cohésion de la coalition et transfère le débat vers son terrain de prédilection : les politiques publiques mesurables et les équilibres financiers qui les rendent possibles.
Sur son portefeuille clé, la santé, il déploie une stratégie d’attrition des délais. Les plateformes de réservation sont intégrées dans un système unique, des plages horaires en soirée et le week-end s’ouvrent, des achats de prestations « hors seuil » résorbent les retards critiques, les hôpitaux universitaires sont mobilisés et le reporting devient mensuel. Entre janvier 2023 et janvier 2025, les séries publiées par la Région indiquent une baisse nette du délai moyen d’accès à plusieurs examens et une hausse substantielle du nombre de prestations réalisées. L’effort porte aussi sur les urgences : triage renforcé, meilleure liaison avec la médecine territoriale, protocoles de sortie plus rapides pour les cas à faible criticité. En parallèle, la régulation des rendez-vous tente de limiter le phénomène d’annulation de dernière minute, avec des listes de rappel et une utilisation accrue des canaux numériques. Ce pilotage, très procédural, est assumé comme tel : il s’agit moins d’annoncer que d’aligner des séquences et d’en corriger les effets au fur et à mesure.
Deuxième axe, les déchets. Depuis des années, le Latium exporte une partie de ses rebuts faute d’un cycle complet. La Ville de Rome conduit, sous régime commissarial, un projet de termovalorisation. La Région revendique la planification d’ensemble : réviser le plan, répartir les charges, sécuriser des sites par province, élever la qualité de la collecte et réduire l’export. Rocca dit oui au principe de la valorisation énergétique, mais l’adjoint à des conditions de territorialisation, de contrôle d’émissions et de compensation environnementale. Il soutient une redistribution des responsabilités vers Latina, Frosinone et la province de Rome, rappelant que Viterbo ne peut être la seule sortie. En 2025, ses déclarations insistent sur la nécessité d’un calendrier crédible et d’un dialogue soutenu avec les communes. L’ambition affichée est d’éviter la dépendance extérieure, de réduire les coûts logistiques et de rendre visibles des améliorations gradualistes plutôt que spectaculaires.
Troisième chantier, les transports. La compétence régionale porte d’abord sur le ferroviaire local, les bus extraurbains et la voirie distributaire. Les achats de matériels roulants et la remise à niveau d’infrastructures vieillies doivent améliorer fiabilité et ponctualité. Des schémas de desserte sont revus pour rapprocher les correspondances des besoins réels et réduire les temps morts. Les contrats diurnes et nocturnes sont renégociés pour stabiliser l’offre. La présidence met l’accent sur la maintenance et l’information voyageurs plutôt que sur des annonces d’extension coûteuses que la conjoncture budgétaire ne permet pas. L’objectif est prosaïque : des retards moindres, des liaisons plus régulières, des routes entretenues, un service public lisible. C’est une politique de petits pas qui, si elle réussit, devrait diminuer la fatigue quotidienne des usagers et réancrer la confiance dans l’action régionale.
Au-delà des politiques sectorielles, la méthode est revendiquée comme un actif. En février 2025, à l’occasion d’un bilan de mi-mandat, la présidence met en avant la réduction des délais de soins, le renforcement des services d’urgence, des investissements ciblés sur infrastructures et numérique, et une gestion plus stricte des comptes. Des objectifs de performance sont publiés, assortis d’indicateurs de ponctualité et de volumes. Le document de programmation financière 2025-2027 cadre ces ambitions dans une trajectoire compatible avec les règles nationales et l’articulation avec le PNRR. L’exécutif insiste sur la capacité à rendre compte, à corriger et à prioriser. Il s’agit d’un gouvernement d’ingénierie publique, qui préférerait un graphique juste à une formule lyrique, et qui demande du temps pour que les résultats se disent dans la vie ordinaire : examens réalisés, bus à l’heure, contrats respectés, factures payées à délai.
Rocca gouverne aussi une coalition. Indépendant, sans carte de parti, il s’appuie sur les forces du centre droit qui l’ont soutenu. Cette position lui offre une marge d’équilibre, mais l’expose aux attentes distinctes de chaque composante, entre orthodoxie budgétaire, demandes de visibilité politique et impératifs territoriaux. Il arbitre en cherchant des compromis de fonctionnement : laisser aux alliés des espaces de politique publique, garder sur lui la Santé et des dossiers transversaux, concentrer l’attention sur l’exécution et la communication de service. Sur le plan privé, l’homme protège sa famille et évoque peu sa vie personnelle ; père de deux enfants, il se tient à distance des scènes mondaines. Son style tranche avec celui des tribuns : peu d’effets, beaucoup de notes, une préférence pour les actes administratifs plutôt que pour les grandes lois régionales. Il s’agit de corriger sans fracas, d’aligner budgets et objectifs, de remettre à niveau sans révolutionner.
L’homme continue par ailleurs de composer avec son histoire. La condamnation de jeunesse resurgit par vagues, nourrissant une interrogation morale sur l’exemplarité. Il y répond par la constance : reconnaître la faute, rappeler la peine et l’engagement social de longue durée, renvoyer aux actes présents. Cette dialectique, qui mêle rédemption individuelle et éthique de responsabilité, fait désormais partie de sa scène publique. Elle n’efface ni les critiques ni les soupçons, mais elle cadre la conversation. Pour ses soutiens, la trajectoire illustre la capacité d’un individu à se redresser et à mettre son expérience au service de structures utiles. Pour ses opposants, elle n’autorise pas l’oubli et nourrit une défiance persistante. Dans les deux cas, elle impose une exigence accrue de transparence et de mesure des résultats, que le président revendique comme une obligation de la fonction.
À la date du 1er septembre 2025, la moitié du mandat est franchie. Le Latium demeure contrasté : une capitale mondiale qui aspire l’attention et concentre les goulets d’étranglement, des provinces inégalement desservies, un littoral soumis à des tensions écologiques et touristiques, un arrière-pays à soutenir. Rocca aborde ces terrains avec une logique d’ingénierie institutionnelle : identifier les enchaînements, choisir les leviers, suivre les indicateurs, corriger rapidement. Sa présidence ne prétend pas raconter un grand récit ; elle entend démontrer que l’ordinaire gouverné produit des effets. Les prochains mois diront si la baisse des délais de soins se confirme, si le plan déchets s’arrime à un calendrier crédible et si les transports retrouvent une fiabilité perceptible. C’est à ce rendez-vous concret que se jaugera la promesse d’un mandat qui privilégie la continuité sur la rupture et le service sur le symbole.
Ainsi se dessine la figure d’un président venu du champ humanitaire. De la Croix-Rouge à la Région Latium, Francesco Rocca illustre la porosité entre tiers secteur et gouvernance territoriale. Ses soutiens y voient l’entrée du sérieux concret dans des institutions dispersées ; ses critiques redoutent qu’une neutralité affichée masque un agenda conservateur. La vérité d’un mandat se mesure pourtant à ses résultats, non aux étiquettes. À soixante ans, qu’il atteint ce 1er septembre 2025, il se tient au croisement de plusieurs temporalités : celle des institutions régionales, lentes par nature ; celle des urgences sanitaires, rapides par obligation ; celle des débats de société, intermittents et polarisants. Il avance par ajustements, comptant sur des gains cumulatifs. Si la méthode tient, elle lui offrira un récit ; sinon, elle ne sera qu’une technique parmi d’autres dans la longue durée administrative du Latium.