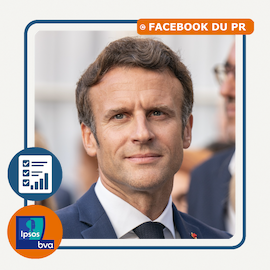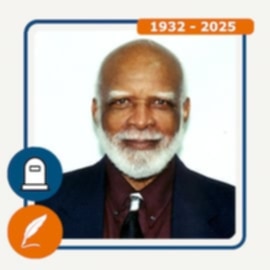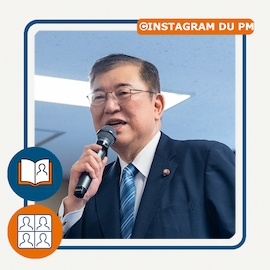ZIMBABWE - ANNIVERSAIRE
ZIMBABWE - ANNIVERSAIRE
Emmerson Mnangagwa, le crocodile du Zimbabwé

Emmerson Dambudzo Mnangagwa naît le 15 septembre 1942 dans la province de Shabani, au cœur de ce qui était alors la Rhodésie du Sud, colonie britannique marquée par les hiérarchies raciales et l’emprise de la minorité blanche. Il célèbre aujourd'hui son 83ème anniversaire.
Enfant d’une famille modeste issue de l’ethnie karanga, il grandit dans un monde où la terre est réservée aux colons et où les populations africaines sont tenues en marge du pouvoir politique. Son enfance se déroule entre la tradition villageoise et la modernité contrainte imposée par le système colonial. Très tôt, il est initié à la conscience politique par ses proches, sensibles aux humiliations de l’ordre colonial et à l’espoir d’émancipation qui germe partout en Afrique dans les années d’après-guerre.
Dans sa jeunesse, Mnangagwa reçoit une éducation primaire dans des écoles missionnaires avant que sa famille ne décide d’émigrer brièvement en Zambie, alors sous administration britannique, où il poursuit ses études. C’est là qu’il entre en contact avec les premiers cercles militants nationalistes. Il adhère aux idées de libération, et au début des années 1960, il rejoint les mouvements anticoloniaux qui contestent la domination du régime blanc de Ian Smith. La Rhodésie est alors secouée par la montée des partis nationalistes africains, le Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) de Joshua Nkomo et le Zimbabwe African National Union (ZANU), né d’une scission et qui attire Mnangagwa par sa radicalité et son orientation tournée vers la lutte armée.
Encore jeune, il reçoit une formation militaire et politique en Tanzanie puis en Chine, où il apprend les techniques de guérilla et l’idéologie révolutionnaire. De retour en Rhodésie, il participe activement aux opérations clandestines de ZANU. En 1965, il est arrêté après un attentat contre une locomotive. Âgé de 23 ans, il échappe à la peine de mort en raison de sa jeunesse mais est condamné à dix ans de prison. Ces années derrière les barreaux forgent son caractère et sa réputation. Il y côtoie Robert Mugabe et d’autres figures nationalistes, et apprend à se taire autant qu’à observer, qualités qui marqueront toute sa carrière politique.
À sa sortie de prison en 1974, il est expulsé vers la Zambie. Il reprend ses activités militaires et devient l’un des cadres de ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front). La guerre de libération, connue comme la « seconde Chimurenga », s’intensifie. Mnangagwa, en tant que chef des renseignements de la guérilla, acquiert la réputation d’un homme secret, redouté et d’une loyauté sans faille à Mugabe. Lorsque la guerre prend fin en 1979 et que les accords de Lancaster House ouvrent la voie à l’indépendance, Mnangagwa est déjà solidement installé dans les cercles dirigeants du mouvement.
En 1980, le Zimbabwe indépendant voit Mugabe devenir Premier ministre puis président. Mnangagwa obtient rapidement des postes clés : ministre de la Sécurité d’État d’abord, chargé de contrôler l’appareil sécuritaire, puis ministre de la Justice. À ce poste, il joue un rôle controversé durant la campagne militaire dite de Gukurahundi dans le Matabeleland entre 1983 et 1987, où l’armée réprime dans le sang la dissidence du mouvement ZAPU de Nkomo. Les violences font des milliers de morts. Mnangagwa, alors proche conseiller de Mugabe, est accusé par ses opposants d’avoir supervisé le renseignement qui a permis ces opérations. Cette ombre le poursuivra toute sa vie, tout en asseyant sa réputation d’homme dur et sans états d’âme.
Malgré ces épisodes sanglants, Mnangagwa poursuit une ascension méthodique. Il occupe au fil des décennies divers ministères : la Justice, les Finances, la Défense. Il est élu député de sa province de Midland et devient un pilier du ZANU-PF. Toujours fidèle à Mugabe, il est surnommé le « Crocodile » pour sa patience et sa capacité à frapper au bon moment, surnom issu de son appartenance au groupe de guérilleros « Crocodile Gang ». Il est également réputé pour son pragmatisme : il comprend l’importance d’attirer les capitaux étrangers, de maintenir une façade de légalité, et de s’appuyer sur l’appareil militaire.
Dans les années 2000, lorsque le Zimbabwe s’enfonce dans la crise économique à la suite des réformes agraires brutales, Mnangagwa joue un rôle clé dans la survie du régime. Alors que l’inflation explose et que le pays est isolé, il s’efforce de maintenir des liens avec la Chine, la Russie et d’autres pays non occidentaux. Il est aussi impliqué dans des affaires économiques controversées, notamment dans le commerce du diamant au Congo, où l’armée zimbabwéenne s’était engagée à la fin des années 1990.
La question de la succession de Mugabe hante la vie politique zimbabwéenne à mesure que le vieux président s’accroche au pouvoir. Mnangagwa se pose en dauphin naturel, mais il affronte la rivalité de la « G40 », faction du parti autour de Grace Mugabe, l’épouse du président. En 2014, il est nommé vice-président, ce qui semble confirmer son avenir. Pourtant, les tensions montent, et en 2017, il est brutalement limogé et contraint de fuir brièvement en Afrique du Sud.
L’histoire prend un tournant décisif en novembre 2017. L’armée, inquiète de la mainmise de Grace Mugabe, intervient et organise un coup de force qui pousse Robert Mugabe à la démission. Mnangagwa, soutenu par les militaires, revient au pays et prend la tête de l’État. En novembre, il est investi président, salué par une population lasse des excès du vieux dirigeant. Pour la première fois depuis 1980, le Zimbabwe connaît un changement de pouvoir, même si celui-ci reste contrôlé par le même parti et ses réseaux militaires.
À son arrivée, Mnangagwa promet une nouvelle ère : réformes économiques, ouverture aux investisseurs, lutte contre la corruption. Il se présente comme un pragmatique capable de restaurer la confiance. Mais la réalité s’avère plus complexe. Les élections de 2018, bien qu’organisées sous sa présidence, sont marquées par des violences et contestées par l’opposition. L’économie continue de souffrir d’une hyperinflation chronique, et les promesses de changement se heurtent aux structures de pouvoir établies.
Au cours de son premier mandat, Mnangagwa tente d’équilibrer les pressions. D’un côté, il cherche à normaliser les relations avec les puissances occidentales et les institutions financières internationales pour obtenir de l’aide. De l’autre, il reste prisonnier des réseaux militaires et du parti, qui exigent le maintien de privilèges et refusent des réformes profondes. Les manifestations populaires de 2019 et 2020, réprimées durement, rappellent que le régime n’a pas changé de nature : autoritaire, répressif, peu enclin à céder du terrain.
La pandémie de COVID-19 ajoute de nouvelles difficultés. Le Zimbabwe, fragilisé par des décennies de mauvaise gouvernance, peine à y faire face. Mnangagwa gouverne par décrets, renforce l’appareil sécuritaire et limite les libertés publiques. Ses opposants dénoncent une présidence qui se contente de survivre sans transformer le pays.
En 2023, il brigue un second mandat. Le scrutin, une fois encore, est critiqué pour ses irrégularités, mais il l’emporte face à l’opposition du Citizens Coalition for Change. Son second mandat s’ouvre sur les mêmes défis : une économie en crise, une société jeune et frustrée, et une diaspora nombreuse qui vote avec ses pieds en quittant le pays. En 2024 et 2025, il tente d’accélérer l’ouverture vers de nouveaux partenaires, multipliant les accords avec les Émirats arabes unis, la Chine et l’Afrique du Sud. Mais les résultats tardent à se voir dans la vie quotidienne des Zimbabwéens.
À 83 ans en septembre 2025, Mnangagwa incarne la longévité et la permanence d’un système plus que d’une vision nouvelle. Son parcours est celui d’un homme de l’appareil sécuritaire, devenu chef d’État par le jeu des équilibres internes et la force des militaires. Ses partisans le voient comme un pragmatique qui a su maintenir la stabilité et éviter le chaos après Mugabe. Ses détracteurs y voient un continuateur du même système autoritaire, incapable de rompre avec la corruption et la répression. L’histoire du Zimbabwe, depuis l’indépendance, reste marquée par ces figures issues de la guerre de libération qui conservent le pouvoir au nom de la légitimité révolutionnaire.
La vie privée de Mnangagwa est celle d’un homme discret, marié à Auxillia Mnangagwa, ancienne membre du Parlement, qui joue un rôle de Première dame active dans des programmes sociaux et caritatifs. Ensemble, ils ont plusieurs enfants, dont certains occupent des fonctions économiques et politiques, signe d’une continuité familiale dans le pouvoir.
Son héritage, encore en construction, oscille entre la promesse d’une ouverture et la réalité d’un pouvoir verrouillé. En 2025, les observateurs s’interrogent sur la suite : une nouvelle candidature en 2028 est incertaine, tant pour des raisons d’âge que de tensions internes au ZANU-PF. Mais comme souvent au Zimbabwe, l’avenir dépend autant de l’homme à la présidence que des réseaux militaires et politiques qui l’entourent.
Ainsi se dessine la trajectoire d’Emmerson Mnangagwa, fils de la Rhodésie coloniale, guerrier de la libération, homme de l’ombre devenu président, à la croisée d’un pays en quête de renouveau mais prisonnier de son histoire. Sa vie est indissociable des convulsions de son pays : de la lutte pour l’indépendance à la perpétuation d’un système autoritaire, elle incarne à la fois l’espoir de libération et la réalité d’une continuité implacable.