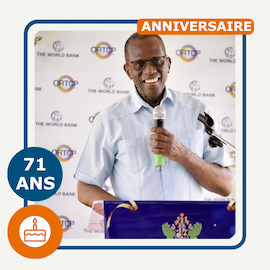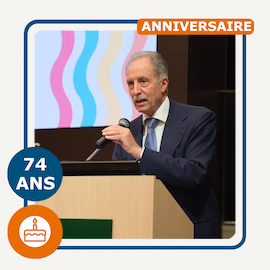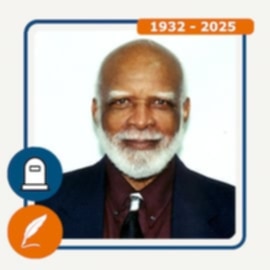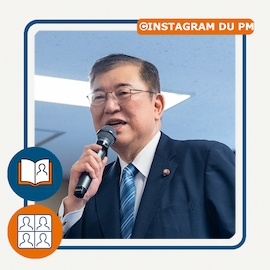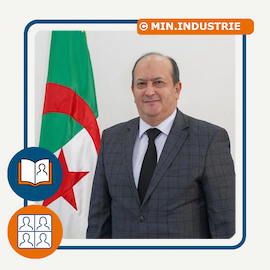HISTOIRE D UN JOUR - 18 SEPTEMBRE 2014
HISTOIRE D UN JOUR - 18 SEPTEMBRE 2014
La longue marche de la nation

Le 18 septembre 2014, le temps de l’Écosse s’est arrêté pour un jour, pour une heure même, l’espace d’un décompte méticuleux. Les horloges ont semblé cesser de tourner, figées dans l’attente d’un verdict dont les ramifications s’étendaient bien au-delà des Highlands et des Lowlands. C’était le moment de vérité, le point d’acmé d’une histoire longue, d’une lente sédimentation de l’identité. Cet événement, en apparence ponctuel et limité, fut le fruit d’un mouvement profond, d’une houle qui avait mis des siècles à se former. Il ne s’agissait pas d’une simple affaire de bulletins de vote, mais d’un dialogue séculaire entre un peuple et sa destinée, entre la mémoire et la modernité. Pour comprendre ce qui s’est joué ce jour-là, il faut remonter le fil du temps, démêler les strates qui composent le corps de la nation écossaise, depuis les actes d’union de 1707 qui unirent pour la première fois les royaumes d’Écosse et d’Angleterre.
Ceux-ci n’étaient en effet pas la simple juxtaposition de deux entités mais l’aboutissement d’un processus de rapprochement, de l'union des couronnes en 1603, à la fin de la dynastie des Stuart sur le trône d'Angleterre. Pourtant, la fusion politique n’a jamais totalement effacé les singularités. La longue durée, la structure sous-jacente des sociétés, avait préservé le droit écossais, son système éducatif et sa propre Église. Ces fondations culturelles et institutionnelles, malgré l'appartenance à un royaume commun, ont perpétué une conscience nationale distincte. C’est sur ce socle que s'est construit, au fil des siècles, un nationalisme moderne. L’idée d’une Écosse autonome a traversé le temps, ressurgissant à chaque crise, à chaque frustration. L’avènement de la « Dévolution » à la fin du XXe siècle, qui a permis à l’Écosse de retrouver un Parlement avec des pouvoirs législatifs propres en 1999, a marqué une étape décisive. Ce fut la reconnaissance politique de ce que la société avait préservé depuis bien longtemps : l’existence d’une nation. Mais pour une frange grandissante de la population, et pour le Parti national écossais (SNP) qui a su cristalliser cette aspiration, la dévolution n’était qu’une étape. L’horizon final restait l’indépendance complète.
La découverte de gisements de pétrole en mer du Nord dans les années 1970 a ajouté une dimension économique cruciale à la question. Les indépendantistes ont alors pu avancer l’argument d’une richesse nationale qui, selon eux, bénéficierait plus pleinement à la population si elle n’était pas partagée avec le reste du Royaume-Uni. Le slogan "It's Scotland's oil" (C'est le pétrole de l'Écosse) est devenu un cri de ralliement. Cette conjoncture économique a alimenté le débat, lui donnant une épaisseur matérielle qui dépassait la seule question identitaire. C’est cette combinaison de facteurs historiques, culturels, politiques et économiques qui a mené à l'accord d'Édimbourg en 2012, signé entre le Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, et le Premier ministre d'Écosse, Alex Salmond, pour autoriser le référendum. L’événement de 2014 n’était donc pas une simple impulsion, mais la manifestation visible d’un mouvement de fond, d’un temps social, le moment où les structures profondes rencontrent l’agitation de surface.
La campagne référendaire, qui a duré plusieurs mois, a été d’une intensité rare, galvanisant la société écossaise comme jamais. Les deux camps, "Yes Scotland" et "Better Together", se sont affrontés sur tous les fronts, de l'économie à la défense, en passant par le système de santé et la place de l'Écosse dans le monde. La question de l'appartenance à l'Union européenne était au cœur des débats. Le camp du "Non" a fait de cet argument l'un de ses points forts : une Écosse indépendante devrait, selon eux, quitter l'Union européenne pour ensuite déposer une nouvelle candidature, un processus long et incertain. Rester au sein du Royaume-Uni était la seule voie pour garantir la continuité de l'appartenance à l'UE. Ce fut un argument d'une force considérable, touchant le cœur d'une population qui se sentait profondément européenne. La promesse de plus de pouvoirs pour le Parlement écossais, surnommée « The Vow » (Le vœu), a été publiée par les trois principaux partis britanniques quelques jours seulement avant le vote, un ultime effort pour rassurer les indécis.
Le 18 septembre 2014, les Écossais se sont déplacés en masse. Le taux de participation a atteint un niveau exceptionnel de 84,6 %, témoignant de l'importance du choix pour chaque citoyen. Un tel engagement populaire est rare et révèle la puissance d'une question qui touchait à l'essence même de l'identité collective. Le dépouillement fut une nuit de tension, une succession de résultats qui ont tenu en haleine toute l'Europe. Les résultats sont tombés progressivement, avec des victoires pour le "Oui" dans des bastions comme Glasgow, mais le "Non" a pris l’avantage dans des régions cruciales, notamment la capitale, Édimbourg, et les régions rurales. À l'aube, le verdict était sans appel. L'Écosse a choisi de rester au sein du Royaume-Uni. Le résultat final fut de 55,3 % pour le "Non" contre 44,7 % pour le "Oui". La majorité était claire, le verdict de l'histoire, pour l'instant, rendu.
L'immédiate conséquence fut la démission d'Alex Salmond, le Premier ministre écossais, qui avait tant œuvré pour ce jour. Mais l’histoire, ce fleuve lent et puissant, ne s’arrête jamais. Les braises de l’indépendance n’ont pas été éteintes, seulement soufflées par un vent contraire. Les promesses de « The Vow » ont été en partie tenues avec le Scotland Act de 2016, qui a donné au Parlement écossais de nouveaux pouvoirs fiscaux et sociaux. L’affaire semblait close, mais comme toujours, un autre événement de la courte durée est venu bouleverser la donne de la longue durée. Ce fut le référendum sur le Brexit en 2016. Alors que le Royaume-Uni dans son ensemble a choisi de quitter l'Union européenne, l'Écosse a voté massivement pour y rester, avec 62 % des voix en faveur du maintien. Ce moment a créé une profonde divergence entre les volontés écossaises et britanniques. L'argument central du camp unioniste de 2014, à savoir que le meilleur moyen pour l'Écosse de rester dans l'UE était de rester au sein du Royaume-Uni, s'est effondré en une nuit.
Cette rupture, cette fracture politique et philosophique, a relancé de manière spectaculaire le débat sur l’indépendance. Le SNP, sous la direction de la nouvelle Première ministre Nicola Sturgeon, a pu affirmer que la situation avait changé du tout au tout, que les conditions du référendum de 2014 n'existaient plus. La majorité des sondages depuis le Brexit reflètent ce changement sismique. Si l’on regarde les sondages récents, le camp du "Oui" bénéficie désormais d’un soutien qui oscille fréquemment autour des 50 % ou plus. Cette volte-face dans l’opinion est directement liée à l’effet Brexit. Pour beaucoup d’Écossais qui ont voté "Non" en 2014 par pragmatisme, par crainte de sortir de l'Union européenne et des incertitudes économiques, la nouvelle donne les a poussés à reconsidérer leur position. Rester au Royaume-Uni signifierait être en dehors de l’Union européenne, un destin qu’ils ont explicitement rejeté. L'indépendance, dans ce nouveau contexte, n'est plus un saut dans l'inconnu mais un moyen, un chemin, de retrouver une connexion perdue avec un continent que beaucoup se sentent culturellement proches. Le vent a tourné.
Ainsi, la longue durée de l'histoire écossaise se poursuit, avec ses flux et ses reflux. L’événement de 2014 n’était qu’un point de repère, une pause dans une marche qui continue. Le passé et le présent s’entremêlent, et l’avenir, comme toujours, demeure incertain, tissé de choix passés et de conséquences imprévues. Le référendum de 2014 a répondu à la question du jour, mais n’a pas résolu les questions des siècles. Les structures de l’identité et de la politique écossaises, tout comme la relation avec le reste de la Grande-Bretagne, continuent d’évoluer, et la question de l’indépendance reste, à ce jour, plus vive que jamais dans le débat public et au sein des familles écossaises. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'Écosse peut s'en sortir seule, mais de déterminer sa place dans un monde qui change, de choisir entre deux unions.
Le petit événement de 2014 a eu des conséquences de longue durée. L'histoire, comme un océan, est faite d'une agitation de surface, de vagues qui se brisent sur le rivage, mais aussi de courants profonds, invisibles, qui déplacent des continents entiers. C'est à la lumière de ces courants qu'il faut comprendre l'évolution récente des intentions de vote en Écosse. Les résultats de 2014 ne sont pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre, où la question de l'indépendance est désormais indissociable de la place de la nation écossaise en Europe. Le temps de l’histoire s’étire, se déforme, et le passé continue d’éclairer, de façon parfois surprenante, le présent. La route est longue et sinueuse.