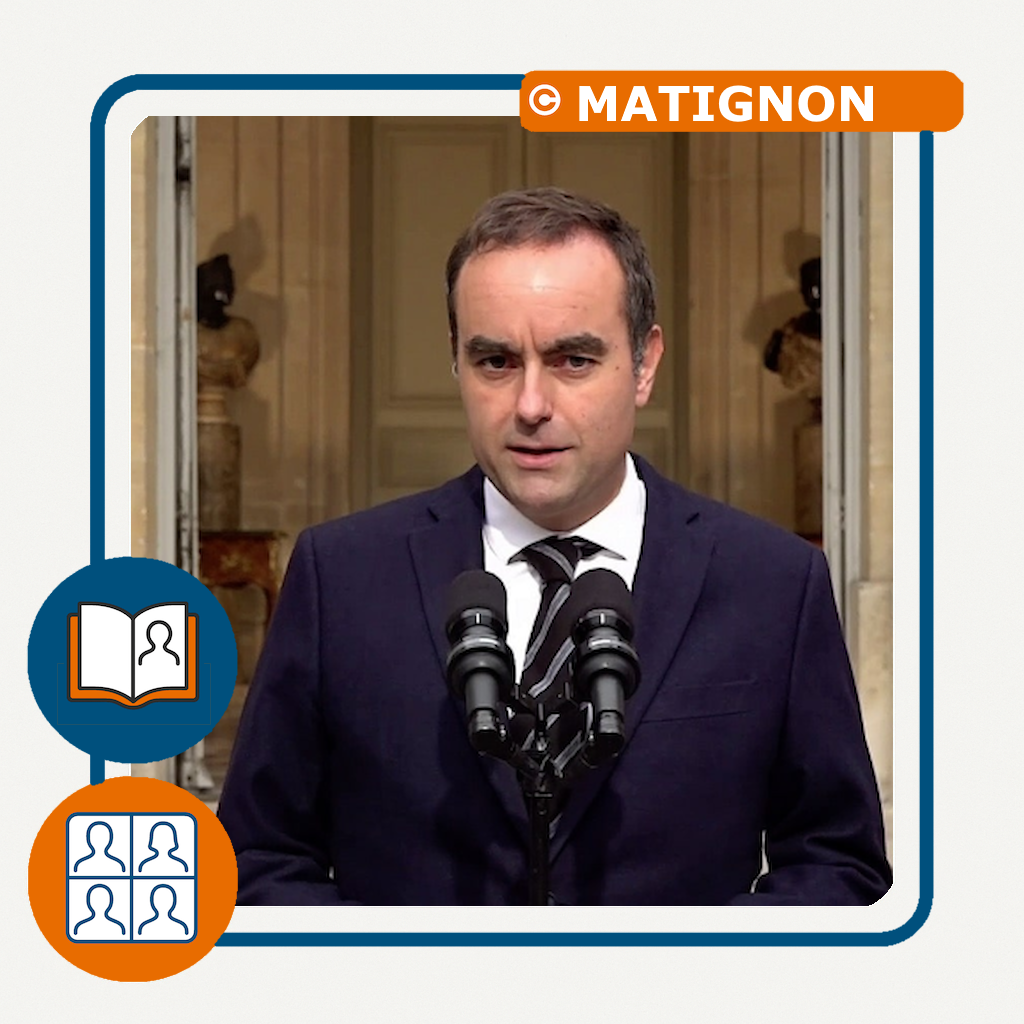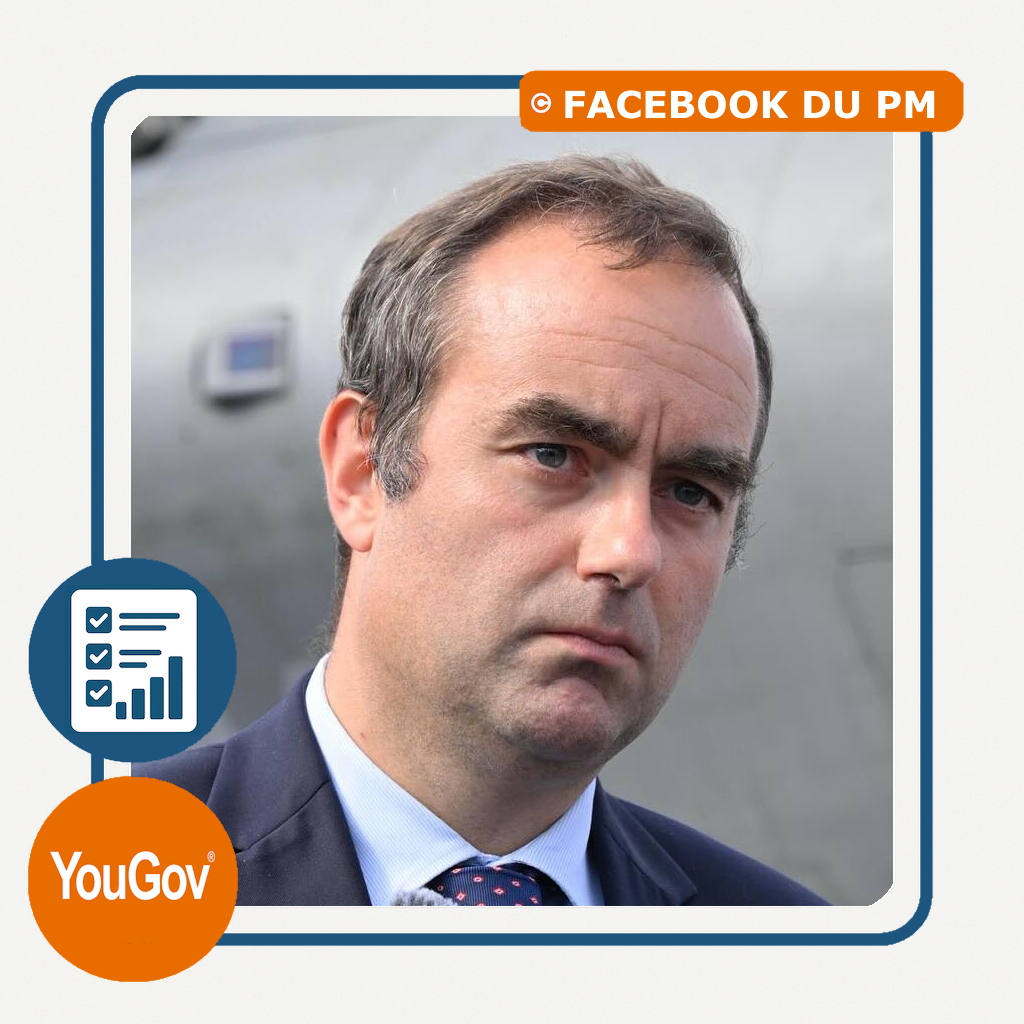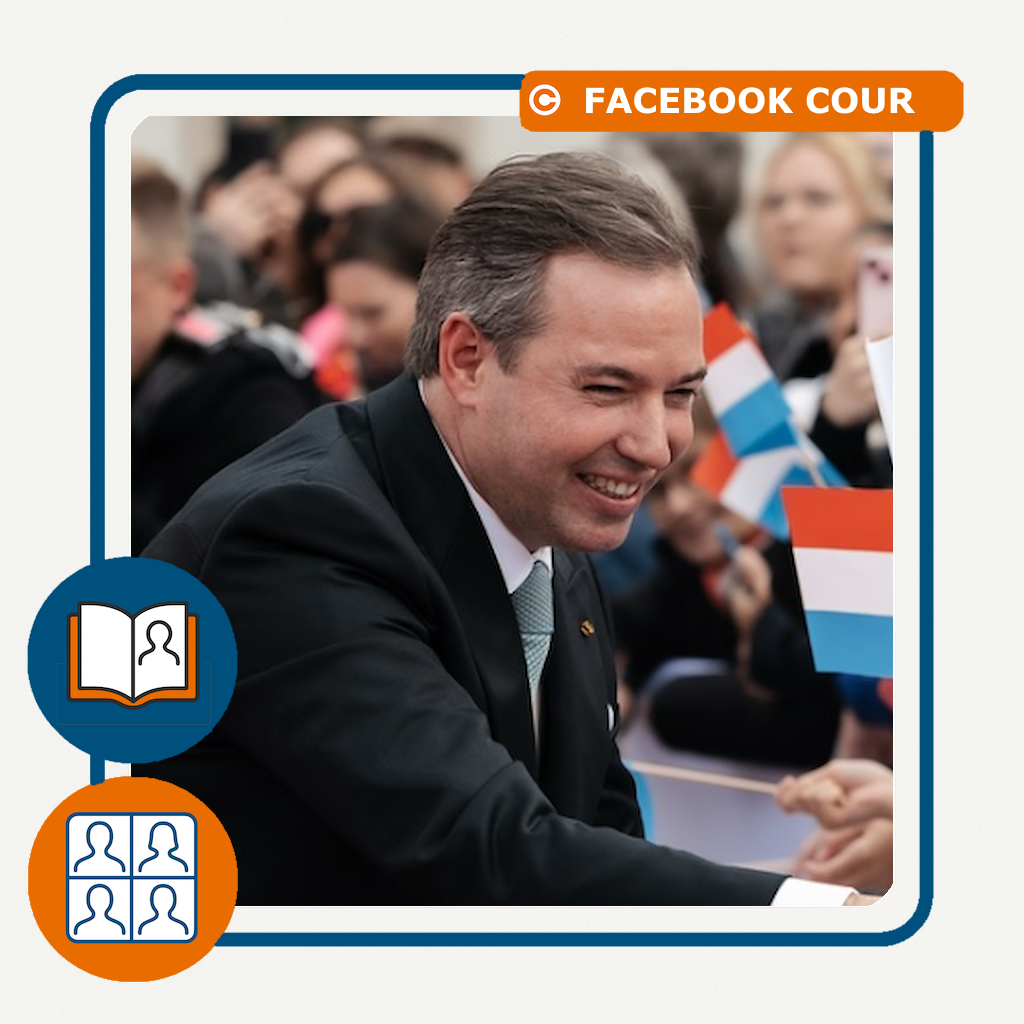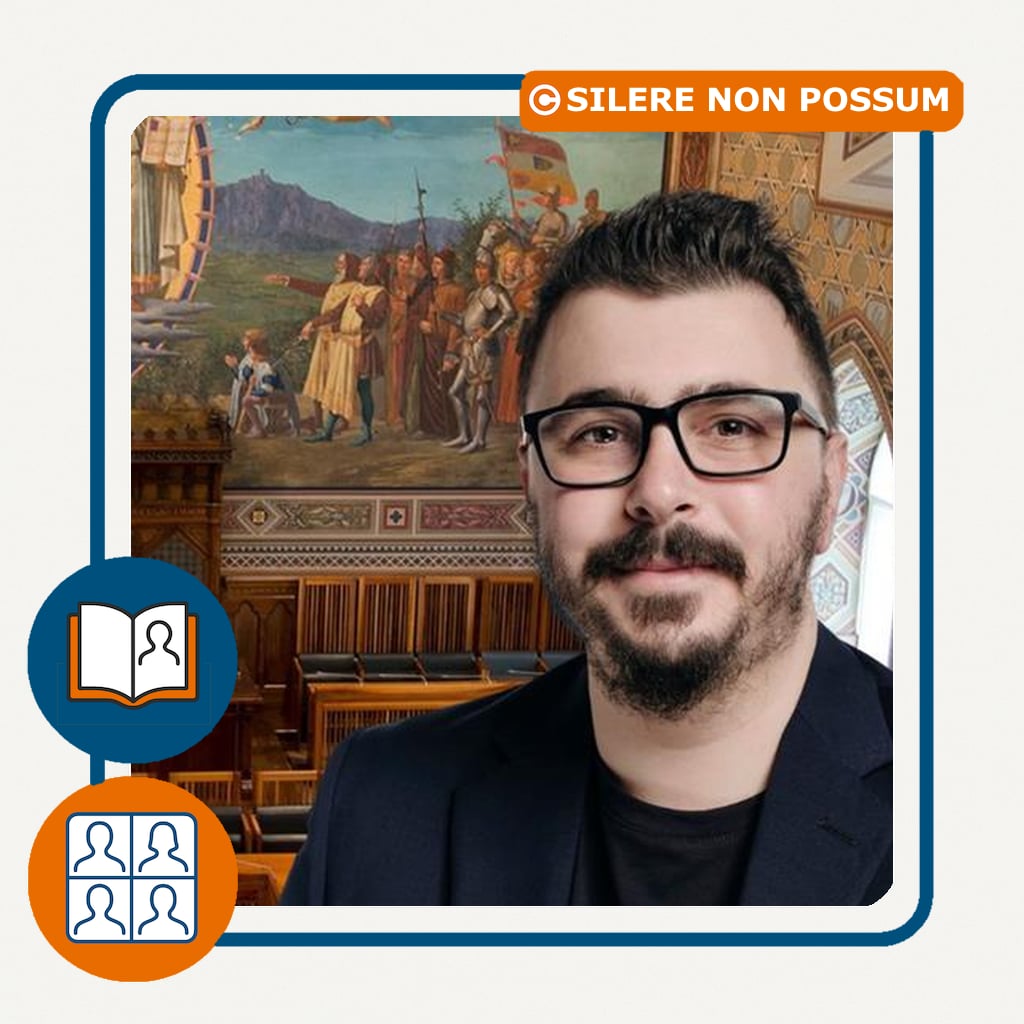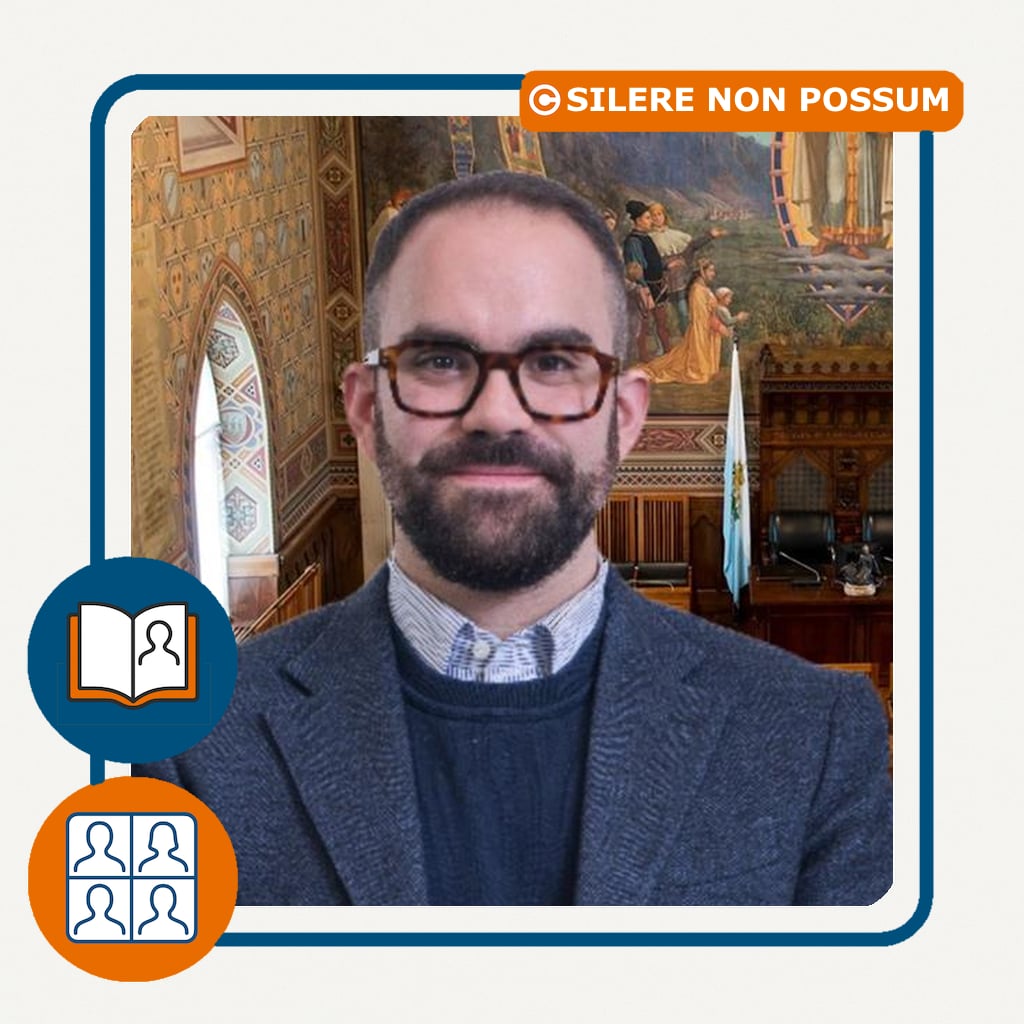RUSSIE - ANNIVERSAIRE
RUSSIE - ANNIVERSAIRE
Vladimir Poutine, menaces, annexions, silences
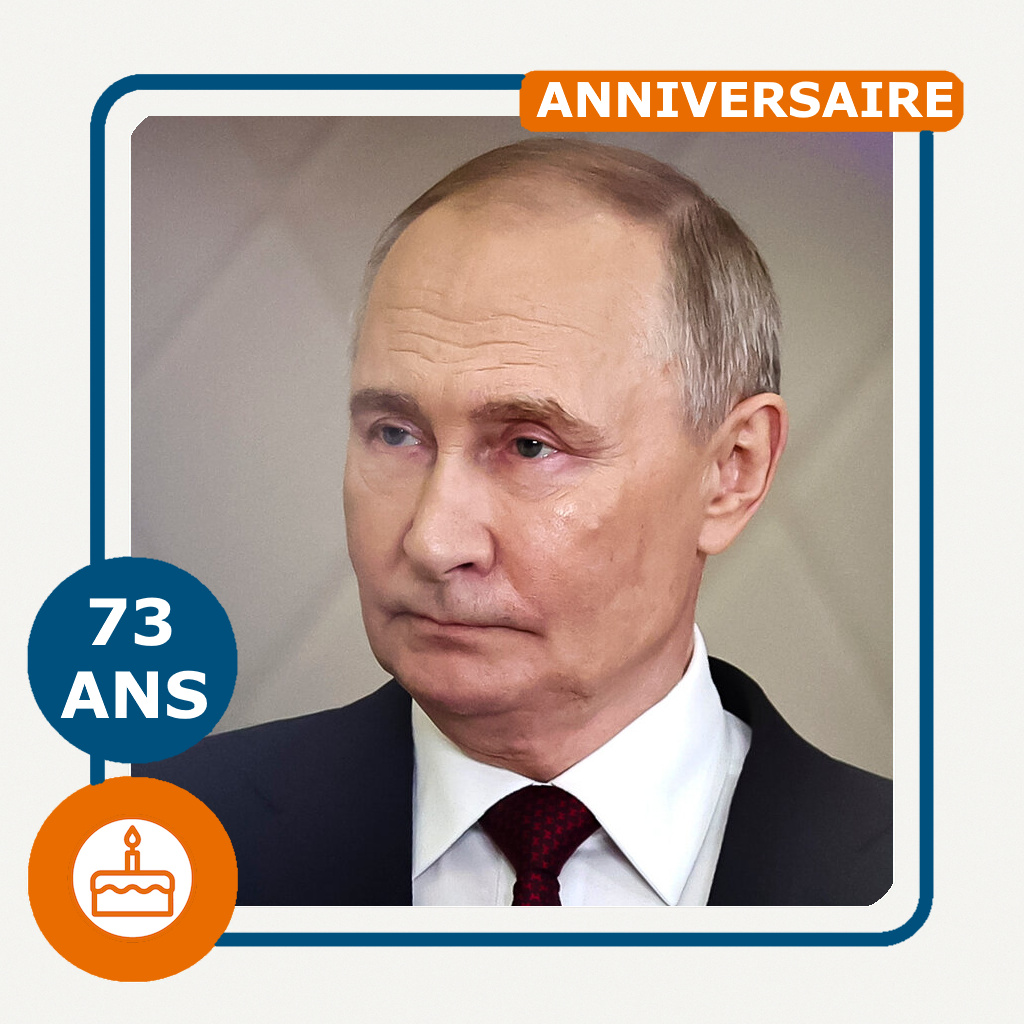
7 octobre 1952, Leningrad. Ville meurtrie par le siège, barres d’immeubles sombres, ascenseurs muets et caves froides : Vladimir Vladimirovitch Poutine y naît d’un couple d’ouvriers qui a traversé la faim et la peur. Il a aujourd'hui 73 ans.
L’enfance s’y scelle dans l’économie de moyens et la dureté, discipline du corps plus que conversation des idées. Le judo et le sambo sculptent un langage silencieux de contrôle et de riposte. Au lycée, l’obéissance prévaut sur l’insolence ; à l’université d’État de Leningrad, où il étudie le droit, l’ordre juridique soviétique s’apprend comme technique de pouvoir. Le ressort intime est déjà perceptible : l’ordre plutôt que le désordre, l’État plutôt que l’individu.
La première carrière est souterraine. Entré au KGB en 1975, il apprend procédures, patience et camouflage. Affecté à Dresde dans les années 1980, il observe la fragilité d’un empire quand le mur se fissure. Les archives brûlent, les réseaux se dispersent, l’ordre vacille. De retour, il glisse vers la politique municipale aux côtés d’Anatoli Sobtchak, maire de la ville redevenue Saint?Pétersbourg. Dossiers économiques, licences, privatisations : il administre l’accès aux ressources. Ce rôle d’interface entre capitaux, police et pouvoirs forme un apprentissage concret de la “verticale” à venir.
La vie privée se veut opaque. Marié en 1983 à Lioudmila Chkrebneva, père de deux filles, il cultive une image de sobriété et de contrôle. L’annonce du divorce en 2013 confirme que l’intime est un décor maîtrisé. Le culte de la virilité, les photos à cheval, la chasse, les bains de glace nourrissent la narration d’un chef endurant. Les rumeurs de palais, d’avoirs, d’entrelacs financiers restent démenties, mais elles révèlent un mode de gouvernement : l’opacité comme outil.
L’ascension nationale est rapide. En 1998, il dirige le FSB ; en août 1999, Boris Eltsine le nomme Premier ministre ; le 31 décembre, la démission présidentielle le hisse chef de l’État par intérim. L’élection de 2000 consacre un style : parler peu, agir vite, reconcentrer. La seconde guerre de Tchétchénie sert de matrice. Les villes sont écrasées, la rébellion qualifiée de terrorisme, la critique stigmatisée. La reprise en main des télévisions, l’écrasement des oligarques rétifs, la transformation de Russie unie en machine d’hégémonie donnent au Kremlin une voix unique.
Un premier cycle s’achève en 2008 quand la Constitution interdit un troisième mandat consécutif. Dmitri Medvedev occupe le Kremlin, Poutine redevient Premier ministre, mais la hiérarchie réelle ne trompe personne. Le retour en 2012 se heurte à des manifestations urbaines nées de fraudes perçues et d’une exaspération démocratique. La réponse est juridique et policière. Lois sur les “agents de l’étranger”, pressions fiscales, dissolutions d’ONG, harcèlement judiciaire des opposants : l’espace civique se rétracte. Les procès politiques, les listes d’“extrémistes”, les peines lourdes, installent la peur comme gouvernance.
Sur le front extérieur, la doctrine est claire : restaurer la puissance dans l’“étranger proche” et tester l’Occident. La guerre d’août 2008 en Géorgie annonce la méthode. En 2014, l’annexion de la Crimée fracture l’ordre européen. Le Donbass devient laboratoire de guerre hybride. En Syrie, à partir de 2015, l’aviation russe bombarde pour sauver le régime de Damas et réinstalle des bases. Le message est double : la Russie revient et n’hésite pas à tuer pour durer.
Le 24 février 2022, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine transforme la démonstration en rupture. L’opération éclair espérée se mue en guerre longue. Les crimes documentés, les déportations d’enfants, les villes rasées et les exécutions sommaires composent un livre noir. Des référendums sans crédibilité tentent d’annexer des territoires occupés, pendant que la machine répressive s’emballe en Russie : censure, fermetures de médias, blocage des réseaux, peines de prison pour une phrase, un post, un mot. L’État exige la guerre, la société se tait ou s’exile.
La menace nucléaire est brandie. Déploiement d’armes dites tactiques au Bélarus, exercices, ambiguïtés calculées. L’objectif est de contraindre et d’effrayer l’Europe. À cela s’ajoute un chantage énergétique : couper, relancer, tarifer, rediriger les flux de gaz et de pétrole. Les partenaires s’éloignent à l’Ouest, d’autres s’ajustent à l’Est et au Sud. Pékin marchande, New Delhi achète, Ankara négocie. Le discours anti?colonial recycle un vieux récit : la Russie assiégée par l’Occident.
La réforme constitutionnelle de 2020 scelle la longévité. Par un art légistique, les compteurs sont remis à zéro et la perspective de 2036 s’ouvre. Les élections deviennent cérémonies de ratification. La concurrence réelle disparaît sous invalidations, exil ou prison. L’empoisonnement d’Alexeï Navalny, son retour, ses condamnations multiples, puis sa mort en détention résument l’option choisie : aucune alternative. Le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, l’accusant de crimes de guerre pour déportation d’enfants ukrainiens, inscrit son nom dans une liste infamante.
L’économie suit une logique de siège. La rente des hydrocarbures finance l’effort militaire, la substitution aux importations s’improvise, des circuits gris contournent les sanctions. Les inégalités se creusent, les budgets sociaux se subordonnent, la démographie s’érode, l’exode des diplômés accélère. Le centre exige des régions loyauté et contributions ; en échange, il garantit l’ordre. Le fédéralisme devient un vocabulaire. La Tchétchénie sert de fief utile tant qu’elle fournit hommes et menace.
La culture politique orchestrée par le Kremlin s’ancre dans la mémoire et la peur. La mémoire sacralise la “Grande Guerre patriotique”. La peur se nourrit de l’ennemi intérieur et d’un Occident supposé dissolvant. L’Église orthodoxe, partenaire idéologique, légitime la notion de “civilisation russe” assiégée. Les manuels réécrits, les médias alignés, les procès pour “discréditation” de l’armée composent une pédagogie de l’obéissance. La police des mots tient autant que la police des corps.
Les relations personnelles du président structurent l’appareil d’État. Anciens des services, camarades de Saint?Pétersbourg, managers d’entreprises publiques, gouverneurs loyalistes : la pyramide repose sur confiance et crainte. Les morts suspectes de figures critiques, les “accidents” et défenestrations entretiennent un halo de menace. Le pouvoir nie, mais l’effet révèle la cause la plus plausible : un système qui rend la dissidence coûteuse et parfois mortelle. L’affaire Litvinenko, l’empoisonnement de Skripal, l’assassinat de Boris Nemtsov près du Kremlin, renforcent l’idée d’un État qui punit au?delà de ses frontières.
La trajectoire internationale confirme l’ambivalence. La Russie se veut puissance révisionniste, mais dépend d’achats asiatiques et de circuits parallèles. Elle cherche à intimider l’Europe par la guerre aux frontières et l’ombre nucléaire, mais renforce la cohésion de ses adversaires. Elle invoque le droit international quand il lui sert et l’écrase quand il contrarie son projet. Les sanctions l’isolent partiellement, mais l’économie mondiale offre des échappatoires que Moscou exploite.
Reste la biographie intime, où l’homme pèse sur le temps. Le sportif méthodique, l’amateur de chiens, le chef qui écoute en silence et tranche sans débat : la figure est celle de la maîtrise. Mais la maîtrise a un prix. Le sang sur ses mains n’est pas une métaphore ; il découle de décisions assumées. Tchétchénie, Géorgie, Syrie, Ukraine, prisons, escadrons, tortures, déportations et exodes : une géographie de violence couvre un quart de siècle. Les dénégations officielles ne l’effacent pas.
Dans la longue durée, trois lignes se croisent. La première est celle d’un État obsédé par sa sécurité et sa grandeur. La deuxième est celle d’un chef dont la vocation première fut la surveillance, qui gouverne par la peur et l’opacité. La troisième est celle d’un monde où la guerre redevient instrument ordinaire. L’Europe, rappelée à l’histoire, réarme, se sevre du gaz russe, accélère ses alliances. La menace nucléaire, proférée pour effrayer, n’est pas une simple rhétorique ; elle encadre désormais la stratégie.
La fin reste ouverte. Poutine a modifié la Constitution pour prolonger son règne, mais le temps biologique ne se légifère pas. La guerre a soudé des fidélités et créé des intérêts, mais aussi des fractures. Le pays s’habitue à la censure, mais aussi à l’absurde. La Russie n’est pas réductible à son chef, et pourtant tout y passe par lui. Politique étrangère, économie, culture, justice : un centre, des cercles concentriques, un flux d’ordres. Si le système perdure, c’est qu’il combine redistribution, peur et récit national.
Ainsi se conclut provisoirement la vie d’un homme qui aura confondu sa trajectoire avec celle de l’État. L’enfant de Leningrad, l’officier du KGB, le maire adjoint prudent, le Premier ministre loyal, le président décidé, le chef de guerre. L’ordre intérieur a été payé par la peur, la puissance extérieure par la guerre. Les menaces proférées contre l’Europe et les allusions nucléaires disent la volonté de tenir quoi qu’il en coûte. La dignité des victimes, ukrainiennes, russes, syriennes, caucasiennes, rappelle l’exigence de vérité et de justice.
En 2023, la mutinerie avortée de Wagner révèle fissures d’un système de loyautés armées. La mort d’Evgueni Prigojine rappelle le sort des instruments devenus encombrants. En 2024, une présidentielle sans pluralisme le reconduit, tandis que la guerre absorbe budgets et vies. L’ordre intérieur se durcit, la justice devient instrument, la propagande comble vides. La Cour pénale internationale maintient son mandat d’arrêt, l’accusant de crimes de guerre pour déportation d’enfants ukrainiens.