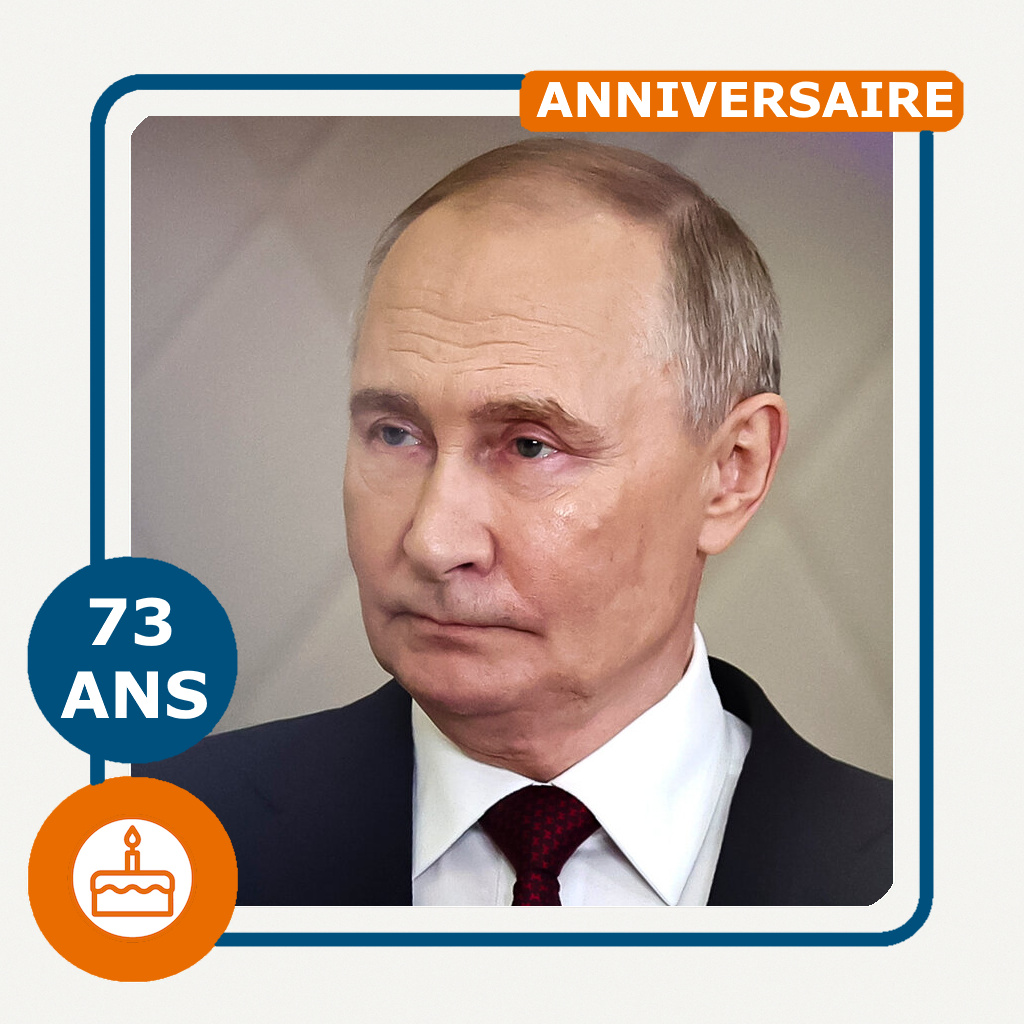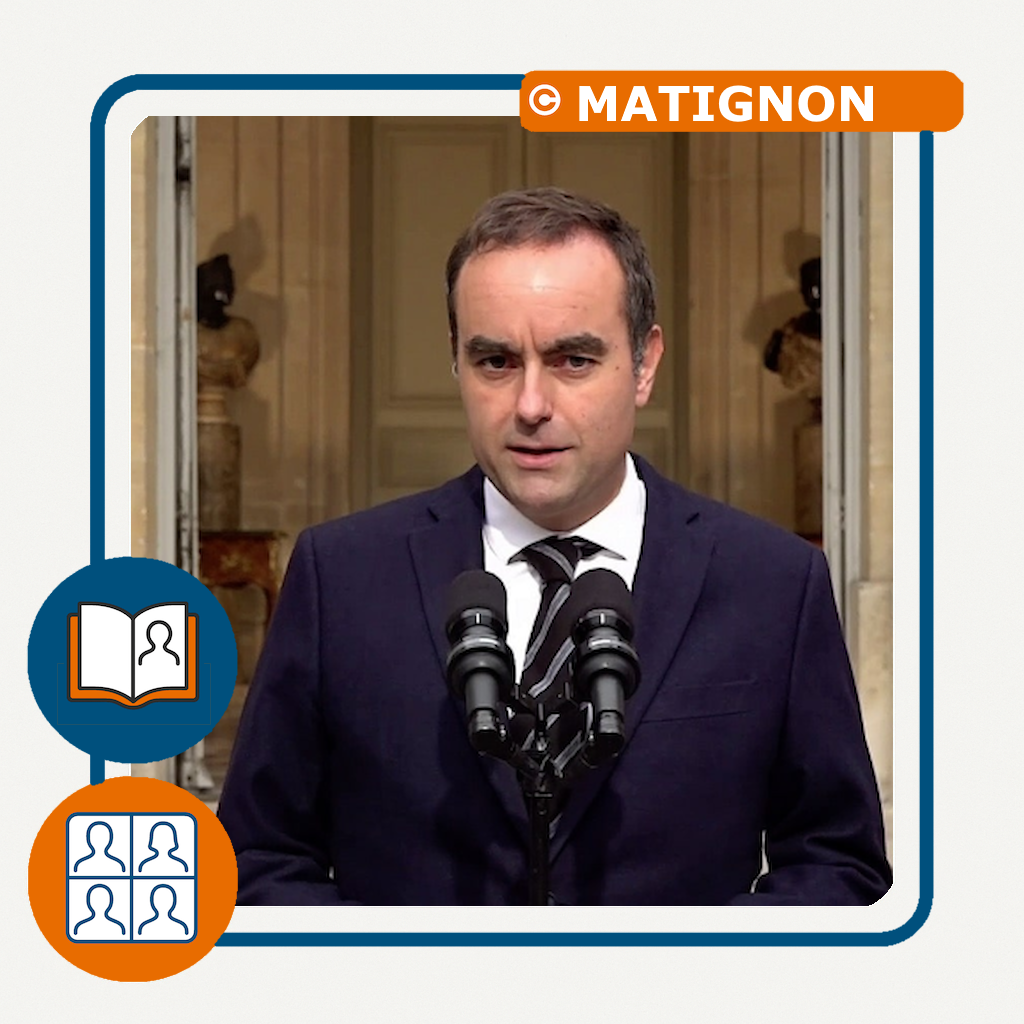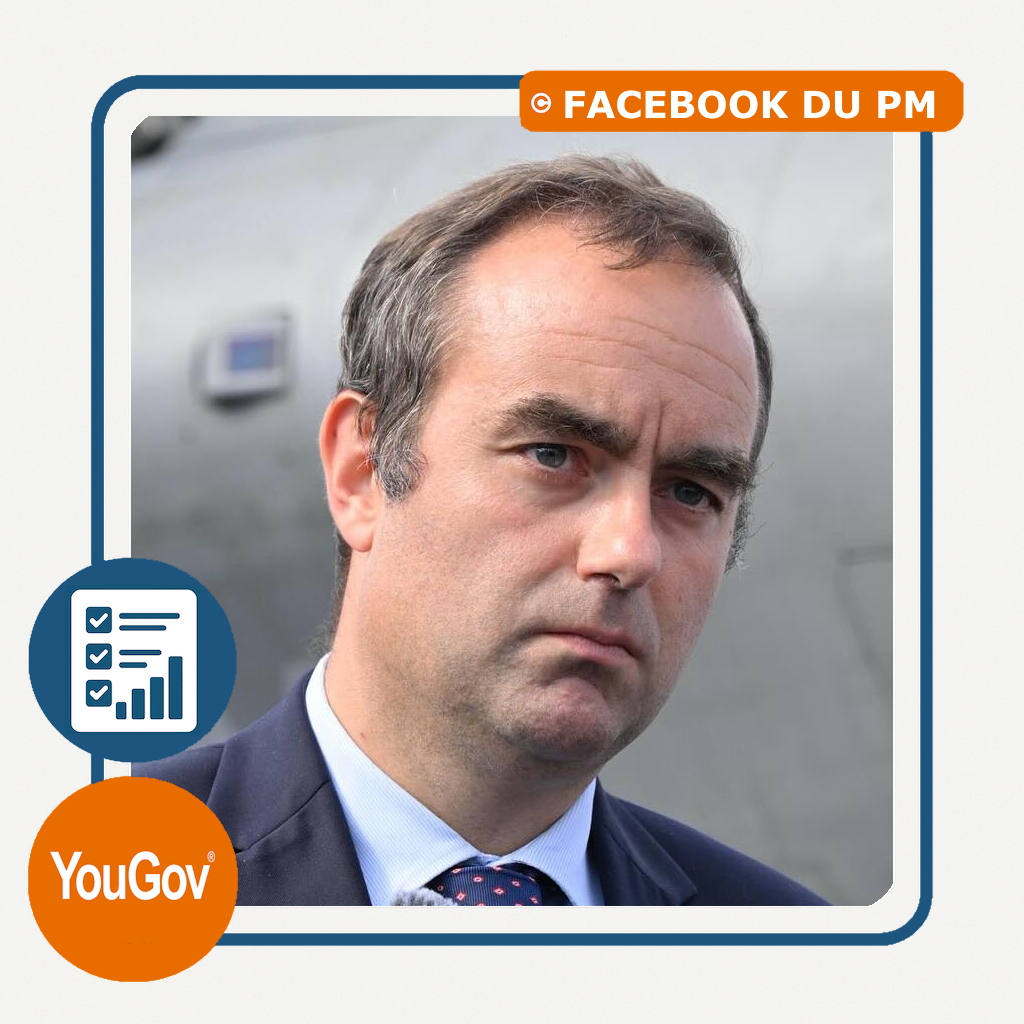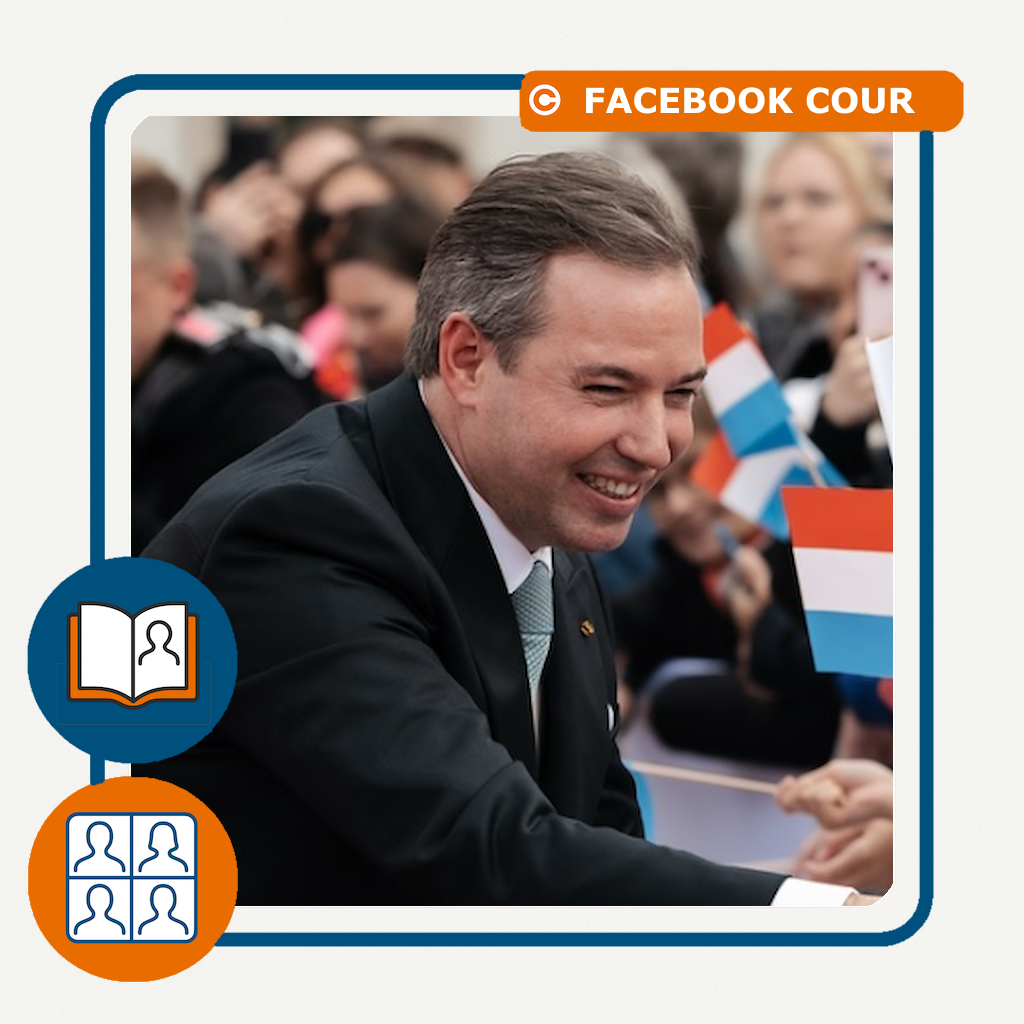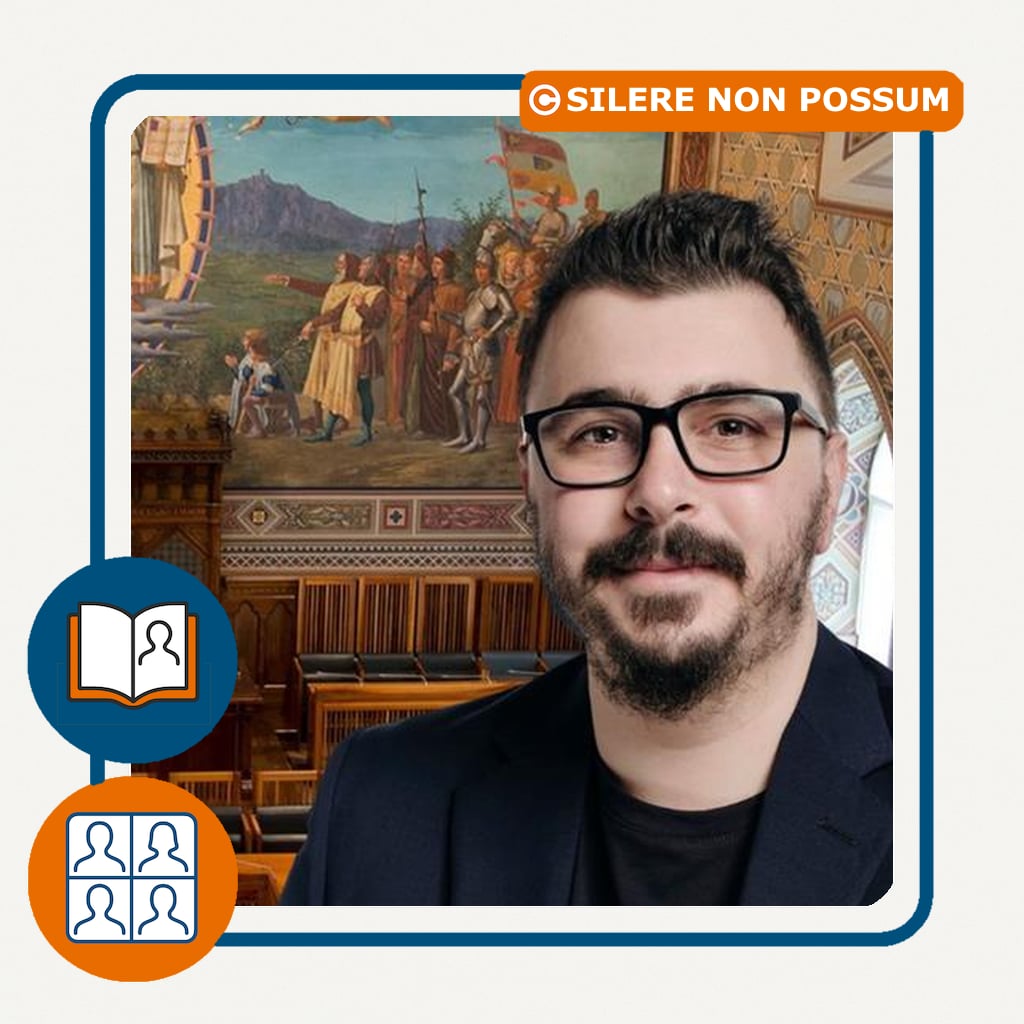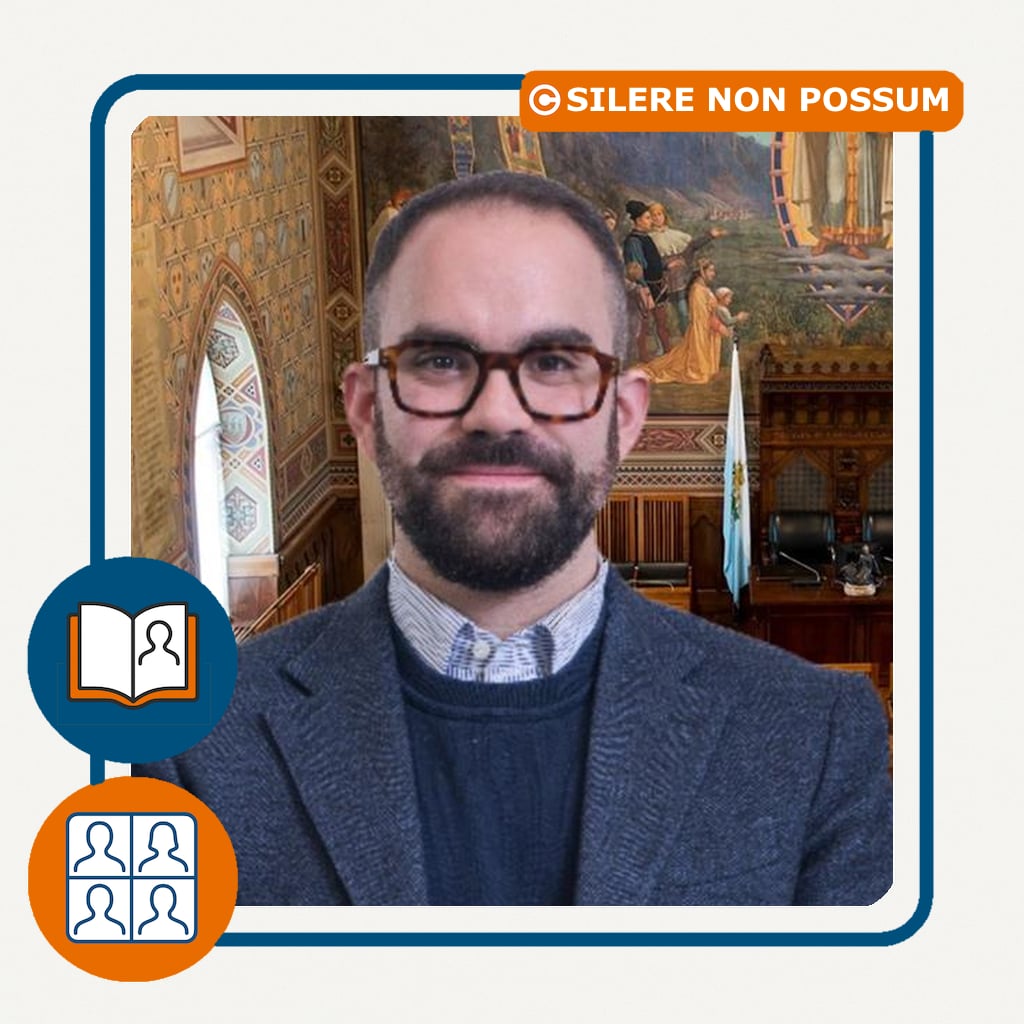GUATEMALA - ANNIVERSAIRE
GUATEMALA - ANNIVERSAIRE
Bernardo Arévalo, l’artisan des procédures

Né le 7 octobre 1958 à Montevideo, en Uruguay, César Bernardo Arévalo de León naît dans l’exil imposé à sa famille après les ruptures politiques du milieu du siècle. Il fête aujourd'hui ses 67 ans.
Son père, Juan José Arévalo, président réformateur de 1945 à 1951, a quitté un Guatemala happé par la logique de la guerre froide. L’enfant grandit loin des volcans, entre Uruguay, Venezuela, Mexique et Chili. Il ne découvre la capitale qu’à l’adolescence, avec le sentiment d’arriver dans une histoire déjà commencée. La mémoire domestique, mémorial d’une réforme avortée, coud un fil entre l’absence et l’attente: un territoire, c’est une promesse de citoyenneté à reconquérir.
À Jérusalem, où il étudie la sociologie et l’anthropologie sociale, il apprend la discipline des concepts et la patience des méthodes. L’hébreu et l’anglais deviennent des instruments de travail. À Utrecht, un doctorat en sociologie l’initie à l’architecture des preuves, aux enquêtes serrées, aux hypothèses qui se testent sur le long terme. Cette formation n’est pas une parenthèse académique: elle construit un outillage pour penser les institutions, leurs inerties et leurs zones de réforme, et elle lui donne une langue commune avec des praticiens d’autres continents.
La diplomatie lui offre ensuite un terrain d’application. Dans les années 1980, il entre au ministère des Affaires étrangères, sert à l’ambassade en Israël comme premier secrétaire et consul, puis comme conseiller. Revenu à Guatemala, il dirige des directions techniques, devient vice?ministre des Relations extérieures en 1994 et ambassadeur en Espagne en 1995. C’est l’école des communiqués pesés et des négociations millimétrées, où chaque verbe engage et chaque virgule oriente. À Madrid, il mesure la force des protocoles et des alliances, ces infrastructures invisibles de la vie internationale.
Après ces années d’État, il s’engage dans l’ingénierie de la paix. Interpeace, héritière d’une impulsion onusienne, l’emploie durant deux décennies. Il y conçoit des diagnostics participatifs, des cartographies des conflits, des médiations locales, des programmes de professionnalisation policière. Son métier consiste à faire parler des acteurs qui s’évitent, à construire des procédures crédibles, à ancrer les dispositifs dans les territoires. Cette pratique laisse une empreinte durable: écouter avant de prescrire, modéliser sans rigidifier, agir avec les acteurs qui vivront les résultats. L’éthique de procédure devient sa signature.
Puis 2015 survient, avec l’affaire de La Línea, la démission d’un président et des places pleines de citoyens. Un groupe d’analyse se constitue, renomme ses ambitions, devient mouvement puis parti: Semilla. Arévalo s’y engage non pour rejouer la geste familiale, mais pour accorder l’indignation à des règles. La politique n’est pas un cri, c’est une organisation de la responsabilité. En 2019, élu député sur la liste nationale, il apprend la mécanique parlementaire: commissions, rapports, alliances ponctuelles, usage méticuleux des budgets et du contrôle. Une posture se clarifie: gouverner, c’est construire des procédures qui résistent aux opportunités du moment.
La campagne présidentielle de 2023 le propulse au centre d’un champ saturé de lassitude. Donné marginal dans les sondages, il surprend au premier tour et, au second, agrège un vote urbain et jeune, des réseaux citoyens, des soutiens indigènes et des classes moyennes fatiguées des arrangements. La victoire est nette; elle exprime moins une conversion idéologique qu’une demande d’État honnête. Elle déclenche aussitôt une contre?offensive judiciaire: enquêtes sur les signatures de Semilla, tentatives de suspension du parti, procédures destinées à disputer le verdict des urnes. Dans les rues, les communautés indigènes gardent pacifiquement les institutions électorales.
Le 14 janvier 2024, il accède à la présidence après une journée de manœuvres et un serment prononcé tard dans la nuit. La vice?présidente Karin Herrera, scientifique et universitaire, incarne un pari: relier connaissances et décision publique. Le cabinet, construit avec une parité revendiquée, mêle profils techniques et expériences venues d’horizons distincts. La priorité est claire: reconstruire les mécanismes de contrôle, réviser les procédures d’achats, publier des codes de conduite, remettre les audits au cœur de l’action gouvernementale. La promesse est une promesse de méthode plus qu’un répertoire de gestes spectaculaires.
La résistance institutionnelle se manifeste vite. En 2024, des requêtes cherchent à lever l’immunité du chef de l’État; d’autres ciblent des ministres, d’autres encore le parti. Arévalo répond par la conformité procédurale et des décisions rapides. Il limoge, moins de cent jours après son investiture, une ministre mise en cause pour usage indu de moyens, et rappelle la règle: l’intégrité n’est pas négociable. Ce langage s’adresse à l’appareil comme aux soutiens. Il signifie que la loyauté attendue n’est pas personnelle, mais encadrée par des normes.
Sur le plan social, l’agenda privilégie les biens fondamentaux. L’économie reste contrainte par l’informalité, la dépendance aux envois de fonds et une base fiscale étroite. L’action publique avance donc par incréments: consolidation d’écoles, rééquipement de centres de santé, assainissement des chantiers routiers, procédures de passation clarifiées. La sécurité, confiée à une équipe soucieuse de professionnalisation, vise la lutte contre la corruption policière et la protection des communautés plutôt que la rhétorique de la force. Ces choix ne font pas spectacle; ils misent sur la robustesse silencieuse des routines.
Sur la scène extérieure, il choisit la continuité avec Taïwan et multiplie des coopérations concrètes. Cette fidélité, devenue rare dans la région, produit des appuis techniques et un capital symbolique. Guatemala se présente aussi comme allié des régimes démocratiques, soucieux des règles et attentif aux dérives autoritaires. L’expérience internationale antérieure, de la médiation à l’analyse institutionnelle, fournit une grammaire de stabilité. La politique étrangère s’aligne ainsi sur la promesse interne: un État prévisible, qui honore ses engagements.
Reste la profondeur des structures. La justice demeure traversée par des fidélités anciennes, des magistrats aux mandats prolongés, des bureaux solidaires d’intérêts qui redoutent les enquêtes. Une partie du Congrès est tenue par des coalitions clientélistes. Les appareils de sécurité alternent entre tentatives de réforme et inerties d’organisation. Dans ce champ de forces, l’exécutif cherche des marges: professionnalisation des services, appels aux municipalités capables d’exécuter proprement, partenariats avec des acteurs sociaux qui gardent la pression. L’État ne se défait pas d’un trait; il se réapprend par l’exemple.
Dans ce récit, l’héritage familial compte sans gouverner. Être le fils d’un président réformateur n’ouvre aucune voie royale, mais donne une mémoire des possibles. Arévalo n’en fait ni totem ni fardeau. Il y puise une conviction: les réformes durent lorsqu’elles deviennent des habitudes citoyennes. Les mobilisations indigènes de 2023, gardiennes pacifiques de l’issue du scrutin, ont rappelé qu’une démocratie est une surveillance continue. Le pouvoir cesse d’être un butin lorsqu’il est tenu en laisse par des citoyens informés.
Au fil de 2024 et 2025, l’affrontement avec le ministère public imprime un tempo heurté. Sommations judiciaires, annonces spectaculaires, controverses répétées cherchent à user la légitimité présidentielle. La réponse demeure procédurale et patiente: recours constitutionnels, coopération internationale, obstination administrative. Des initiatives anticorruption, y compris une commission dédiée au sein de l’exécutif, recueillent et transmettent des plaintes, documentent des irrégularités, encouragent la conformité. La visibilité de ces dossiers rappelle qu’une administration qui stocke, classe et publie commence à reconstruire l’État.
Ainsi se dessine une cohérence: de l’enfance d’exil au diplomate, du praticien de la paix au législateur, puis au chef de l’État, la même méthode persiste. Elle refuse le miracle, lui préfère l’artisanat institutionnel. Dans un pays que des décennies de prédation ont rendu méfiant, cela peut paraître modeste; c’est peut?être la seule voie praticable. La reconstruction d’un État est une affaire de gestes répétés, de contrôles, d’archives tenues, d’équilibres comptables, de respect des procédures et d’apprentissage collectif.
L’avenir demeure ouvert. Les procès diront une part des limites, les cycles économiques une autre, les alliances politiques le reste. Mais si la présidence parvient à faire entrer la règle dans l’habitude, à substituer aux connivences la prévisibilité d’institutions lisibles, alors le pays aura gagné plus qu’un gouvernement: une méthode d’État. Arévalo tiendra la promesse implicite de sa trajectoire, celle d’un praticien qui sait que les grandes transformations s’obtiennent par la persistance de petits changements loyaux.
Pour mémoire, son élection du 20 août 2023, avec près de 58 pour cent des suffrages face à Sandra Torres, a clos une campagne minée par des exclusions et des recours. La vice?présidente Karin Herrera, biologiste, incarne l’articulation entre science et décision. Le cabinet formé en janvier 2024 se voulait paritaire et technique; l’Intérieur revint à Francisco Jiménez, la Diplomatie à Carlos Ramiro Martínez. En 2025, une visite d’État à Taïwan a confirmé cet ancrage. Sur l’anticorruption, des dizaines de plaintes ont été recensées, visibles et suivies désormais.