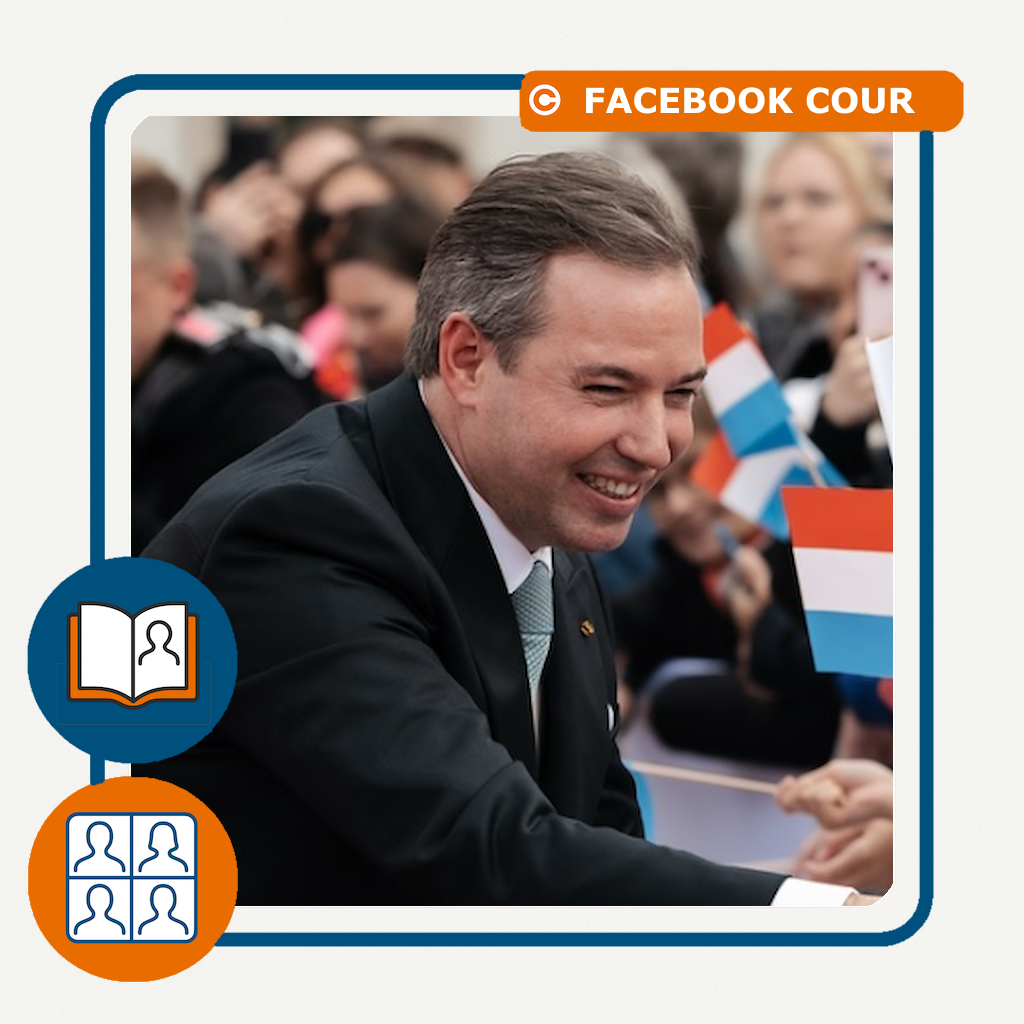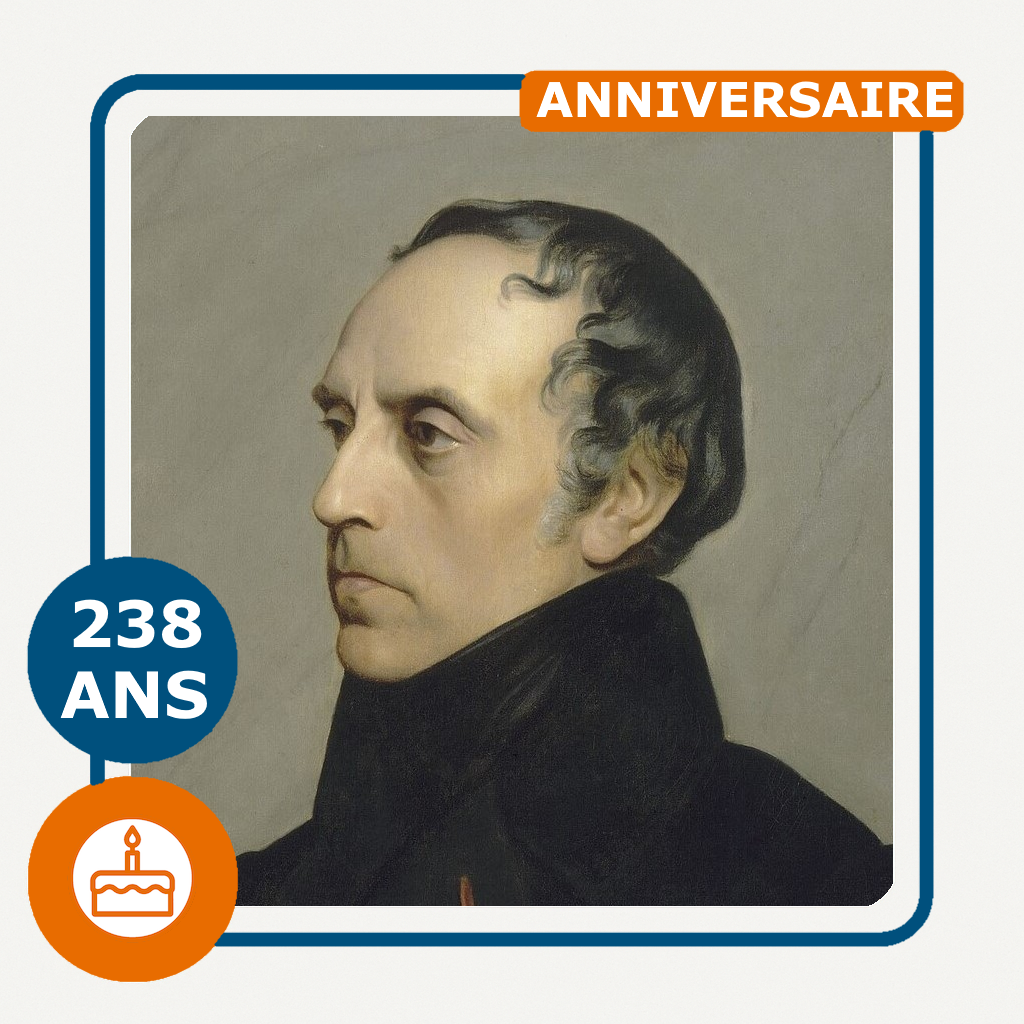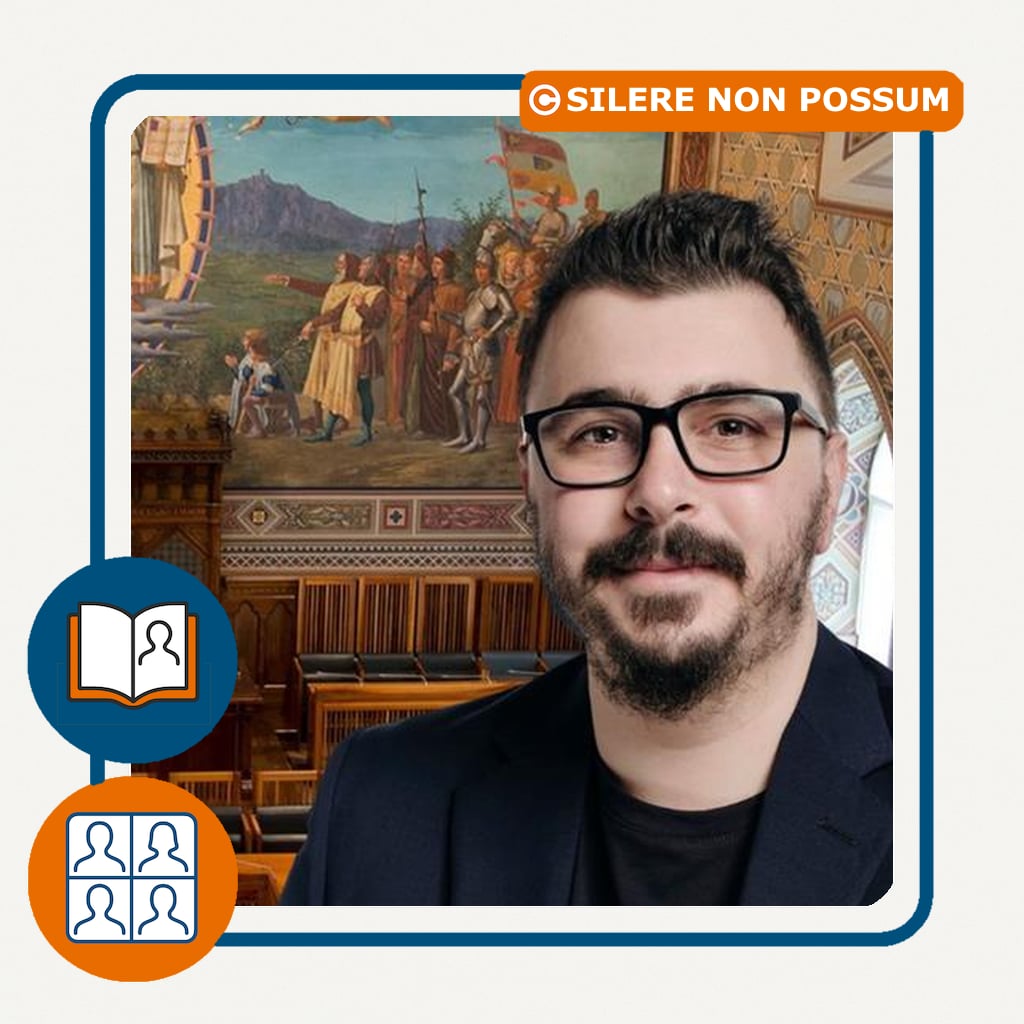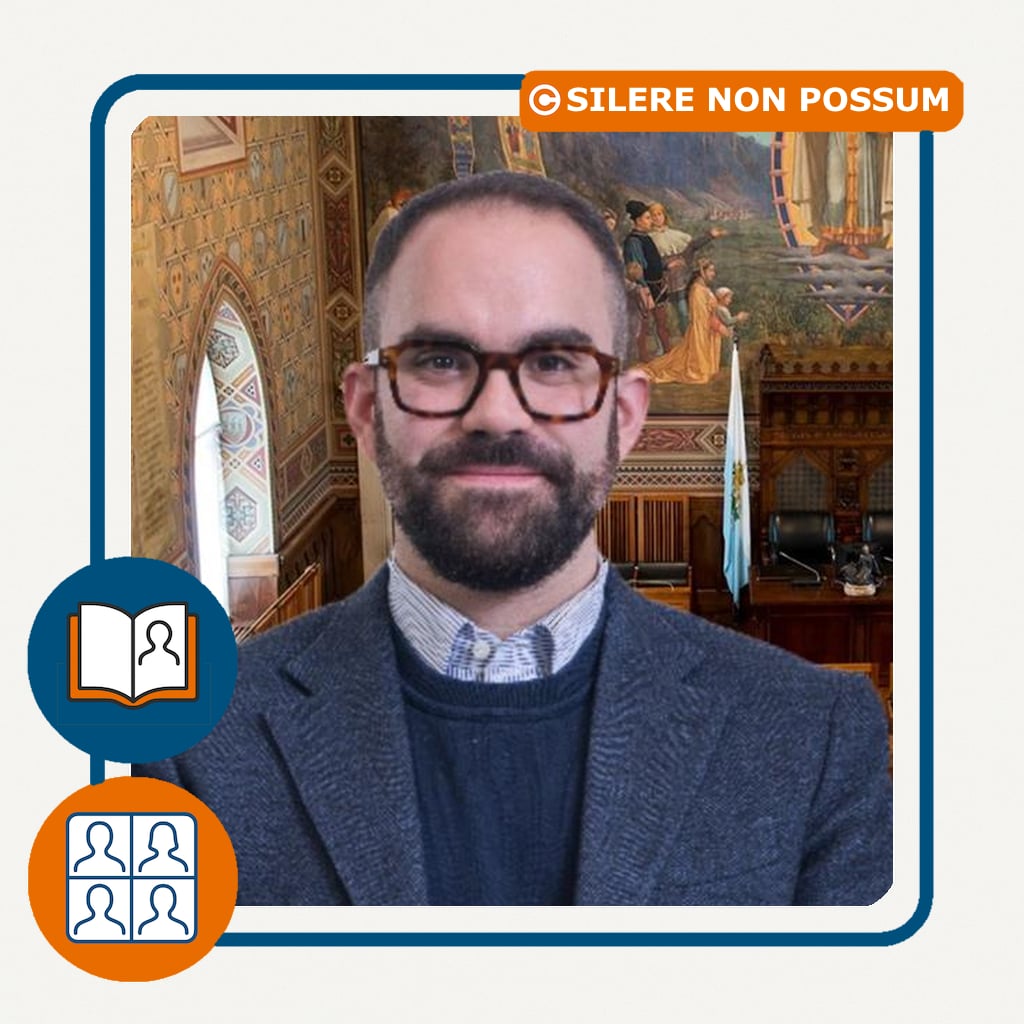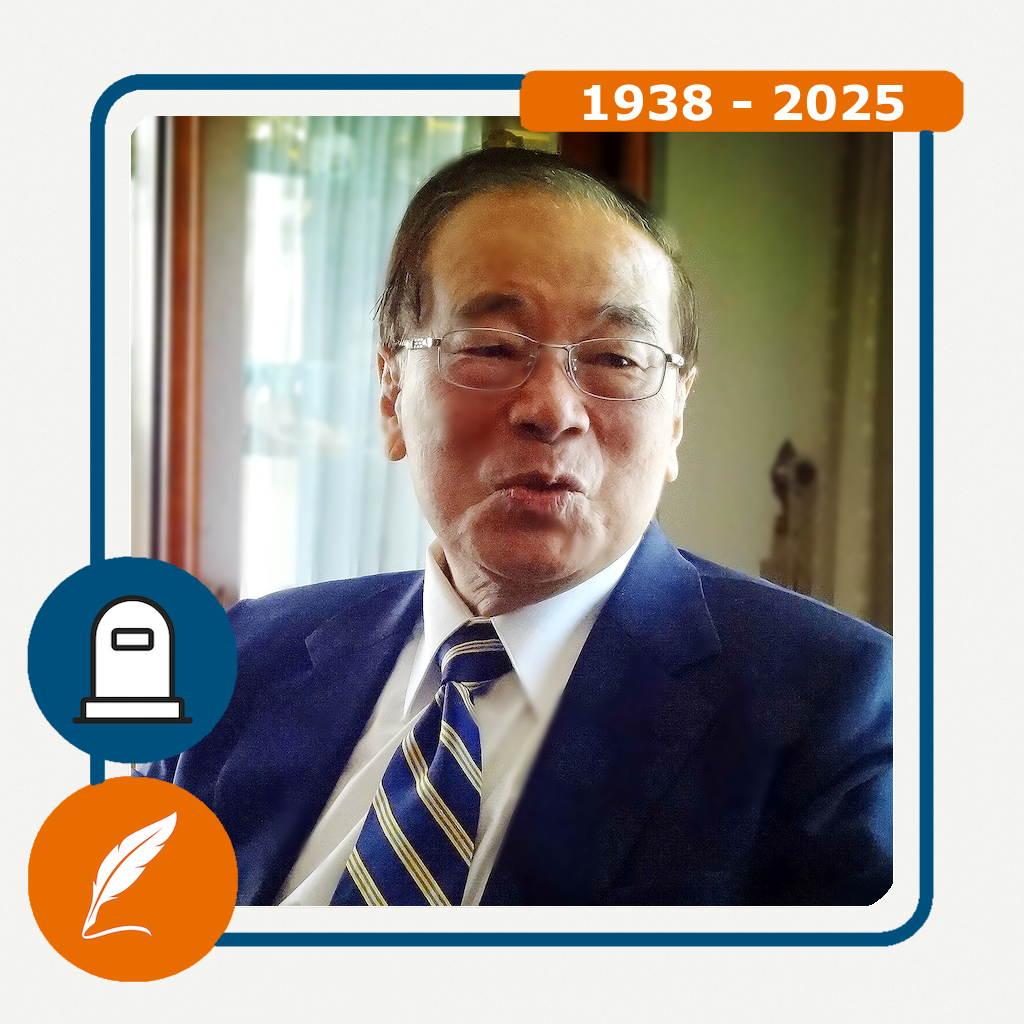HISTOIRE D UN JOUR - 4 OCTOBRE 1830
HISTOIRE D UN JOUR - 4 OCTOBRE 1830
Naissance de la Belgique moderne

4 octobre 1830, au cœur de l’automne européen, un gouvernement provisoire réuni à Bruxelles proclame l’indépendance de la Belgique et annonce la convocation d’un Congrès national. Le décret entérine une rupture ouverte dans les rues depuis la fin d’août et scelle l’entrée d’un nouvel État sur la scène européenne. L’instant semble bref. Il résume des siècles de tensions entre bassins fluviaux, villes marchandes, provinces jalouses de leurs libertés et puissances soucieuses d’équilibres. La décision engage un pays nouveau et redessine ses appartenances régionales durables. Pour mesurer la portée de ce jour, il faut remonter la chaîne des temps, du long héritage des anciens Pays Bas à la conjoncture agitée de l’année 1830.
Depuis longtemps, l’espace qui deviendra la Belgique est un carrefour de routes, de langues et de marchés. Sous la monarchie espagnole, villes et abbayes prospèrent, puis les guerres de religion polarisent le nord protestant et le sud catholique. La fermeture séculaire de l’Escaut ruine un temps Anvers, tandis que d’autres places se réorganisent. Au XVIIIe siècle, sous les Habsbourg d’Autriche, subsiste une société de villes puissantes, de corporations vigilantes et de provinces attachées à leurs chartes.
En 1815, le Congrès de Vienne unit ces provinces méridionales au nord dans un même royaume. L’objectif est stratégique. Il s’agit d’ériger un rempart au sud de la mer du Nord et d’encercler la France revenue à la monarchie. Le nouveau pouvoir promet routes, canaux, universités et administration. Il rencontre des résistances quand il impose l’uniformisation. Le souverain réformateur veut contrôler l’école, rationaliser les finances, centraliser l’autorité. La politique linguistique qui promeut le néerlandais dans le sud heurte les administrations et les élites urbaines francophones. La représentation nationale, imparfaite, alimente un sentiment d’injustice.
L’économie ajoute ses frictions. Les ports du nord tirent parti d’un commerce océanique. Le sillon industriel wallon, du Hainaut à Liège, avance à coups de houille, de hauts fourneaux et de filatures. Les entrepreneurs demandent des débouchés, des tarifs protecteurs et des infrastructures. La question des dettes antérieures à 1815 et leur répartition alimente des rancœurs. En somme, la construction étatique avance, mais elle froisse des intérêts régionaux, sociaux et culturels qui finissent par converger.
Sous la surface, un rapprochement décisif s’opère. Catholiques et libéraux, longtemps opposés, s’entendent sur un minimum commun. Les premiers défendent la liberté d’enseignement et l’autonomie des œuvres. Les seconds réclament des garanties pour la presse, les communes, les universités et pour la responsabilité ministérielle. Cette alliance, que l’on appelle unionisme, ne supprime pas les divergences, mais elle additionne journaux, clubs, notables, avocats et imprimeurs.
L’étincelle vient de l’été 1830. En juillet, Paris renverse la dynastie des Bourbons et ouvre un cycle de secousses. Les nouvelles et les symboles voyagent vite. À Bruxelles, le 25 août, une représentation de La Muette de Portici exalte le public. À la sortie, la foule déferle, des vitrines tombent, des entrepôts sont pillés. En septembre, des barricades s’élèvent, des volontaires accourent, des comités s’organisent. Les combats de rue, intenses autour des parcs et des artères, chassent les troupes du roi des quartiers centraux. La rébellion cesse d’être une agitation pour devenir un fait politique.
Dans ce vide, une instance se constitue à Bruxelles. Elle agrège des figures telles que Charles Rogier, Félix de Merode, Louis de Potter et d’autres acteurs du mouvement. Le gouvernement provisoire tire sa légitimité de l’insurrection victorieuse et de l’adhésion d’autorités locales qui se réorganisent. Sa priorité est de maintenir l’ordre et de donner un horizon. Le 4 octobre, il proclame l’indépendance de la Belgique et annonce la convocation d’un Congrès national. L’acte transforme une sécession de fait en décision juridique et prépare l’élection d’une assemblée constituante.
L’élection, organisée en novembre au suffrage censitaire, réunit deux cents délégués venus de toutes les provinces méridionales. Le Congrès national confirme la rupture avec la maison d’Orange et choisit la forme du régime. Les débats tranchent en faveur d’une monarchie constitutionnelle, représentative et héréditaire, qui limite l’exécutif, organise le pouvoir législatif et protège les libertés. En parallèle, une commission de juristes élabore un projet de constitution. Le Congrès discute article par article durant l’hiver et vote le texte au début de février 1831.
Reste à donner un visage à l’État. Le Congrès refuse toute candidature issue d’Orange. L’idée d’un prince français se heurte à l’équilibre européen. Le choix se porte sur Léopold de Saxe Cobourg, prince expérimenté, capable de rassurer Paris et Londres. Il accepte la couronne. Le 21 juillet 1831, il prête serment à Bruxelles, date qui deviendra la fête nationale. Le jeune royaume dispose alors d’un texte fondamental, d’institutions et d’un souverain. Il lui manque encore la reconnaissance pleine et entière par son voisin et par les puissances.
Le voisin tente une démonstration de force. En août 1831, lors de la campagne des Dix Jours, les troupes néerlandaises reprennent l’initiative et bousculent les unités belges. L’intervention d’un corps français contraint au retrait. Le conflit bascule des combats aux conférences. À Londres, les puissances négocient la séparation. Dès janvier 1831, la neutralité de la Belgique est posée comme condition de sa reconnaissance. Ce principe engage le pays à la prudence extérieure et rassure les voisins qui redoutent tout déséquilibre sur la mer du Nord.
Le règlement définitif intervient en 1839. Les traités de Londres entérinent la séparation, la neutralité et des ajustements territoriaux. Des parties du Limbourg et du Luxembourg passent au nord et à la Confédération germanique. La Belgique conserve Anvers et l’accès garanti à l’Escaut, enjeu vital pour son commerce. Cette solution rappelle que l’indépendance est un processus étalé. Entre la proclamation d’octobre 1830 et la signature d’avril 1839, le jeune État apprend à durer, à négocier et à composer avec l’Europe des puissances.
Dans l’ordre intérieur, l’acte fondateur installe un régime de libertés. La presse devient un acteur décisif de la vie publique. L’enseignement catholique consolide ses réseaux, tandis que l’université et l’école de l’État s’affirment, souvent en concurrence. Les communes et les provinces gardent des marges, ce qui convient à une société dense en villes et en associations. L’unionisme gouverne les premières années. Puis, les lignes de fracture réapparaissent entre libéraux et catholiques, et elles structureront la vie politique pendant des décennies.
La question des langues pèse déjà. Les textes se rédigent surtout en français, langue dominante des élites urbaines et administratives. Dans la Flandre majoritairement néerlandophone, la situation alimente un sentiment de mise à l’écart. L’État né d’un refus d’uniformisation cherchera longtemps l’équilibre entre langues, régions et institutions. De là sortiront, plus tard, des lois linguistiques, des réformes de l’État et une architecture fédérale. En 1830 et 1831, on trace seulement la matrice d’un compromis en constant réajustement.
L’économie tire parti de la stabilité institutionnelle. La houille et le métal de Wallonie alimentent une première industrialisation. Anvers, avec un Escaut rouvert et protégé, retrouve sa vocation maritime. Bruxelles devient un centre administratif et financier actif. Les premiers chemins de fer apparaissent vite, reliant bassins miniers, usines et ports. Les capitaux circulent depuis Londres et Paris vers ateliers, banques et infrastructures. Cette mise en réseau, combinée à la neutralité, donne au pays une place utile dans l’échange européen.
Le sens de la date se lit dans la manière dont l’émeute s’est changée en institutions. Le 4 octobre n’est pas seulement la fin d’une union. C’est l’ouverture d’une procédure qui transforme la violence urbaine en règles, en élections et en lois. Le gouvernement provisoire a su lier le fait accompli d’une sécession à la légitimité d’un mandat. Le Congrès a converti ce mandat en constitution. Les puissances ont inscrit l’ensemble dans un équilibre commun. Ainsi s’articule le temps court des barricades et le temps long des compromis.
L’indépendance n’efface pas les continuités. Les élites demeurent en grande partie les mêmes. Les circuits du crédit et du commerce se réorganisent sans se rompre. Les pratiques municipales, la sociabilité de presse et d’associations, l’influence du clergé persistent et s’adaptent. La nouveauté réside dans la capacité à ménager des espaces de liberté et de débat sous un cadre monarchique strictement borné. Ce style politique, fait de discussions, de coalitions et de décisions lentes, deviendra l’une des marques du pays.
Reste l’inscription européenne. La neutralité belge, garantie en 1839, fait du pays une pièce stable du puzzle continental. Elle n’empêche ni l’essor économique ni la vie parlementaire. Elle suppose un art de la prudence extérieure et de la fermeté intérieure. Elle offre aux voisins l’assurance qu’aucune grande puissance ne s’emparera d’un point stratégique sur la mer du Nord. Elle donne aux Belges le temps de construire un État qui assume sa pluralité et son échelle réduite.
Revenir au 4 octobre 1830, c’est saisir l’instant où une société urbaine, industrieuse et diverse se dote d’un cadre qui lui convient. Le décret du gouvernement provisoire ne crée pas un pays à partir de rien. Il donne forme politique à un tissu déjà vivant et lui ouvre un avenir négocié. La convocation du Congrès national inscrit la légitimité au cœur du processus. La constitution de 1831 fixe les libertés et les pouvoirs. La reconnaissance internationale en 1839 boucle l’ensemble par une garantie de neutralité qui ancre la Belgique dans l’Europe du siècle.