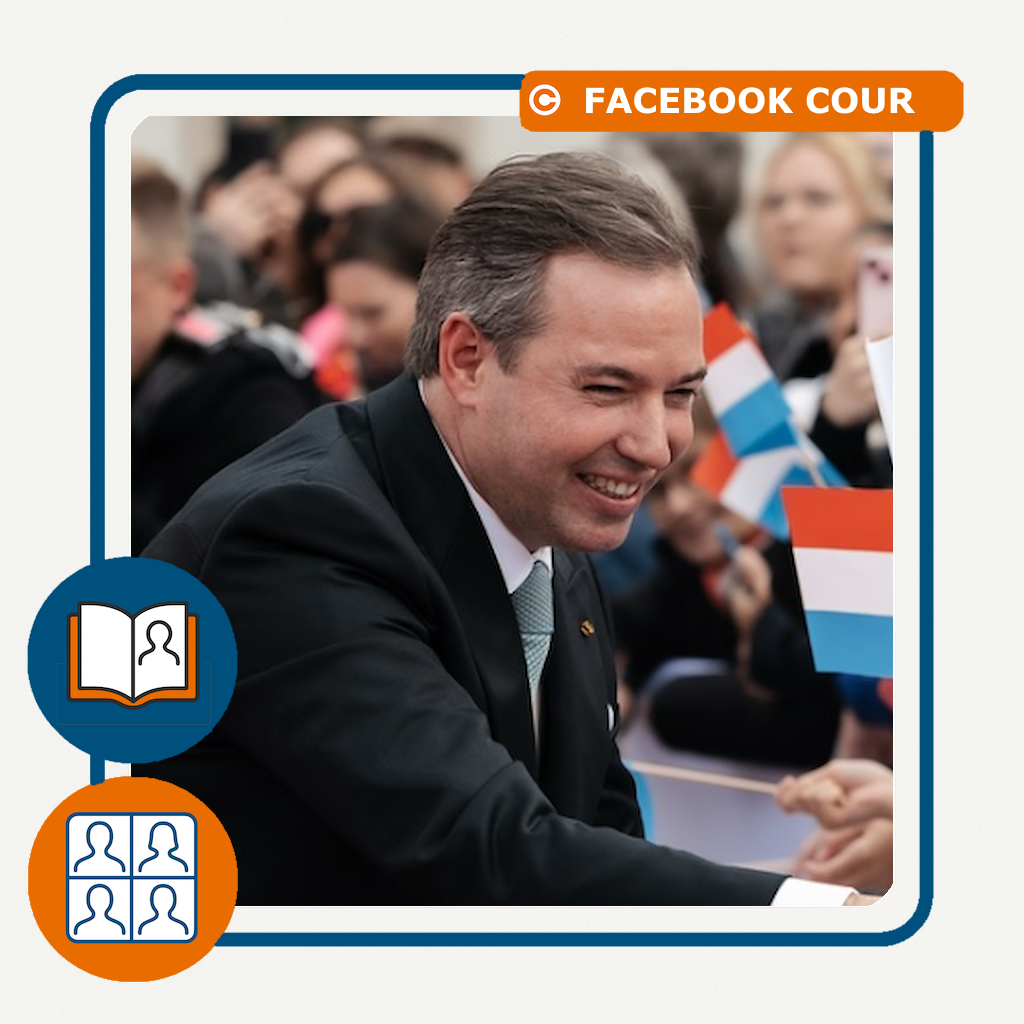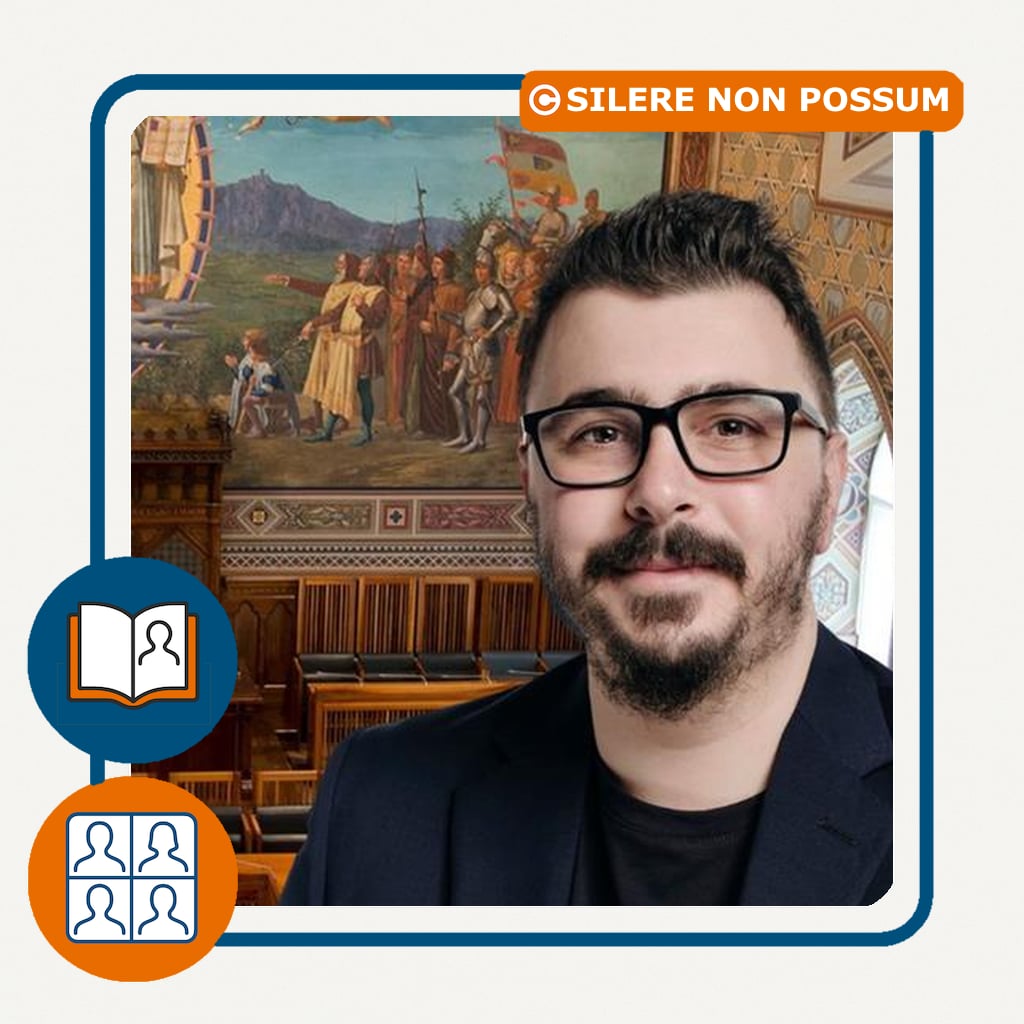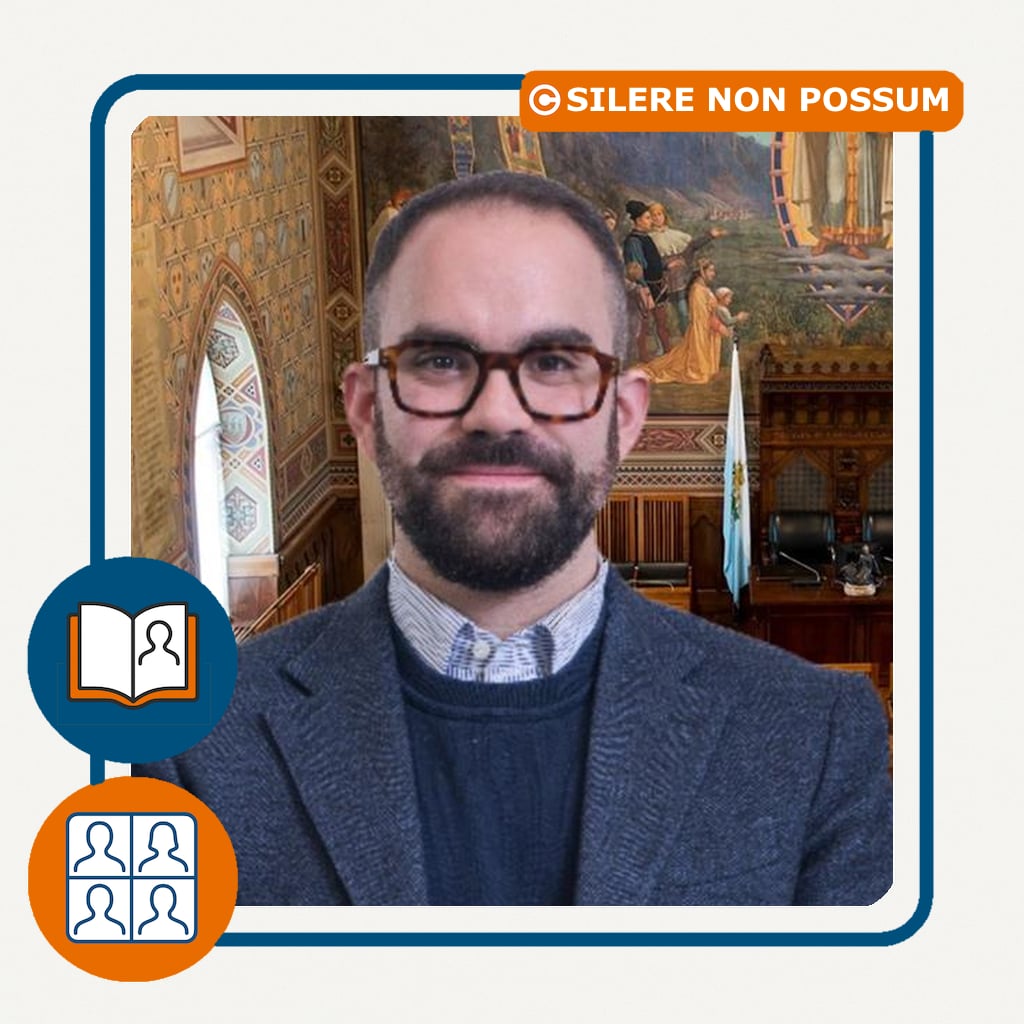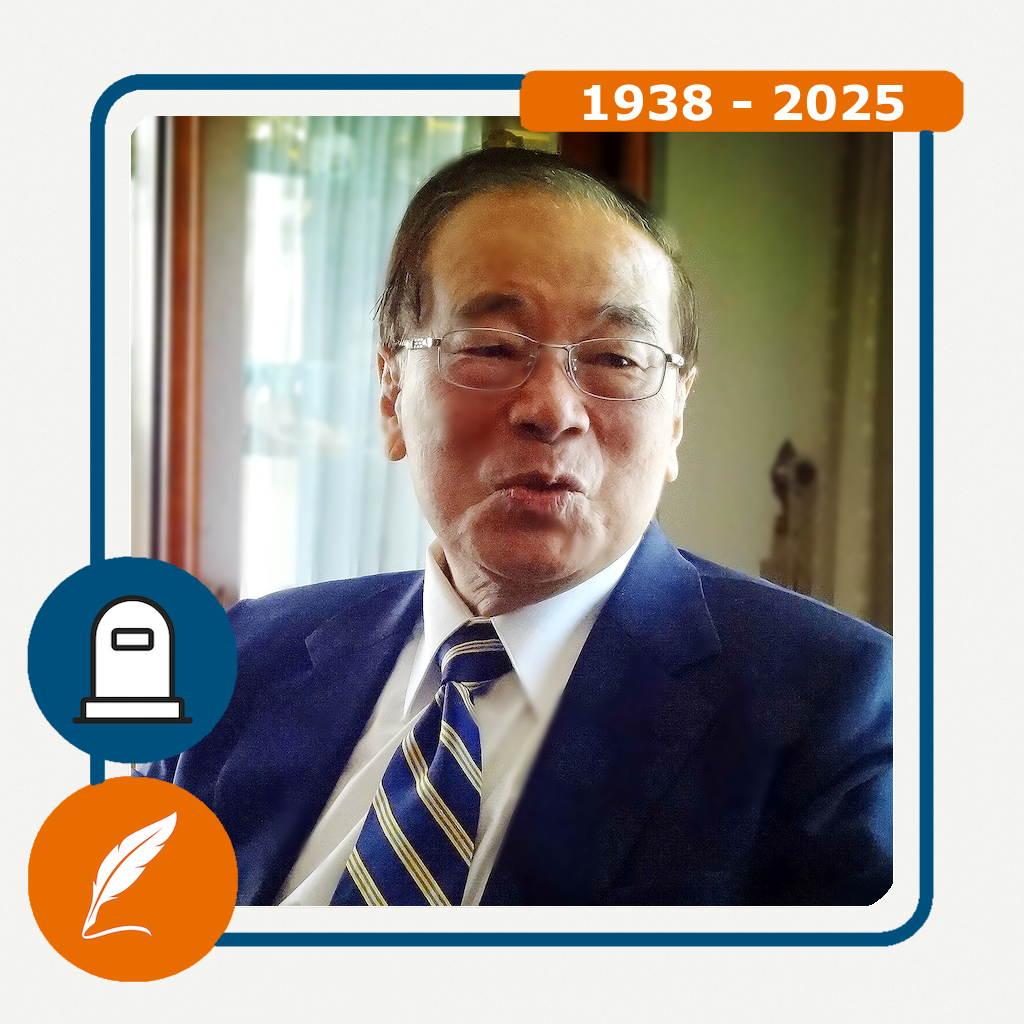FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
François Guizot, l’instituteur de la monarchie de Juillet
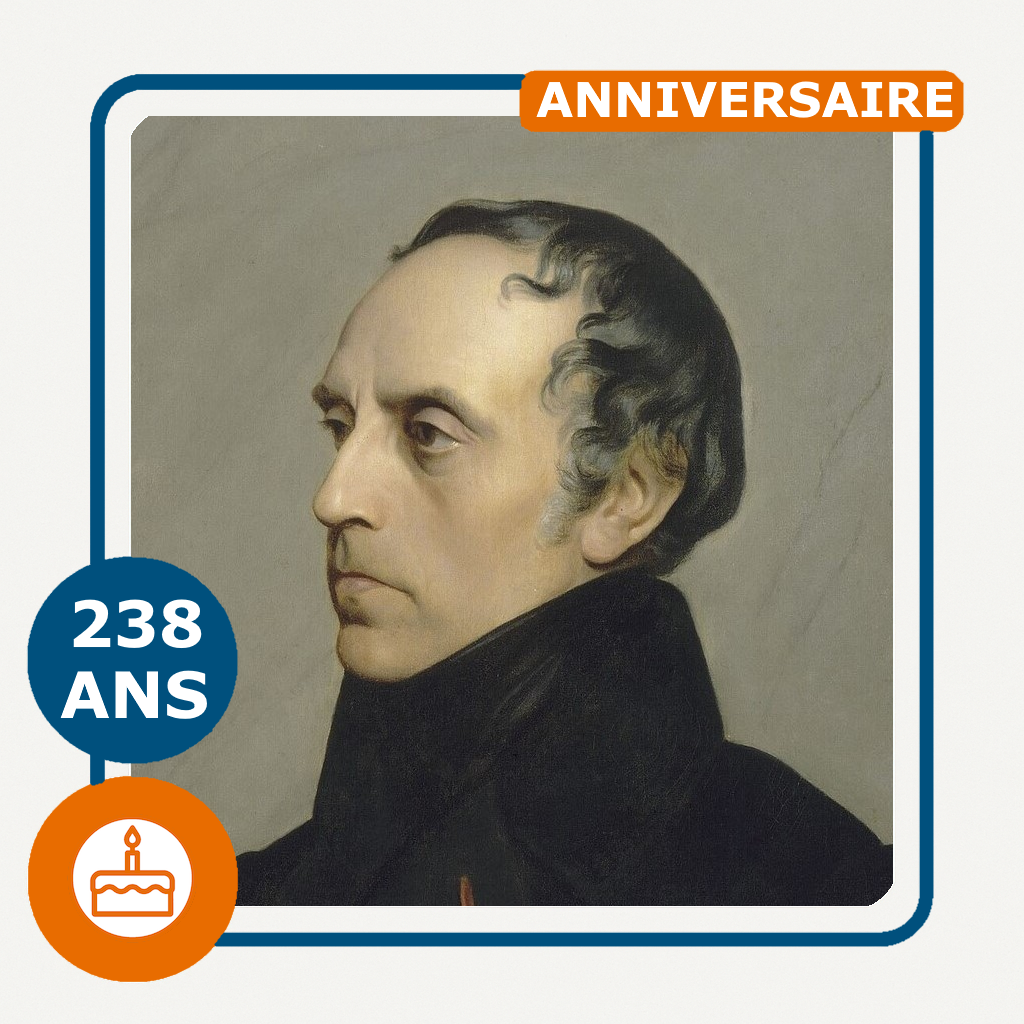
Né le 4 octobre 1787 à Nîmes, François Guizot appartient à une famille protestante qui paie au prix fort la Révolution, quand son père, avocat, est guillotiné en 1794. Nous célébrons aujourd'hui le 238ème anniversaire de sa naissance.
L’enfant comprend que la liberté ne vaut que si l’ordre la rend durable. Sa mère, énergique et pieuse, l’emmène à Genève. L’exil devient apprentissage. Il étudie l’histoire, les langues et la philosophie, fréquente les pasteurs, observe les mœurs politiques d’une cité disciplinée, et forge une méthode faite de lecture et de comparaison.
À son retour à Paris au début de l’Empire, il entre dans la République des lettres avant d’entrer dans l’État. Il traduit, commente, écrit dans les journaux, fréquente les salons où se croisent idéologues, magistrats, diplomates et historiens. En 1812 il épouse Pauline de Meulan, romancière et pédagogue, plus âgée que lui, qui devient sa compagne intellectuelle autant que son épouse. Ils tiennent maison simple et laborieuse. Le foyer vit au rythme des cours, des épreuves d’imprimerie et des conversations. En 1815 naît leur fils Guillaume. Le couple écrit ensemble des textes sur l’éducation qui font entrer l’histoire, la morale et la langue dans une pédagogie exigeante et accessible. La maison reste sobre et ordonnée, soucieuse de former des caractères autant que des esprits.
La même année 1812, Guizot obtient la chaire d’histoire moderne à la Sorbonne. Ses leçons sont très suivies. Il raconte la longue durée européenne, non la seule chronique des batailles. Il met en scène la rencontre de la monarchie, de la féodalité, des communes et de l’Église, et montre comment se forme, siècle après siècle, l’équilibre entre autorité et liberté. Cette méthode nourrit ses ouvrages majeurs, Histoire de la civilisation en Europe puis Histoire de la civilisation en France. L’histoire y apparaît comme science des institutions et école civique. Sa parole claire, méthodique, attire un auditoire mêlé. Les ouvriers typographes s’y croisent avec des employés, des professeurs, des étudiants. L’université devient pour lui un instrument d’élévation sociale et morale.
Sous la Restauration il rejoint les doctrinaires autour de Royer Collard et de Broglie. Ce groupe veut une monarchie représentative, la responsabilité ministérielle et une presse libre mais réglée par la loi. Guizot entre et sort de l’administration au gré des reflux politiques. Les ultras le chassent, l’étude le recueille, puis la pratique le rappelle. Il apprend que les institutions tiennent par l’habitude plus que par le décret et que l’instruction publique est le socle des libertés. Il défend la liberté de la presse et le droit municipal. Il réaffirme la responsabilité ministérielle, c’est à dire l’obligation pour le gouvernement de répondre devant la Chambre. Il gouverne la plume à la main, et retourne, quand il le faut, aux archives qui soutiennent ses décisions.
La révolution de 1830 lui ouvre un champ neuf. Il contribue à la mise en place de la monarchie de Juillet, qui prétend concilier héritage monarchique et conquêtes de 1789. Élu député, puis nommé ministre de l’Instruction publique en 1832, il agit avec méthode. La loi du 28 juin 1833 impose à chaque commune d’entretenir une école primaire de garçons, encourage les écoles normales d’instituteurs, organise l’inspection et favorise les bibliothèques scolaires. Elle n’abolit pas les inégalités, mais elle met en marche et sur place une dynamique d’alphabétisation. L’État donne l’impulsion, les communes organisent, les maîtres enseignent, les familles s’impliquent. Le dispositif est encore inégal et masculin, mais il enclenche des progrès mesurables. Aux yeux de Guizot, l’école est la première politique sociale. La création d’écoles normales structure un métier et attire des talents nouveaux vers l’enseignement. Elle fixe aussi des méthodes communes.
Dans ces années, l’écrivain ne se tait pas. Il publie des portraits politiques, des essais sur les institutions, et une histoire d’Angleterre qui montre comment la liberté moderne s’est accommodée d’une monarchie forte et d’un Parlement souverain. Il entre à l’Académie française en 1836. Sa discipline personnelle reste réglée. Lever matinal, heures de lecture, pages écrites chaque jour, marche l’après-midi. Protestant convaincu, il pratique un culte sans ostentation et sans rigorisme. Après la mort de Pauline de Meulan en 1827, il se remarie en 1828 avec Élisa Dillon et fonde un second foyer. La vie privée reste discrète, réglée, pieuse. Elle soutient un rythme de travail qui conviendrait à un atelier, plus qu’à un ministère, tant l’homme pratique une régularité presque artisanale. Devenu académicien, il assume une double autorité, savante et politique. Sa réputation repose sur un mélange rare d’érudition, de clarté pédagogique et de sang-froid.
À partir de 1840, il passe à la grande politique extérieure. D’abord ambassadeur à Londres, puis ministre des Affaires étrangères, il fait de la paix sa ligne directrice. Il travaille avec Peel et Aberdeen, soigne les échanges, et privilégie les intérêts réels sur les apparences. Pendant la crise d’Orient, il négocie au lieu de brandir le sabre, accepte des compromis sur la question égyptienne, et maintient la France hors d’une guerre sans profit. Cette prudence, discutée par les partisans du prestige, évite des aventures coûteuses et renforce l’entente commerciale avec la Grande-Bretagne. Au Quai d’Orsay, il considère la guerre comme l’aveu d’un échec. Mieux vaut une transaction solide qu’une victoire brillante et coûteuse. La paix produit des dividendes civiques.
En 1847, Louis Philippe l’appelle à la présidence du Conseil. Guizot gouverne selon sa doctrine. Il refuse d’élargir le suffrage censitaire, non par mépris du peuple, mais parce qu’il associe le vote à la capacité et à l’indépendance matérielle. Sa formule, souvent caricaturée, invite les citoyens à s’élever par le travail et l’épargne pour accéder aux droits politiques. Dans un pays d’industrialisation inégale, cette doctrine produit de la stabilité et de la croissance, mais il fige la vie politique. La fermeture du système affaiblit sa propre légitimité, car la classe moyenne montante réclame des droits qui ne suivent pas le rythme des succès économiques. Cette fermeté prudente construit une prospérité calme, mais elle rétrécit l’horizon des espérances. Le pays travaille, s’enrichit, et pourtant s’impatiente devant la clôture du jeu politique.
La campagne des banquets réclame une réforme électorale par des réunions légalement cadrées. À Paris, le gouvernement interdit un grand banquet prévu en février 1848. La mobilisation s’enflamme. Le 23, Guizot remet sa démission. Le soir, des coups de feu sur le boulevard des Capucines radicalisent la rue. Le 24, la monarchie s’effondre. L’ancien ministre, devenu symbole d’un régime jugé sourd, part pour l’Angleterre. L’exil est bref, mais la carrière publique est terminée. Il regarde à distance le destin de la Deuxième République et l’effacement de la monarchie de 1830. Dans ses notes d’exil, Guizot s’interroge sur la frontière entre ordre et immobilisme. Il admet qu’un système qui refuse d’évoluer finit par se percevoir lui-même comme un privilège.
La retraite de Val Richer, en Normandie, s’organise comme un travail d’État à l’échelle domestique. Guizot classe ses papiers, rédige ses Mémoires, poursuit ses méditations sur la liberté moderne. Il martèle une morale simple. Pas de liberté durable sans institutions. Pas d’institutions sans mœurs publiques. Pas de mœurs sans éducation. Il reçoit amis et savants, correspond avec l’Europe lettrée, lit Tocqueville, discute Thiers, examine les doctrines socialistes pour mieux les combattre. Il observe des écoles étrangères, suit des statistiques d’alphabétisation, lit des rapports municipaux, compare les règlements locaux. Il juge qu’une liberté politique sans mœurs publiques se dissout dans l’impatience. Il pense aussi qu’un État sans école devient une pure force.
L’homme privé reste constant. Réveil tôt, travail du matin, marche de l’après-midi, dîner frugal, culte du dimanche. Il aime les arbres, les livres et les comptes clairs. Sa foi protestante est active, plus morale que démonstrative. Sa seconde épouse meurt avant lui. Il vieillit entouré, sans folklore domestique, dans une maison rangée. Le souvenir du père guillotiné continue d’enseigner la fragilité des régimes et la nécessité de règles. Il n’éprouve ni ressentiment ni goût de revanche. Il préfère le temps long aux éclats. La maison ressemble à un séminaire permanent, où l’on corrige, où l’on lit, où l’on compare, où l’on écrit pour convaincre et pour durer. Il tient sa correspondance comme un exercice de gouvernement. Il n’est pas un homme de salon, mais un organisateur du temps et des idées.
Reste la politique, qui l’a fait et défait. Guizot croit à la souveraineté de la raison plus qu’à celle du nombre. Il accepte la représentation, mais veut que la société filtre l’opinion par la capacité, la propriété et l’éducation. Ce libéralisme sociologique a donné à la monarchie de Juillet la paix et la croissance. Il a aussi manqué la montée d’une demande d’égalité politique. Le ministre a tenu quand il aurait fallu ouvrir, et s’est crispé quand il aurait fallu négocier. Sa cohérence a tourné à l’immobilisme. La leçon est double. Un gouvernement gagne à durer, mais il perd à ignorer les seuils d’inclusion. La capacité est une exigence nécessaire, mais elle ne se réduit pas au cens. Elle passe par l’instruction et par des droits partagés.
Son œuvre savante, elle, survit aux alternances. Par sa méthode, il apprend à lire les forces lentes, à distinguer structures et événements, à voir les continuités sous les ruptures. Il propose une pédagogie de la liberté qui passe par l’histoire comparée, par l’étude des institutions anglaises, et par l’attention aux pratiques locales. À la Sorbonne, ses cours attirent au-delà du monde étudiant des auditeurs venus du travail et des bureaux. Il veut des citoyens instruits plutôt que des foules entraînées par la rhétorique. Sa prose, claire et sans emphase, cherche l’accord entre faits, institutions et mœurs. L’histoire, chez Guizot, n’est pas une déclamation, mais une école de la décision.
Guizot meurt le 12 septembre 1874 à Val Richer. Il a vu de loin la chute de l’Empire et les débuts de la Troisième République. Son nom reste attaché à une loi scolaire, à une entente avec la Grande-Bretagne et à une doctrine de gouvernement par la capacité. Ses mandats tiennent en peu de mots. Député dès 1830, ministre de l’Instruction, ambassadeur à Londres, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil en 1847 et 1848. Cette liste dit la durée d’une expérience et son effondrement. Elle laisse voir une cohérence que l’histoire jugera sévèrement ou sobrement selon les moments, mais qui témoigne d’un même fil conducteur, celui d’une liberté encadrée par des institutions et soutenue par l’école. Cette trace pèse encore ici.