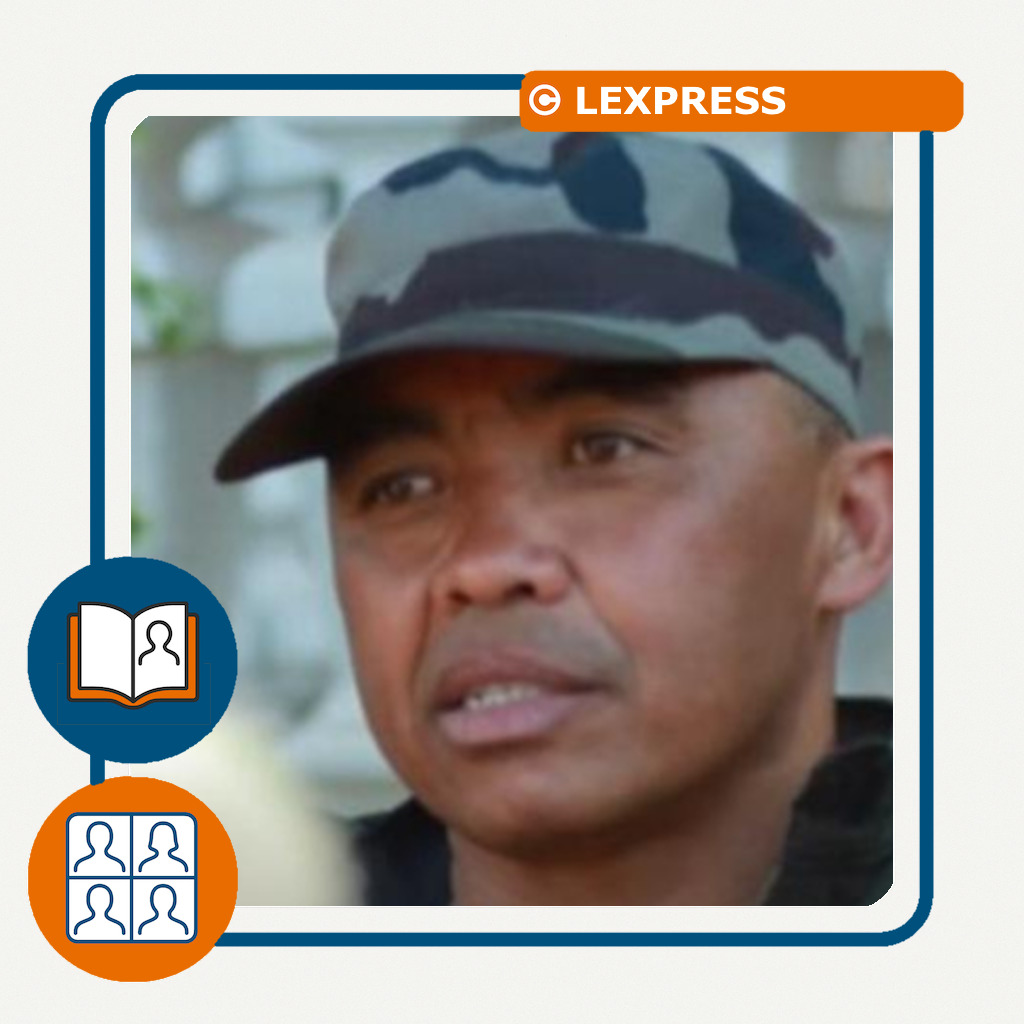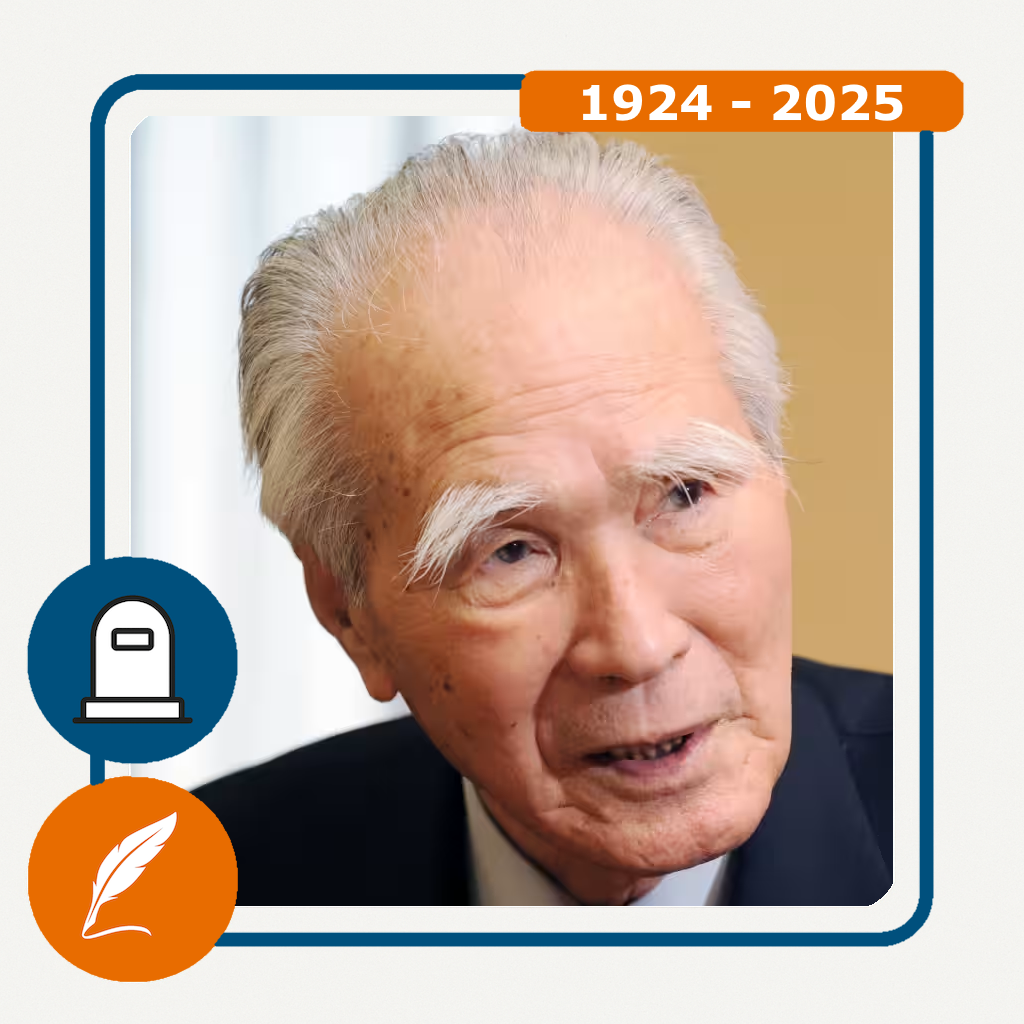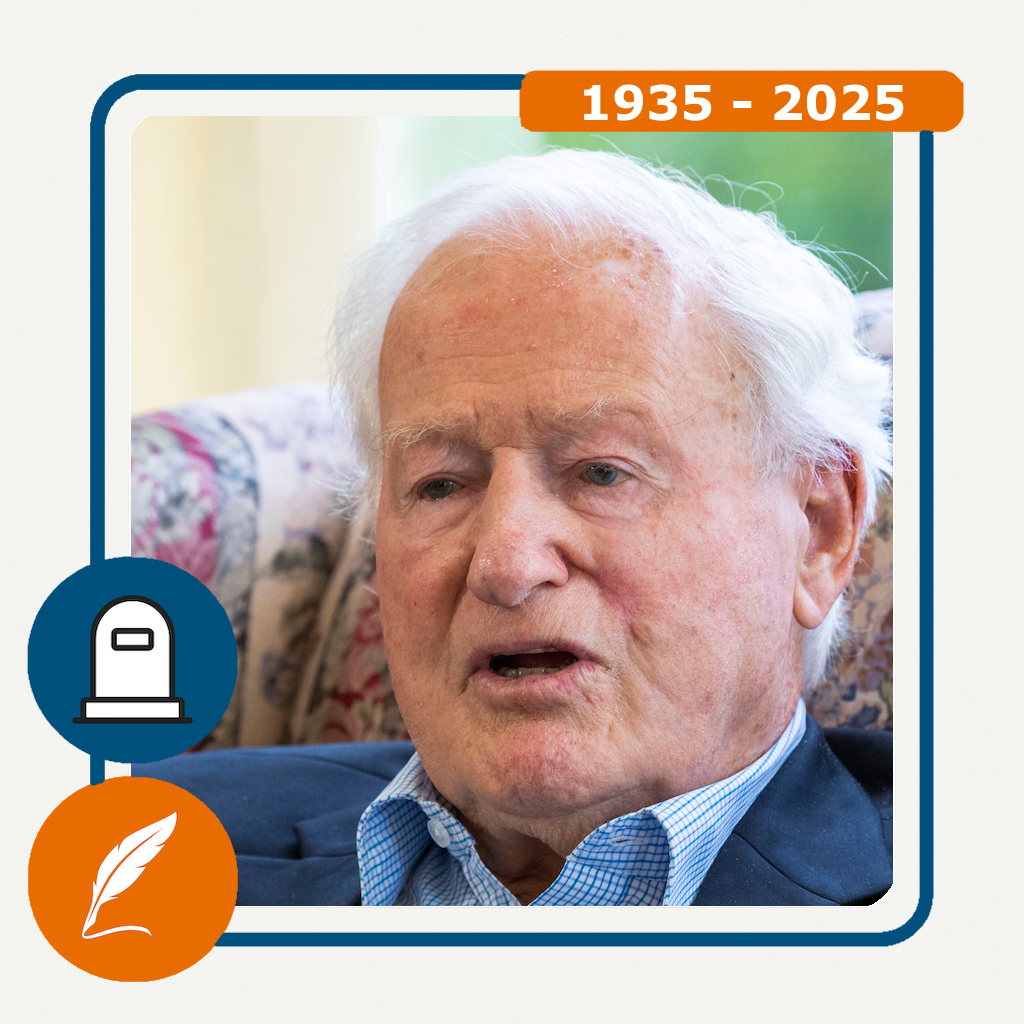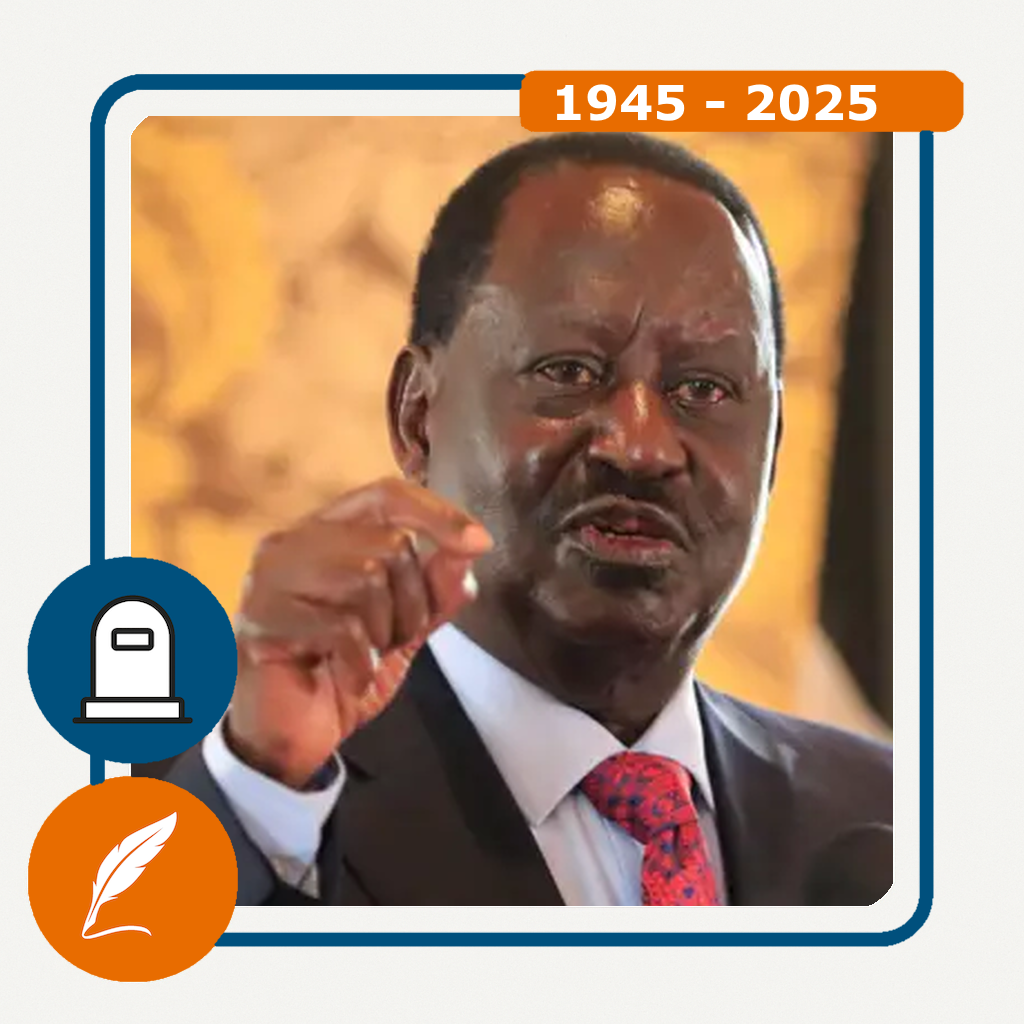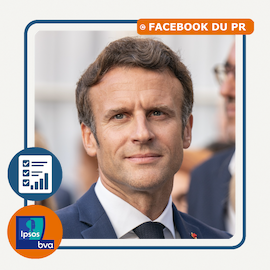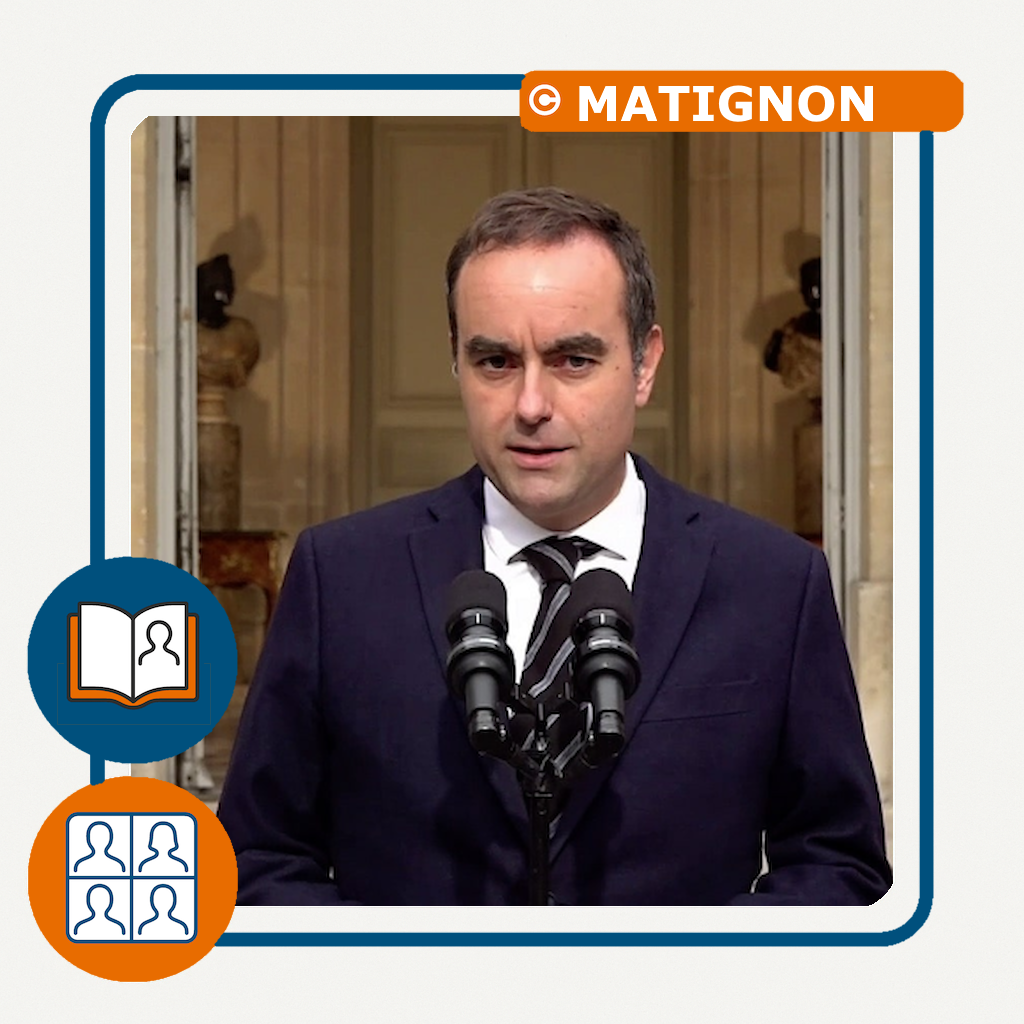HISTOIRE D UN JOUR - 18 OCTOBRE 1991
HISTOIRE D UN JOUR - 18 OCTOBRE 1991
Le jour où l’Azerbaïdjan se refonda

18 octobre 1991, à l’heure où les plaques tectoniques de l’empire soviétique se décollaient lentement, la décision de l’Azerbaïdjan s’inscrivit dans un temps long, fait de discontinuités, de mémoires et de retours, depuis l’expérience brève mais fondatrice de la République démocratique d’Azerbaïdjan de 1918 à 1920 jusqu’aux convulsions de la fin du siècle. À Bakou, l’Acte constitutionnel voté par le Soviet suprême rétablit l’État indépendant, en se réclamant explicitement de cette filiation interrompue par l’invasion de l’Armée rouge au printemps 1920, évènement défini dans le texte comme une occupation qui mit fin à une subjectivité internationale préexistante. L’enchaînement de l’année 1991 prolongeait des ruptures antérieures, et la mémoire du Janvier noir de 1990, lorsque les troupes soviétiques entrèrent à Bakou et réprimèrent dans le sang la contestation, pesait lourd dans la conscience collective et dans la légitimation d’une sortie de l’orbite soviétique. La répression de janvier 1990, qui fit des centaines de blessés et de morts selon des estimations officielles, scella une fracture entre un centre en perte d’autorité et une société dont les mobilisations nationales s’affirmaient, et elle fut rétrospectivement présentée par les autorités azerbaïdjanaises comme un symbole de lutte pour l’indépendance. Dans cet horizon émotionnel et politique, une première déclaration parlementaire du 30 août 1991 annonça la volonté de restaurer l’indépendance, et ouvrit la voie aux discussions qui, du 8 au 18 octobre, aboutirent à l’adoption du texte fondateur. L’architecture du vote, avec 258 députés sur 360 approuvant l’Acte constitutionnel tandis qu’une part des élus ne participait pas ou s’abstenait, traduisait l’intensité des débats mais fixait clairement une majorité constituante pour rompre avec l’ordre ancien. Le texte adoptait une double grammaire, à la fois juridique et historique, en proclamant la succession de l’État contemporain à l’entité de 1918 et en posant des bases de souveraineté politique et économique dédiées au nouvel État.
Les faits, ensuite, s’enchaînèrent selon des temporalités imbriquées, l’urgence du moment cohabitant avec le besoin d’instituer des symboles et des normes durables, comme en témoigne l’adoption en 1992 de l’hymne et de l’étendard à trois couleurs et l’affirmation d’armoiries autour de l’étoile à huit pointes et du feu, autant de signes d’une identité réaffirmée. Le référendum du 29 décembre 1991 donna une sanction populaire aux transformations institutionnelles déjà engagées, avec un résultat de 99,76 pour cent de suffrages favorables pour une participation rapportée à 95 pour cent, confirmant la restauration de l’indépendance dans les urnes. À l’intérieur du système politique, la transition fut heurtée par les épreuves d’un État de guerre, circonstance soulignée par les autorités lors du vingtième anniversaire, et par l’inexpérience d’institutions nationales appelées à gouverner dans la tourmente. La figure d’Aboulfaz Eltchibeï, chef du Front populaire, élu à la présidence à l’été 1992, marqua une parenthèse où l’élan national fut confronté à la fragmentation des forces, préludant à des recompositions qui amèneraient bientôt un retour de Heydar Aliyev au sommet de l’État. La guerre du Haut Karabakh, nourrie par les affrontements qui avaient commencé à la fin de l’ère soviétique, devint l’horizon tragique de cette souveraineté retrouvée, jusqu’à la conclusion d’un cessez le feu provisoire en mai 1994, connu sous le nom de Protocole de Bichkek. Le Protocole, signé à Bichkek avec la médiation russe et kirghize, institua une pause qui allait geler le conflit durant des années, malgré des reprises ponctuelles des hostilités jusqu’aux affrontements plus graves de 2016 et à la guerre de 2020, tant il est vrai que les cessez le feu ne défont pas les traumatismes territoriaux et humains qu’ils suspendent. Sur le plan institutionnel, la Constitution de 1995 inscrivit expressément les principes posés par l’Acte constitutionnel dans l’armature du droit public azerbaïdjanais, consolidant la continuité nouvelle de l’État après la tournée fondatrice des actes et du référendum de 1991. Dans les régions et dans l’exclave de Nakhitchevan, où Heydar Aliyev avait accédé en 1991 à la présidence de l’Assemblée suprême de l’autonomie, la réaffirmation des symboles nationaux servit de matrice à une culture d’État qui dépassait les clivages locaux. La scène politique connut, à partir de 1993, la consolidation d’un leadership incarné par Heydar Aliyev, que des lectures officielles associent à la stabilisation d’une trajectoire économico politique mise à mal par la guerre et par les désordres des premières années de l’indépendance. Cette stabilisation s’exprima notamment par la stratégie pétrolière, dont la clé fut le Contrat du siècle signé le 20 septembre 1994 au palais Gouloustan, qui associe des majors internationales et structure pour des décennies l’économie énergétique et l’inscription géopolitique du pays. Ratifié en décembre 1994 par le parlement, ce contrat de partage de production sur les gisements d’Azeri, Chirag et Guneshli ouvrit la voie à une série d’accords ultérieurs et à une montée en puissance de l’investissement dans l’offshore caspien. Ainsi, l’État qui se reconstitue en 1991 n’est pas seulement un cadre juridique, mais un acteur capable de faire levier sur ses ressources naturelles pour consolider sa souveraineté et son insertion régionale, ce que soulignent les analyses institutionnelles et gouvernementales sur l’héritage de ce contrat.
Les suites de l’acte du 18 octobre 1991 se lisent dans la dialectique des commémorations et des épreuves, car la date, devenue Fête de la restauration de l’indépendance, rythme chaque année un récit national qui relie la mémoire des martyrs et l’affirmation d’un État moderne. Le calendrier civique, en effet, consacre ce jour d’octobre comme marqueur symbolique d’un choix irréversible, et l’on commémore aussi en janvier les victimes du Janvier noir, reliées par les autorités à la lutte pour l’indépendance et à la pleine restauration de l’intégrité territoriale à l’ère contemporaine. Le texte fondateur lui même, en rappelant la chaîne des causes qui va de la proclamation de 1918 à l’occupation de 1920, puis à la déclaration du 30 août 1991, articule une profondeur historique qui autorise la relecture du vingtième siècle azerbaïdjanais comme une longue traversée ponctuée d’interruptions et de reprises. D’un point de vue politique intérieur, la période qui suit voit se consolider les emblèmes de la souveraineté, tandis que l’économie se recompose autour de la rente énergétique et des infrastructures qu’elle rend possibles, prolongeant les choix de 1994 et les alignant sur les besoins d’un État en reconstruction. Le cessez le feu de 1994 eut pour effet d’instituer un gel conflictuel, qui n’évita ni les crises ni les retours de flammes, mais qui instaura une grammaire de la négociation intermittente et de la militarisation des frontières, constamment rappelée par les mentions des reprises d’hostilités dans les années suivantes. Dans le champ juridique, la Constitution affirme la filiation directe avec l’Acte constitutionnel, signifiant que le droit fondamental s’écrit en mémoire de la décision d’octobre 1991, comme si la souveraineté formelle et la souveraineté vécue se rejoignaient dans un même texte. La pratique commémorative, quant à elle, maintient l’évènement vivant, comme l’attestent les hommages annuels aux victimes de 1990 et les cérémonies d’indépendance, où le pouvoir inscrit la narration nationale dans une continuité résolue. Du point de vue international, la restauration de l’indépendance fut rapidement reconnue et traduite dans les relations bilatérales et multilatérales, tandis que la posture énergétique valait au pays de figurer au cœur de recompositions régionales nouvelles, aux confins de l’espace postsoviétique, du Caucase et de la mer Caspienne. Les références récurrentes aux années 1990 dans les discours officiels rappellent que l’indépendance n’a pas été le simple produit d’une mécanique d’effondrement impérial, mais une expérience nationale façonnée par des deuils, des décisions institutionnelles et des paris économiques, dont l’empreinte structure encore l’État azerbaïdjanais.
Le 18 octobre 1991 apparaît ainsi comme la confluence d’une mémoire réactivée, d’une décision juridique souveraine et d’un horizon stratégique redessiné, où l’État restaure sa subjectivité internationale en assumant les coûts d’une transition sous la guerre et en organisant ses ressources collectives autour de choix énergétiques et institutionnels durables. Le référendum de décembre 1991, la consolidation constitutionnelle de 1995 et la trame commémorative d’aujourd’hui composent une même temporalité, celle d’une indépendance restaurée et constamment réactualisée, dont la portée dépasse l’instant de l’acte parlementaire et engage un récit de longue durée à l’échelle d’un peuple et d’un territoire. À la faveur de ce pli de l’histoire, les symboles nationaux adoptés en 1992 se chargent d’une fonction qui n’est pas seulement identitaire, mais performative, parce qu’ils donnent à voir et à vivre l’existence politique restaurée, dans les institutions, dans l’espace public et dans la projection internationale. L’évènement n’est donc pas clos en 1991, il se prolonge par les architectures juridiques et économiques, par les cessez le feu imparfaits et par les commémorations, autant de strates qui en font, au delà du seul moment, une charpente de l’État contemporain. En ce sens, l’indépendance restaurée n’est pas une ligne de départ ou d’arrivée, mais une forme de durée où les épreuves collectives et les choix fondateurs s’entremêlent, donnant à l’Azerbaïdjan le cadre d’un destin aujourd’hui encore travaillé par l’ombre portée des années 1990 et par l’héritage plus ancien de 1918.