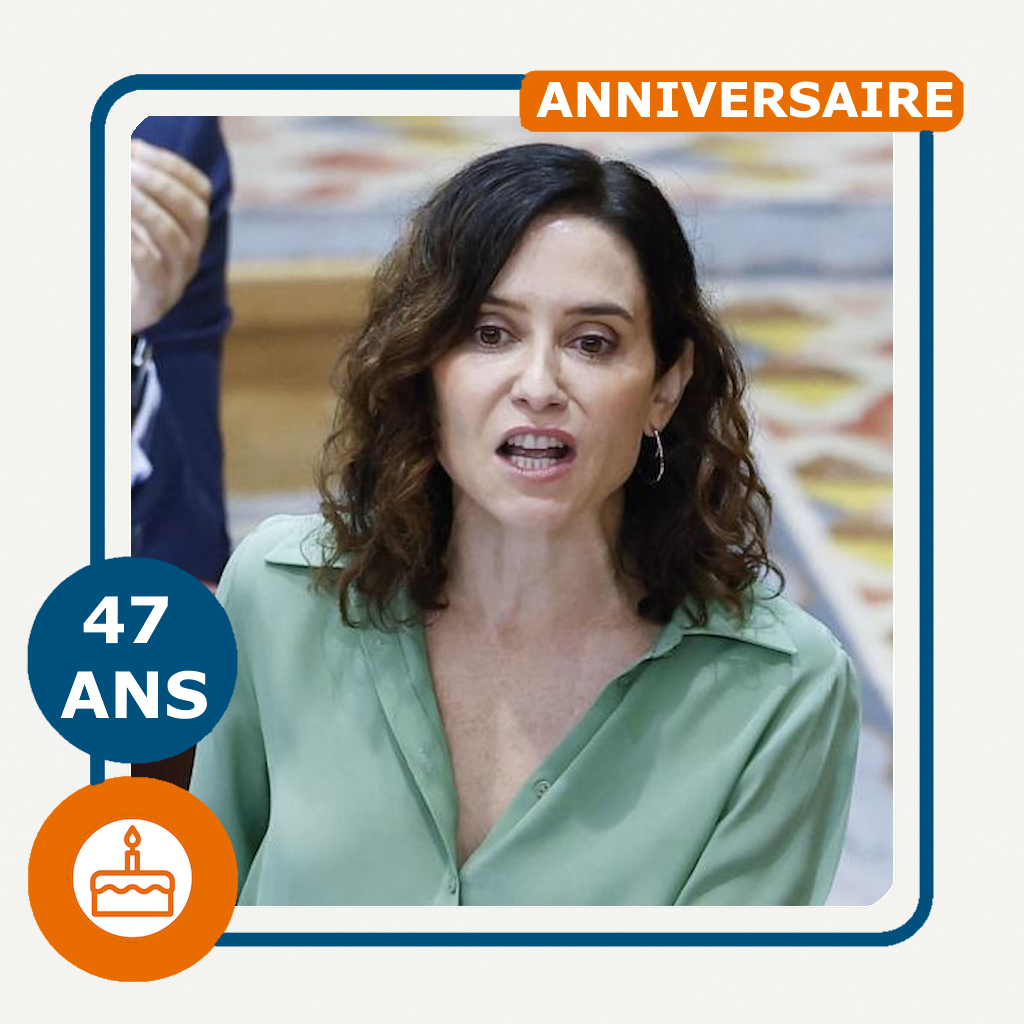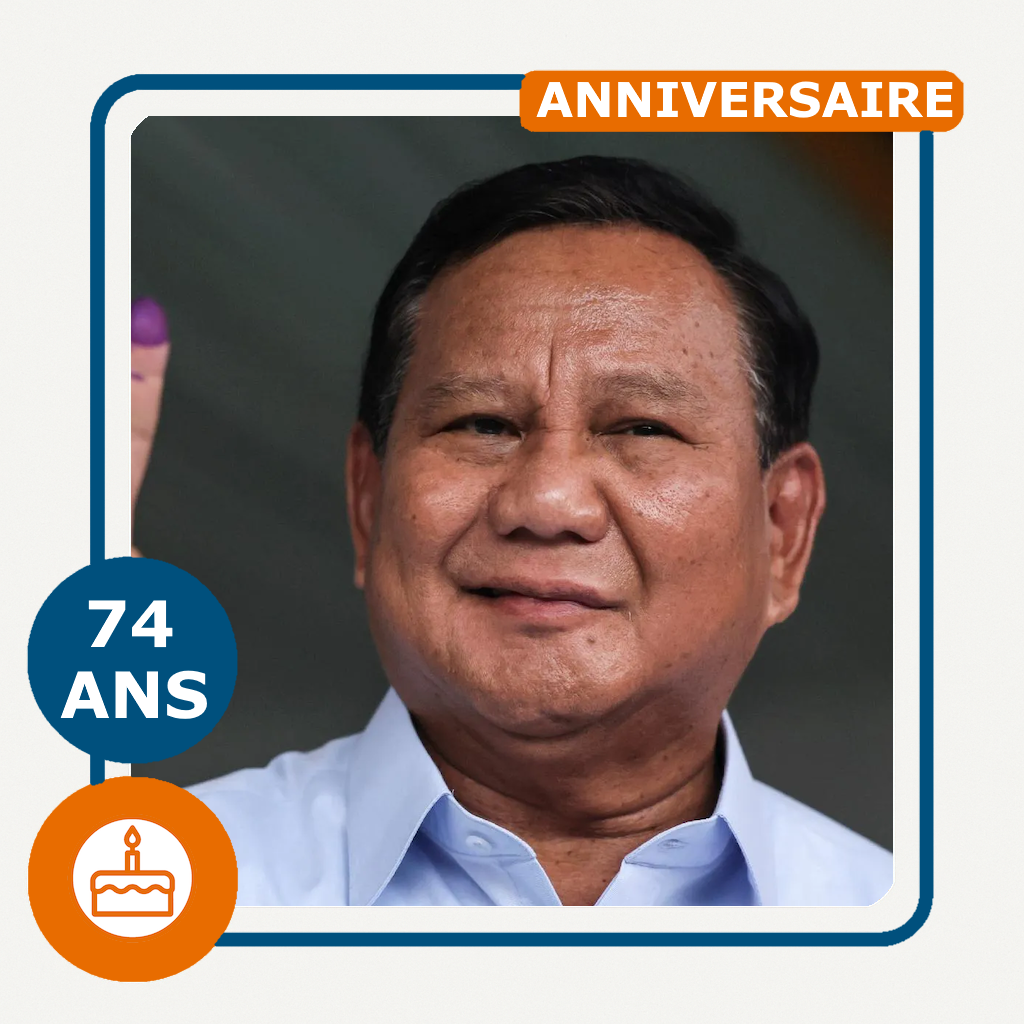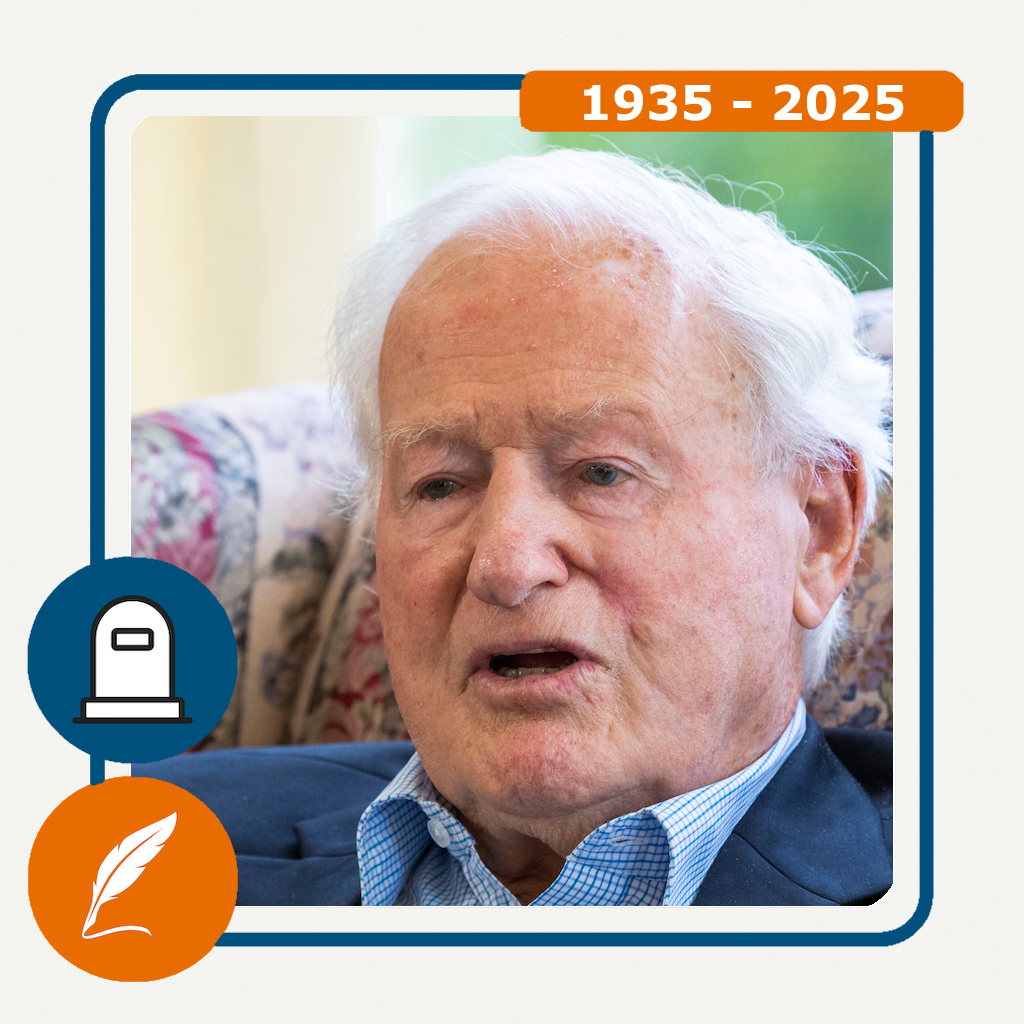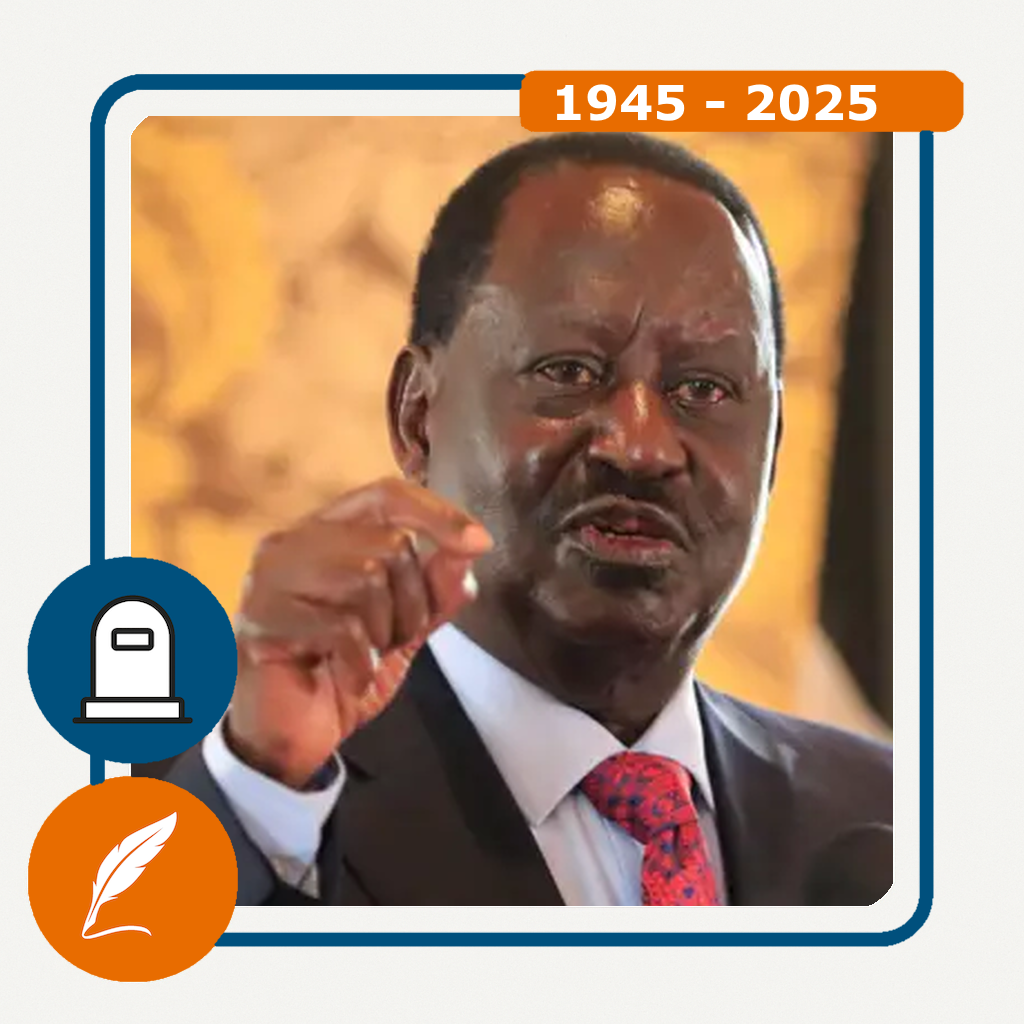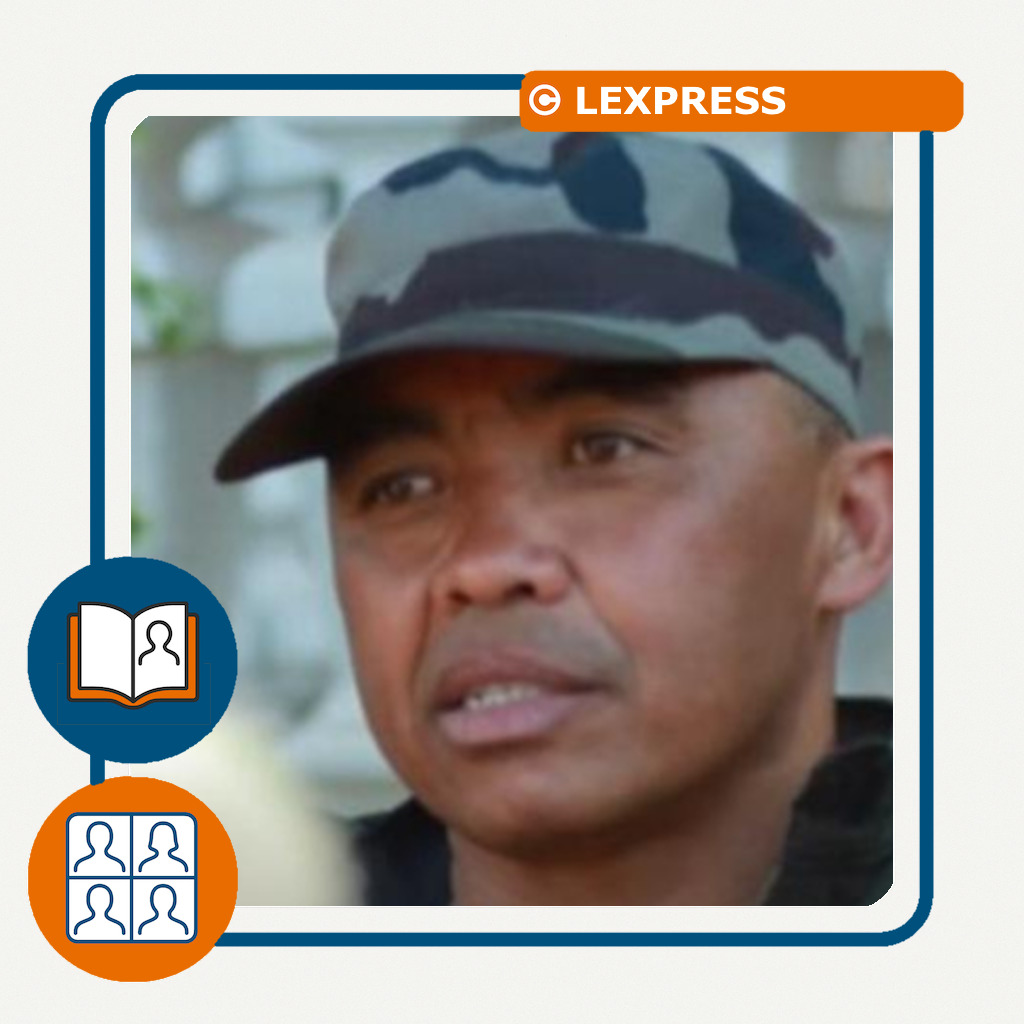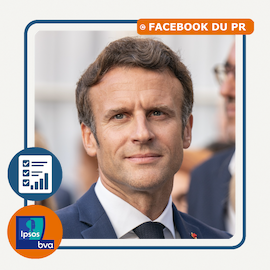HISTOIRE D UN JOUR - 3 OCTOBRE 1990
HISTOIRE D UN JOUR - 3 OCTOBRE 1990
Le temps long de l'unité allemande

3 octobre 1990. À minuit, la République démocratique allemande adhère à la République fédérale d'Allemagne selon l'article d'accession de la Loi fondamentale. Ce choix met fin à quarante et une années de séparation institutionnelle et engage l'intégration d'un territoire, d'une population et d'une mémoire dans un cadre éprouvé de démocratie parlementaire. La date devient fête nationale sous son nom allemand Tag der Deutschen Einheit et fixe le moment où une frontière intérieure se dissout pour devenir une articulation, un lieu de passage et d'échanges.
Pour saisir la portée de cette nuit, il faut replacer l'événement dans la longue durée. La division de 1949 n'avait pas interrompu des trajectoires plus anciennes. L'ouest rhénan et bavarois, densément industrialisé et connecté aux marchés atlantiques, avait consolidé une économie sociale de marché portée par une monnaie forte et par la négociation collective. L'est, fait de régions agricoles et d'industries nationalisées, avait reçu après 1945 des réformes foncières, une planification centralisée et des priorités productives qui plaçaient l'égalité proclamée au-dessus de la rentabilité. La ligne Oder Neisse, confirmée après la guerre, fixait la nouvelle bordure à l'est et reconfigurait les flux. L'exode des années cinquante drainait vers l'ouest des centaines de milliers de travailleurs qualifiés, jusqu'au verrouillage brutal du Mur en 1961 qui transforma une frontière administrative en paysage de béton, de miradors et de rubans minés.
Pourtant, les sociétés poursuivaient des mouvements profonds qui excédaient les structures politiques. Les années soixante et soixante dix virent l'ostpolitik installer des pratiques de reconnaissance, des accords techniques et des passages frontaliers encadrés. La République fédérale, installée à Bonn, s'ancra à l'ouest du continent par les alliances et par l'intégration européenne. La République démocratique, gouvernée par un parti unique et par un appareil de sécurité dense, se maintenait dans la discipline du bloc socialiste. Entre les deux, familles et entreprises inventaient des ruses et des routines, lettres filtrées, colis, rencontres aux points de passage, qui maintenaient un lien ténu.
La décennie 1980 déstabilisa cet équilibre. La stagnation des économies socialistes, l'endettement, les pénuries et la diffusion de l'information minèrent la loyauté à l'est. Les réformes ouvertes à Moscou desserrèrent les cadres et libérèrent des initiatives civiques. Au printemps et à l'été 1989, des milliers d'Allemands de l'est quittèrent le pays via la Hongrie et l'Autriche. À Leipzig, les prières du lundi devinrent manifestations organisées. Le 9 novembre 1989, l'ouverture improvisée des points de passage transforma l'ordre établi en spectacle d'embrassades et de marteaux. Le Mur perdit son sens, la frontière redevint rue, la ville se retourna vers ses quartiers scellés.
Le début de 1990 convertit l'irruption en négociation. Des élections libres donnèrent au gouvernement est allemand un mandat pour conclure une union monétaire, économique et sociale avec l'ouest. Le 1 juillet 1990 introduisit le deutsche mark comme monnaie légale à l'est et étendit le droit social fédéral, signal monétaire et politique qui modifia immédiatement les prix, les salaires et les contrats. Les boutiques adoptèrent de nouvelles gammes, les entreprises affrontèrent des coûts inédits et un marché différent, les administrations durent réécrire leurs modes opératoires. La pression sociale, portée par l'attente d'une amélioration rapide du niveau de vie, imposa un calendrier serré.
Le choix constitutionnel fut celui de l'accession. Plutôt que d'écrire un texte nouveau, les Länder reconstitués rejoignirent la fédération existante. Le traité d'unification du 31 août 1990 précisa transferts de compétences, de normes et d'institutions. Le traité dit deux plus quatre, signé le 12 septembre 1990 avec les puissances de 1945, régla la question de la souveraineté, des troupes et des limitations militaires. L'Allemagne confirma la frontière avec la Pologne et retrouva sa pleine capacité internationale, désormais arrimée à l'Alliance atlantique et à l'Europe communautaire.
La nuit du 3 octobre scella l'entrée de cinq Länder orientaux, Brandebourg, Mecklembourg Poméranie occidentale, Saxe, Saxe Anhalt et Thuringe, au sein de l'édifice fédéral. Berlin, encore en chantier, recouvra une unité administrative qui préfigurait son rôle de capitale politique. L'administration, la justice, l'école, les médias et la police adoptèrent le droit fédéral. La foule célébra, les orchestres jouèrent, les mairies illuminèrent leurs façades. Dans l'euphorie, beaucoup crurent que le temps de l'égalisation serait court. La suite rappela que les structures, les compétences et les habitudes ne se transforment pas au rythme des feux d'artifice.
La privatisation décida du sort de milliers d'entreprises. La Treuhandanstalt, chargée d'administrer et de céder les combinats hérités de la planification, fit moderniser certaines unités, en ferma d'autres et en vendit beaucoup à des groupes de l'ouest ou à des investisseurs étrangers. Le chômage monta rapidement, l'émigration vers l'ouest reprit, des villes perdirent des habitants, d'autres se redéployèrent autour de services et d'industries nouvelles. L'État fédéral mobilisa des transferts massifs, financés par un prélèvement de solidarité, pour construire routes, ponts, lignes ferroviaires, réseaux d'eau et d'énergie, moderniser télécommunications et hôpitaux, dépolluer rivières et friches.
Le droit orchestra la translation. Les archives d'État furent ouvertes sous contrôle, permettant l'examen du passé sécuritaire et l'accès aux dossiers. Les universités alignèrent diplômes et carrières. Les professions réglementées établirent des équivalences. Les tribunaux tranchèrent des conflits de propriété nés des nationalisations et des expropriations d'après guerre. Les communes recomposèrent leurs périmètres pour rationaliser les services. La Cour constitutionnelle arbitra des tensions entre protection des droits acquis et réparation des injustices, fixant des précédents qui structurèrent la transition.
La politique électorale reconfigura la représentation. En décembre 1990, les premières élections fédérales de l'Allemagne réunifiée consolidèrent la coalition qui avait conduit le processus. À l'est, de nouveaux partis s'enracinèrent, héritiers d'oppositions civiques ou porteurs de demandes sociales pressantes. L'année suivante, le Parlement décida de transférer le siège du gouvernement de Bonn à Berlin, signalant que la capitale historique redevenait centre politique. Le débat public, vivifié, se déploya dans des médias pluralistes, tandis que les Länder apprirent la grammaire d'un fédéralisme exigeant où compétences, budgets et péréquations se négocient sous l'œil de la Cour.
La société apprit la coexistence des mémoires. Des biographies se réécrivirent, des illusions se défirent, des injustices furent reconnues. Des solidarités anciennes se dissipèrent, d'autres apparurent. On parla de mur mental pour décrire la persistance de clivages culturels et économiques. Pourtant, des milliers de trajectoires individuelles traversèrent l'ancien tracé. Des couples, des carrières, des études et des projets entrepreneuriaux tissèrent une trame commune. Les écoles accueillirent des publics nouveaux, les entreprises recrutèrent au-delà des anciennes bornes, des associations encadrèrent l'accompagnement social.
À l'échelle européenne, la réunification pesa sur les calendriers. Le traité de Maastricht fut signé peu après, ancrant l'Allemagne dans une union politique et monétaire. L'élargissement vers l'est devint un horizon stratégique, porté par l'intérêt économique et par l'idée que la stabilité passerait par l'intégration. Des corridors ferroviaires et routiers furent pensés pour relier la Baltique et l'Adriatique au centre du continent. La diplomatie allemande, prudente, travailla à rassurer les voisins en tenant la ligne d'une puissance contenue par le droit et par les institutions communes.
Les chiffres, sur la durée, racontent une convergence partielle. Le revenu médian de l'est rattrapa l'ouest sans l'égaler. La productivité progresse mais laisse des écarts. L'espérance de vie s'améliora, les logements furent rénovés et les centres historiques retrouvèrent des places vivantes. Des poches de fragilité persistèrent, souvent rurales. Des métropoles de l'est gagnèrent en attractivité, Leipzig, Dresde, Iéna, Rostock et Magdebourg, qui accueillirent industries, laboratoires et scènes culturelles. Des territoires peinèrent, misant sur le tourisme, l'énergie, l'agroalimentaire, la logistique.
L'État réajusta ses mécanismes de péréquation pour tenir compte de ces trajectoires. Les Länder négocièrent entre autonomie et solidarité. La Cour constitutionnelle rappela les limites et les devoirs de chacun. Le travail de mémoire occupa une place centrale. Les musées et les centres d'archives devinrent des lieux d'enquête et d'apprentissage. Les politiques culturelles furent repensées pour intégrer récits, œuvres et témoins venus de contextes différents. La capitale, redevenue lieu de pouvoir, devint aussi un espace de création, d'innovation et de débat, aimant pour chercheurs, artistes et entrepreneurs.
Il ne faut pas réduire 1990 à une simple annexion. Le cadre fédéral a fourni des institutions robustes, mais il a aussi absorbé des pratiques et des besoins spécifiques. Des lois furent révisées, des dispositifs sociaux adaptés, des symboles réinterprétés. Bonn conserva des fonctions et des institutions internationales, illustrant une continuité utile. Berlin attira capitaux, talents et investissements, puis diffusa vers l'est un dynamisme urbain qui alimenta des réseaux nouveaux et rééquilibra peu à peu la carte des activités.
La fête du 3 octobre prit avec le temps une valeur pédagogique. Chaque édition met à l'honneur un Land différent, organise cérémonies, concerts, expositions et rencontres et rappelle le sens de l'entreprise collective. Elle permet de mesurer ce qui a été acquis et ce qui reste à faire. Elle inscrit l'événement dans un récit accessible aux générations qui n'ont pas connu le Mur et pour qui l'unité nationale est un donné. Elle rattache l'Allemagne à l'idée d'une couture patiente, visible dans les paysages recomposés, les gares rénovées, les centres historiques restaurés, les campus agrandis.
Au terme de trois décennies, la réunification apparaît comme une œuvre de patience. Des investissements massifs ont changé des paysages entiers. Des entreprises ont été perdues, d'autres créées, des savoir faire maintenus ou recréés. Les fractures politiques ne se superposent pas mécaniquement à l'ancien tracé, signe que d'autres clivages, sociaux et territoriaux, se sont affirmés. La longue durée continue de travailler les structures sous l'effet de la démographie, de la technologie et de la mobilité. Les prochains chapitres diront jusqu'où la transition énergétiques, les innovations industrielles et les recompositions géopolitiques prolongeront ce mouvement.
3 octobre 1990 ouvre donc un chapitre sans le conclure. Le mouvement fut rapide dans ses décisions fondatrices et lent dans ses effets profonds. Il a modifié l'Europe en consolidant une puissance démocratique insérée dans des alliances. Il a transformé l'Allemagne en recomposant espaces, institutions et imaginaires. La frontière d'hier est devenue articulation. La date devenue fête nationale dit moins un triomphe qu'une volonté et rappelle que l'histoire s'écrit dans l'accord patient des temps.