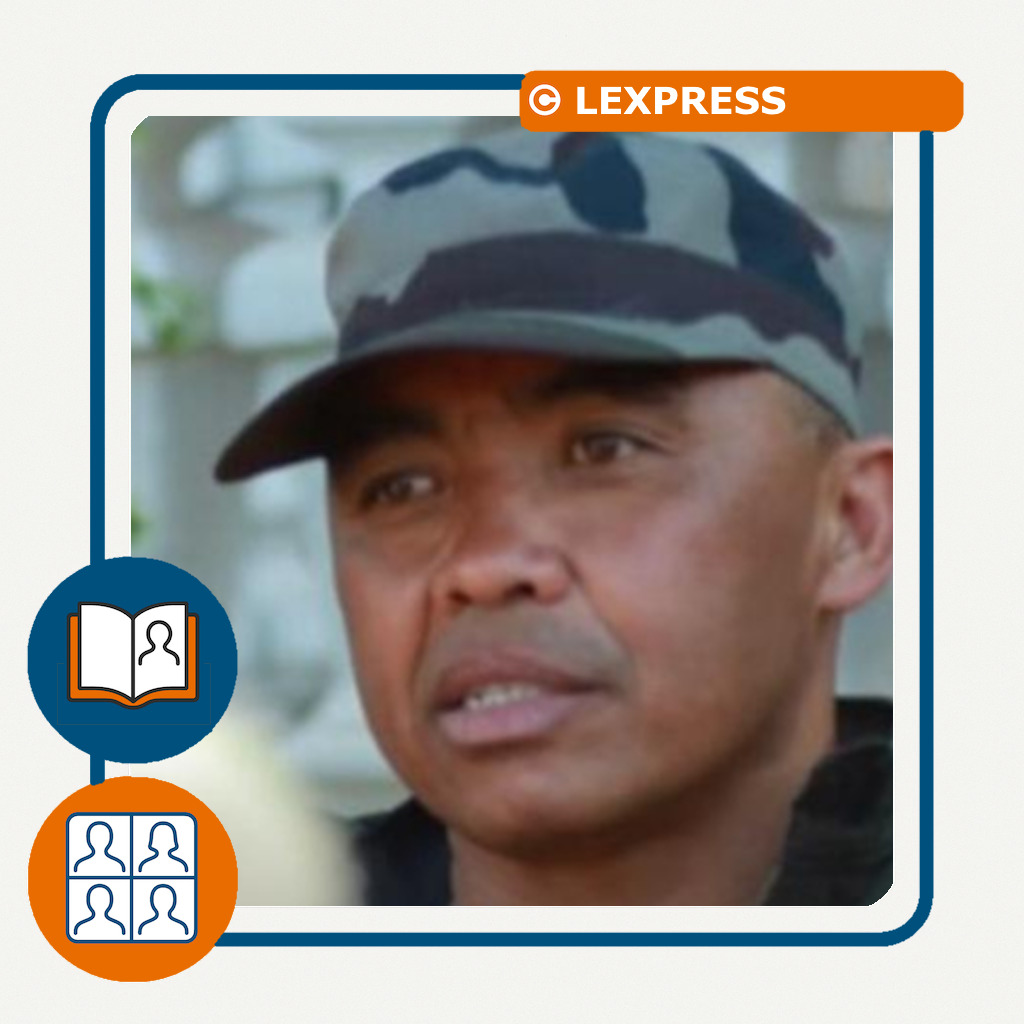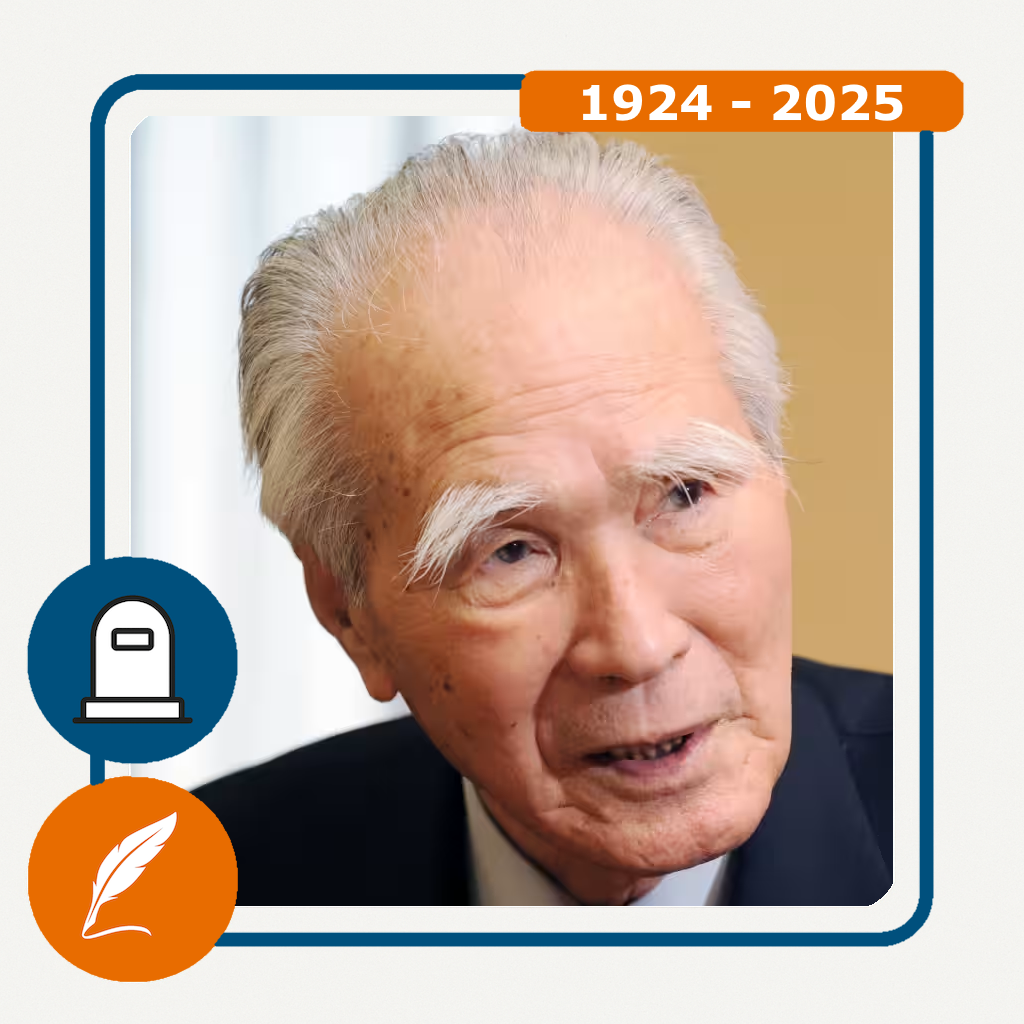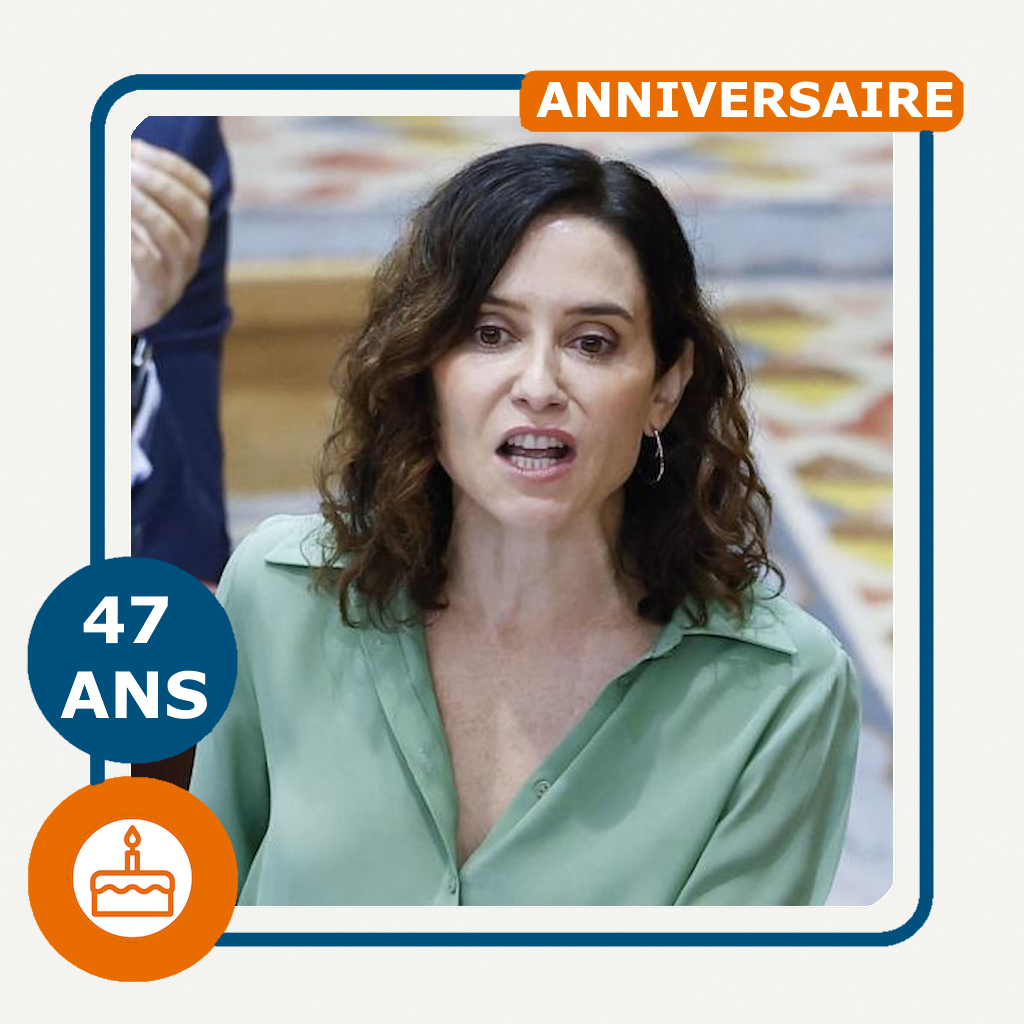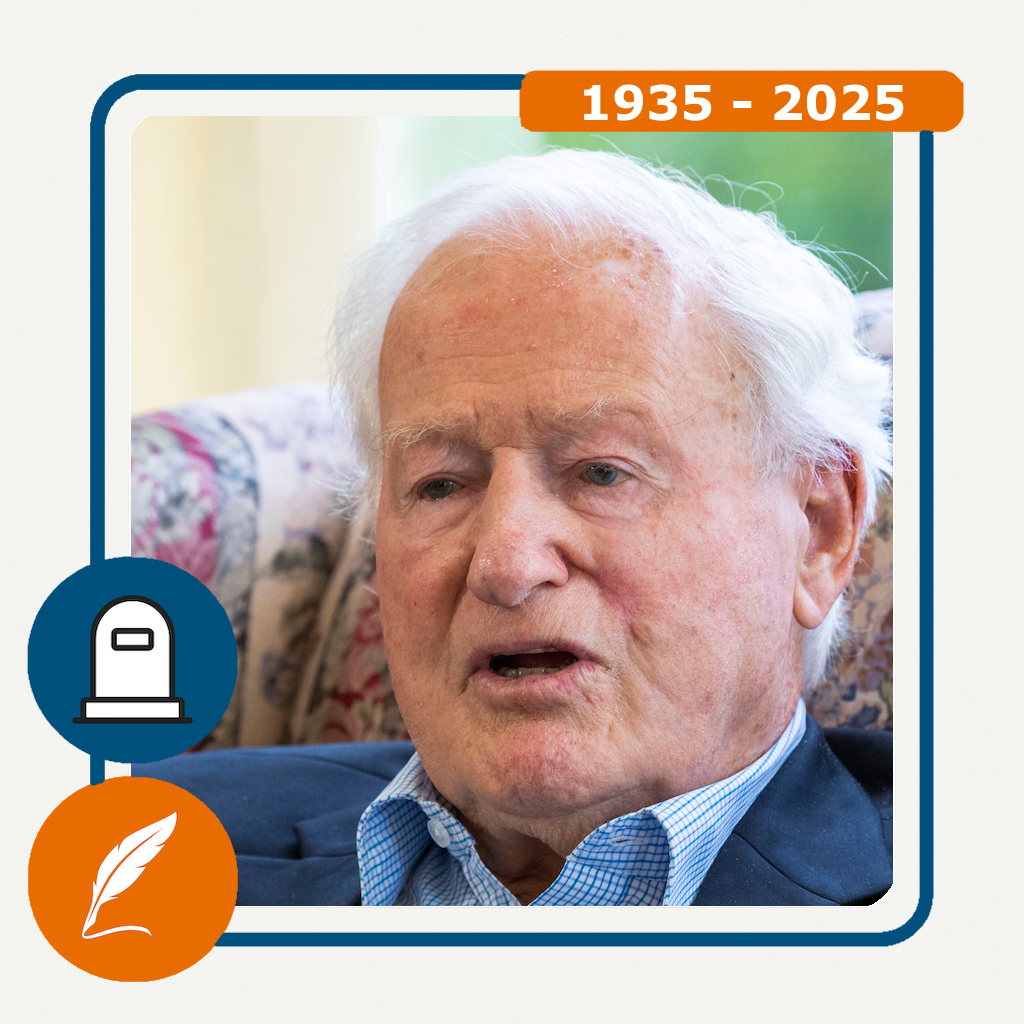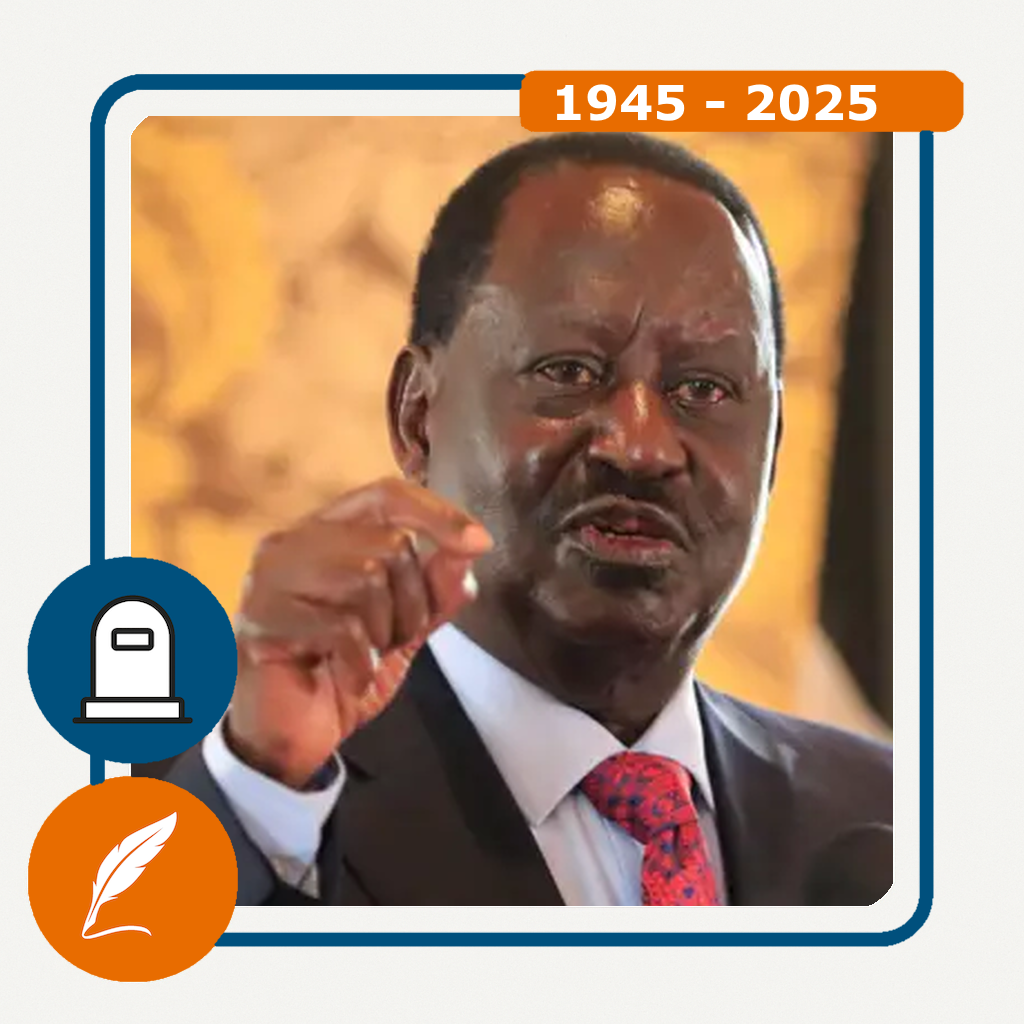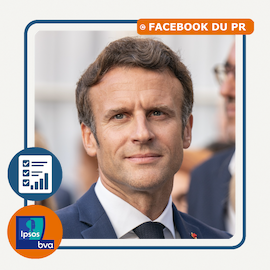INDONESIE - ANNIVERSAIRE
INDONESIE - ANNIVERSAIRE
Prabowo Subianto, un soldat dans la démocratie indonésienne
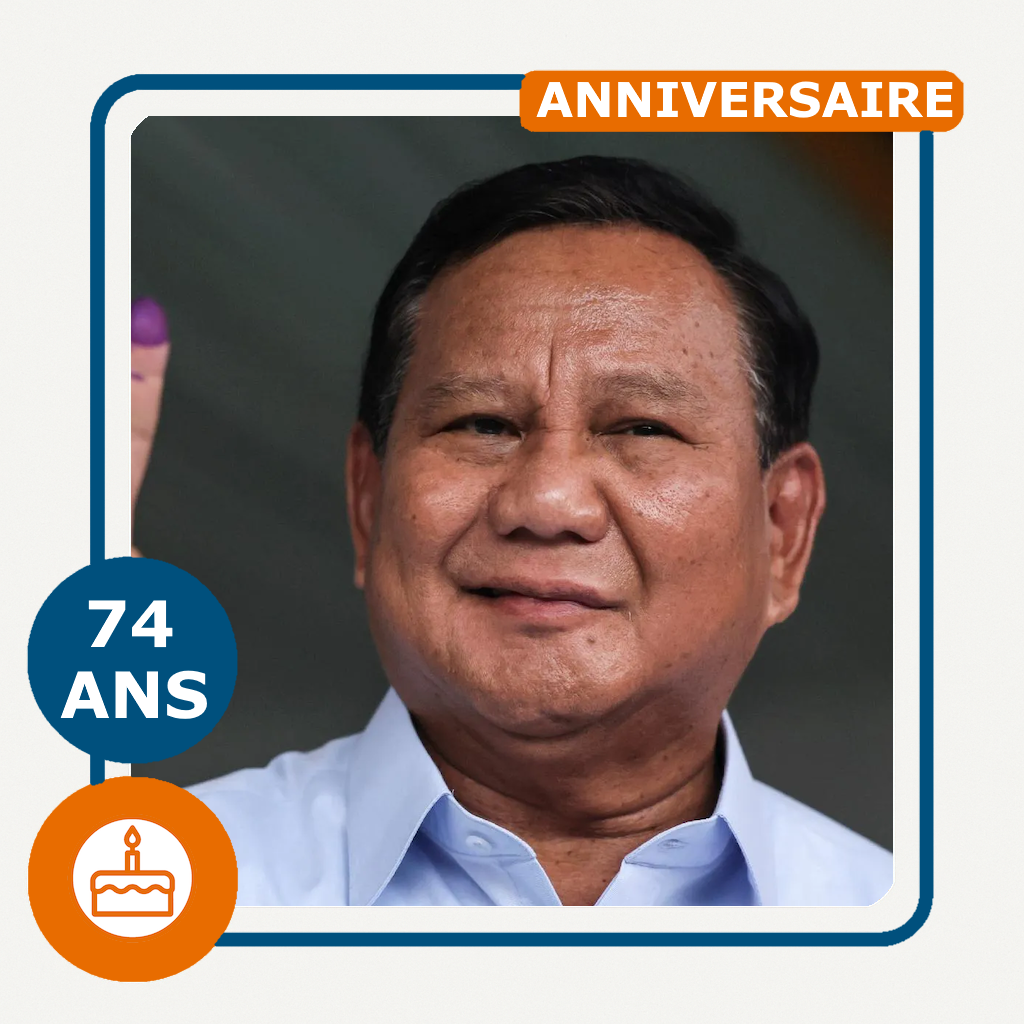
Né le 17 octobre 1951 à Jakarta, Prabowo Subianto grandit au carrefour des puissances et des mémoires d’un archipel en construction. Il fête aujourd'hui ses 74 ans.
Son père, l’économiste Sumitro Djojohadikusumo, a servi successivement les gouvernements de Sukarno puis de Suharto, figure d’un État développeur qui cherche sa voie entre planification et marché. Sa mère, Dora Marie Sigar, issue de la communauté minahasa du nord de Sulawesi et de confession protestante, relie l’enfance à une mosaïque religieuse et régionale plus vaste que Java. Les premières années sont marquées par les voyages forcés et les écoles étrangères, conséquence d’une famille ballotée par les changements de cap politiques. Singapour, Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, puis Londres composent une géographie scolaire; le jeune garçon y apprend la plasticité des langues, des usages et des disciplines, et l’importance silencieuse des frontières.
Ce cosmopolitisme n’efface pas la volonté d’ancrage. De retour au pays, Prabowo choisit l’Académie militaire de Magelang, décision qui le place au cœur d’un État où les forces armées tiennent encore la matrice de l’ordre. L’institution imprime sa marque: ascèse, hiérarchie, endurance, amour du détail logistique. Diplômé au milieu des années 1970, il rejoint les unités spéciales qui formeront la Kopassus, bras sélectif de l’armée de terre. À l’est, au Timor, une guerre irrégulière oppose l’armée indonésienne à des combattants nationalistes; le relief commande la tactique, la mobilité décide de la journée. Le jeune officier y apprend la poursuite, l’infiltration, la lecture des cartes et des villages. Son nom s’attache à la recherche des chefs de la guérilla, dans un théâtre où l’État entend imposer l’unité par la force et par le quadrillage.
L’avancement suit la logique d’une carrière rapide. Au milieu des années 1990, Prabowo prend la tête de la Kopassus; en 1998, il devient commandant du Kostrad, la réserve stratégique de l’armée de terre, antichambre de plusieurs ambitions nationales. Le destin privé se mêle alors au destin public. En 1983, il a épousé Siti Hediati Hariyadi, dite Titiek, fille du président Suharto; l’alliance familiale renforce l’inscription d’un officier prometteur dans un système politico-militaire où l’autorité s’articule autour de la parenté, des réseaux d’affaires et des corps armés. En 1984 naît leur fils, Ragowo Hediprasetyo, bientôt connu comme Didit, qui se détournera des armes et des ministères pour choisir la mode et l’atelier, à contre-pied d’un lignage de fonctionnaires et de militaires.
Puis vient la crise. En 1997-1998, la tourmente asiatique brise les assurances économiques; les villes se soulèvent; l’Ordre nouveau se fissure; la démission de Suharto ouvre une transition incertaine. Le nom de Prabowo se trouve alors associé aux opérations clandestines de la période, avec l’enlèvement de militants pro-démocratie et des disparitions qui laisseront des blessures morales et politiques. Un conseil d’honneur d’officiers retient contre lui une responsabilité pour avoir mal interprété des ordres; la hiérarchie militaire l’écarte de ses fonctions; le pouvoir politique réorganise ses sommets. L’épisode marque une rupture biographique décisive: l’officier de premier plan quitte la scène en uniforme, sous le regard d’une société qui apprend à énoncer publiquement la critique et la mémoire des violences.
La reconversion passe par l’entreprise. Au tournant des années 2000, Prabowo accompagne son frère cadet Hashim dans la reprise et la direction d’actifs industriels et agricoles. Une grande papeterie du Kalimantan, rebaptisée Kertas Nusantara, symbolise ces années d’investissement et de restructuration; s’y agrègent des sociétés d’énergie, des concessions minières, des plantations de palmiers à huile, des activités halieutiques et logistiques. Les préoccupations changent d’échelle: il faut financer, transporter, exporter; composer avec les marchés mondiaux et les communautés locales; négocier avec l’État et les gouvernements régionaux. L’archipel apparaît alors sous un autre angle, celui des barges, des routes en latérite, des ports secondaires, des logements d’ouvriers et des écoles d’entreprise plantées au cœur des concessions.
La politique pourtant revient, irrésistible, et propose un autre champ de bataille. Après une tentative de percée dans le Golkar en 2004, Prabowo opte pour la construction d’un instrument partisan à sa main. En février 2008 naît le Partai Gerindra, Mouvement de la grande Indonésie. La méthode est patiente et provinciale: constituer des équipes locales, investir les scrutins infranationaux, bâtir une base militante et électorale qui dépasse les capitales. Aux législatives de 2009, puis de 2014, le parti progresse; la tribune parlementaire nourrit une voix insistante sur l’ordre, la souveraineté économique, la protection des producteurs et le souci des perdants de la mondialisation. La quête présidentielle structure dès lors le calendrier: défaite en 2014 face à Joko Widodo, nouvelle défaite en 2019, puis ralliement stratégique à un gouvernement d’union où Prabowo devient ministre de la Défense.
Ce détour ministériel recompose l’image publique. Le portefeuille de la Défense, de 2019 à 2024, donne l’occasion d’afficher une modernisation de l’outil militaire, de multiplier les échanges avec les alliés et fournisseurs, d’arpenter l’archipel à la manière d’un inspecteur des forces et des infrastructures. Dans le même temps, Gerindra continue d’étendre ses relais; le pays entre en campagne; l’ex-adversaire Jokowi se mue en partenaire de stabilité; les lignes d’alliance se déplacent. Pour 2024, Prabowo choisit pour colistier Gibran Rakabuming Raka, fils du président sortant, incarnation d’un pari générationnel et d’une continuité économique revendiquée. La controverse juridique sur l’âge minimal du vice-président échauffe les tribunes; les opposants dénoncent l’avantage de la machine étatique; la justice tranche; la campagne déroule son récit.
Le 14 février 2024, le ticket Prabowo-Gibran obtient la majorité absolue. Les recours sont rejetés; les adversaires reconnaissent la décision des juges; la transition s’organise. Le 20 octobre 2024, au complexe parlementaire de Jakarta, Prabowo prête serment comme huitième président de la République d’Indonésie. Une nouvelle grammaire du pouvoir s’installe, mélange d’autorité assumée, de gestes sociaux spectaculaires et d’affichage de souveraineté économique. La promesse la plus visible est celle des repas scolaires gratuits, conçus comme un investissement de capital humain à large portée; l’autre grand chantier tient au transfert progressif de fonctions publiques vers la nouvelle capitale Nusantara, au Kalimantan, destinée à désengorger Jakarta, à réduire les inégalités spatiales et à signaler une ambition nationale de long terme.
La mise en œuvre révèle aussitôt les contraintes. Les finances publiques doivent absorber des politiques sociales élargies sans inquiéter les agences de notation; la décarbonation graduelle de l’économie demande d’articuler métallurgie du nickel, chaînes de valeur des batteries et protection des forêts tropicales; la pêche et l’agriculture doivent concilier productivité, souveraineté alimentaire et soutenabilité. Les gouvernements locaux, puissants dans une Indonésie décentralisée, deviennent des partenaires décisifs ou des freins silencieux. Les débats sur le prix du riz, la logistique des îles extérieures, la scolarité et la santé montrent qu’un État archipélagique doit d’abord coudre, relier et redistribuer. Dans ce cadre, la présidence recherche un équilibre entre centralisation des impulsions et délégation de l’exécution.
La politique étrangère prolonge ces arbitrages. Prabowo assume un non-alignement actif: coopération sécuritaire avec les États-Unis, commerce et investissement avec la Chine, technologies et normes avec le Japon, la Corée et l’Europe, solidarité au sein de l’ASEAN, art du compromis dans les forums multilatéraux. Les visites d’usines et d’académies militaires s’enchaînent; la mer de Chine méridionale exige vigilance et diplomatie; la stratégie industrielle se mue en diplomatie des minerais. L’Indonésie, puissance moyenne et tête de pont du monde insulaire, revendique une autonomie stratégique, tout en acceptant les interdépendances qui structurent la mondialisation. Ici encore, la matrice militaire se marie à une lecture économique du monde, et l’héritage partisan sert de colonne vertébrale à la négociation.
Rien n’efface pourtant l’ombre des années 1997-1998. Les enlèvements et les violences de la fin de l’Ordre nouveau demeurent un point de friction dans l’espace public; la mémoire timoraise revient au gré des débats; la place des forces spéciales dans la transition démocratique continue d’être interrogée. La démocratie indonésienne, bruyante et pluraliste, exige des résultats visibles et une protection concrète des droits. La presse, les ONG, les universitaires, les partis d’opposition testent la promesse d’un État ferme mais légaliste. La réponse présidentielle se veut institutionnelle et programmatique: validation électorale, contrôle juridictionnel, politiques distributives, promesse d’industrialisation, coordination renforcée avec les provinces. Là se joue l’épreuve de crédibilité d’un homme longtemps perçu à travers la silhouette du sabre.
Le théâtre domestique comprend aussi la scène intime. Le divorce de 1998 n’a pas rompu les apparitions communes; l’ancienne épouse figure dans certaines cérémonies; le fils, créateur installé entre Paris et Jakarta, incarne une forme de diplomatie douce qui habille la solennité d’un régime. On mentionne des chevaux dans les collines de Bogor, passion de cavalier qui dit le goût de la maîtrise et du tempo; on aperçoit des chats adoptés, images domestiques d’une communication contemporaine. Ces notations ne sont pas anecdotiques. Elles suggèrent un art de présidence où la liturgie d’État et la simplicité affichée cohabitent, pour raconter un dirigeant à la fois proche et hiératique, soucieux d’ordre et de visibilité, entouré d’un cercle familial qui sert de relais symbolique.
Au total, la trajectoire compose une grammaire politique. L’enfant de l’itinérance a appris l’adaptation aux langues et aux codes; l’officier des forces spéciales a appris la vitesse, la logistique et la discrétion; l’entrepreneur a appris la matérialité des flux et des prix; le chef de parti a appris la patience des coalitions et des provinces; le ministre a appris l’administration des moyens; le président doit orchestrer l’ensemble pour produire des effets mesurables dans la vie des habitants. Cette addition d’expériences confère des atouts: connaissance des territoires, sens des hiérarchies, accès aux capitales étrangères. Elle charrie aussi des angles morts: tentation du commandement vertical, mémoire conflictuelle, difficulté à accepter les délais d’une société ouverte. Entre ces pôles se joue la réussite d’un mandat.
Reste la longue durée, celle qui dépasse les individus et juge les politiques à l’aune des structures. L’Indonésie, nation de détroits et de failles, demande d’abord de relier: les îles par les ports, les régions par les routes, les écoles aux usines, les ressources à la valeur ajoutée locale. Le récit de Prabowo Subianto ne se réduit pas à un retour d’influence; il s’inscrit dans une tentative de transformer des rentes en capacités, des proclamations en services, des coalitions en institutions. Il raconte la tension permanente entre autorité et pluralisme, entre centralisation et décentralisation, entre vitesse et délibération. Qu’il réussisse ou échoue, sa biographie éclaire un pays qui, depuis l’indépendance, cherche à concilier l’unité et la diversité, la mer et la terre, la loyauté et la critique.