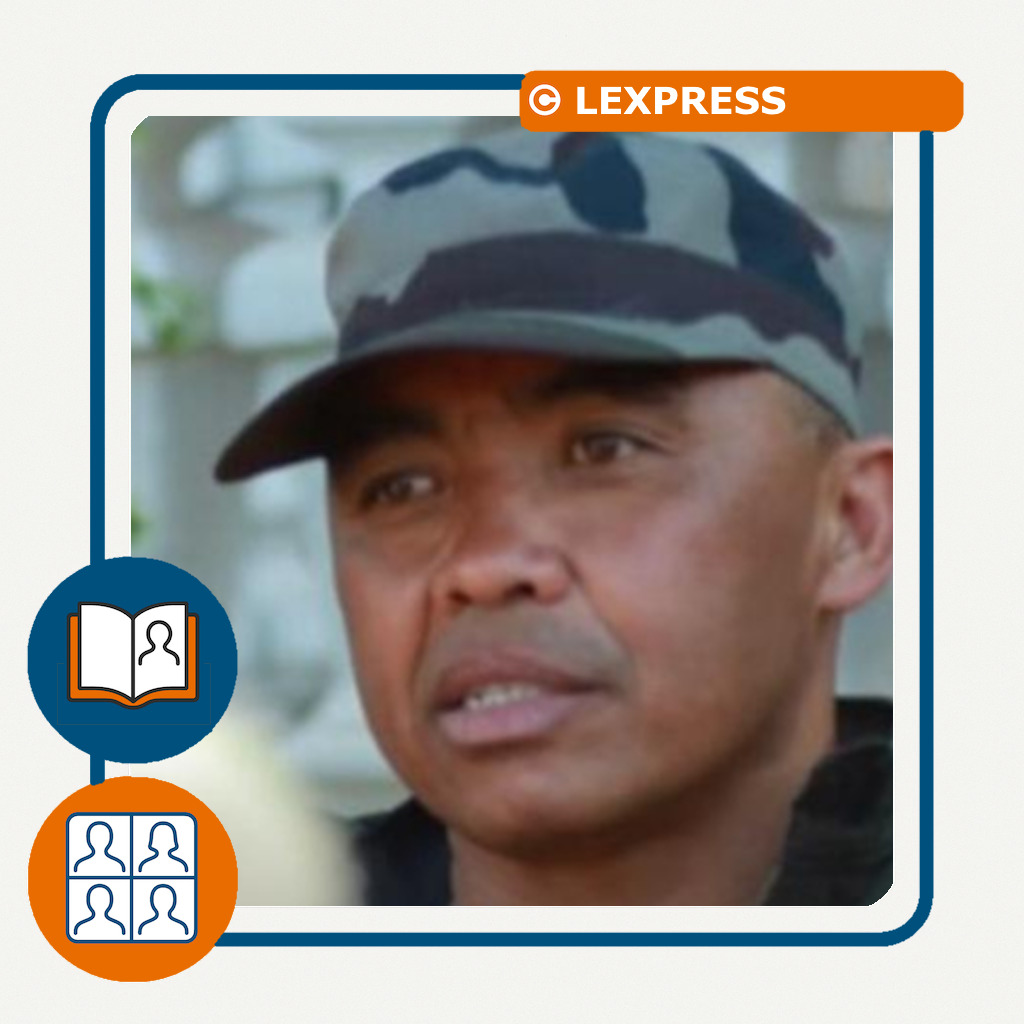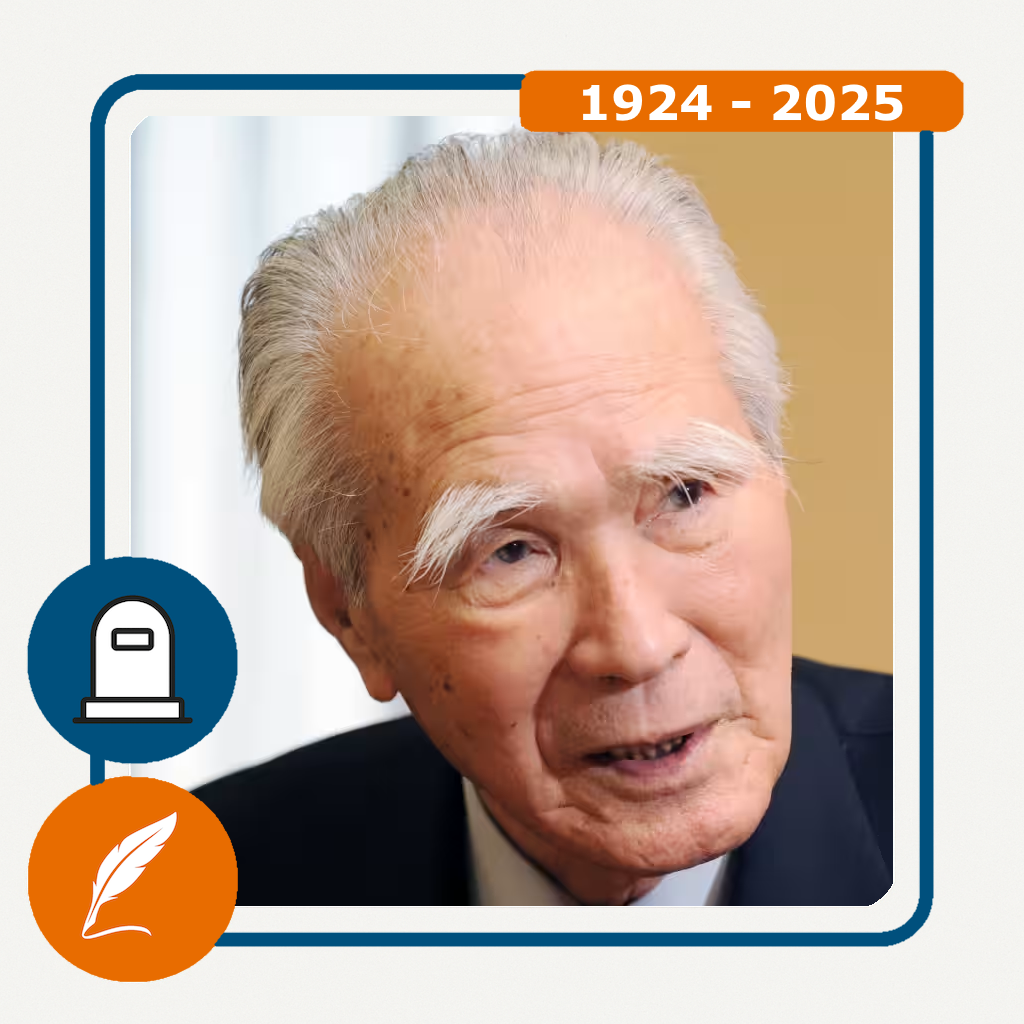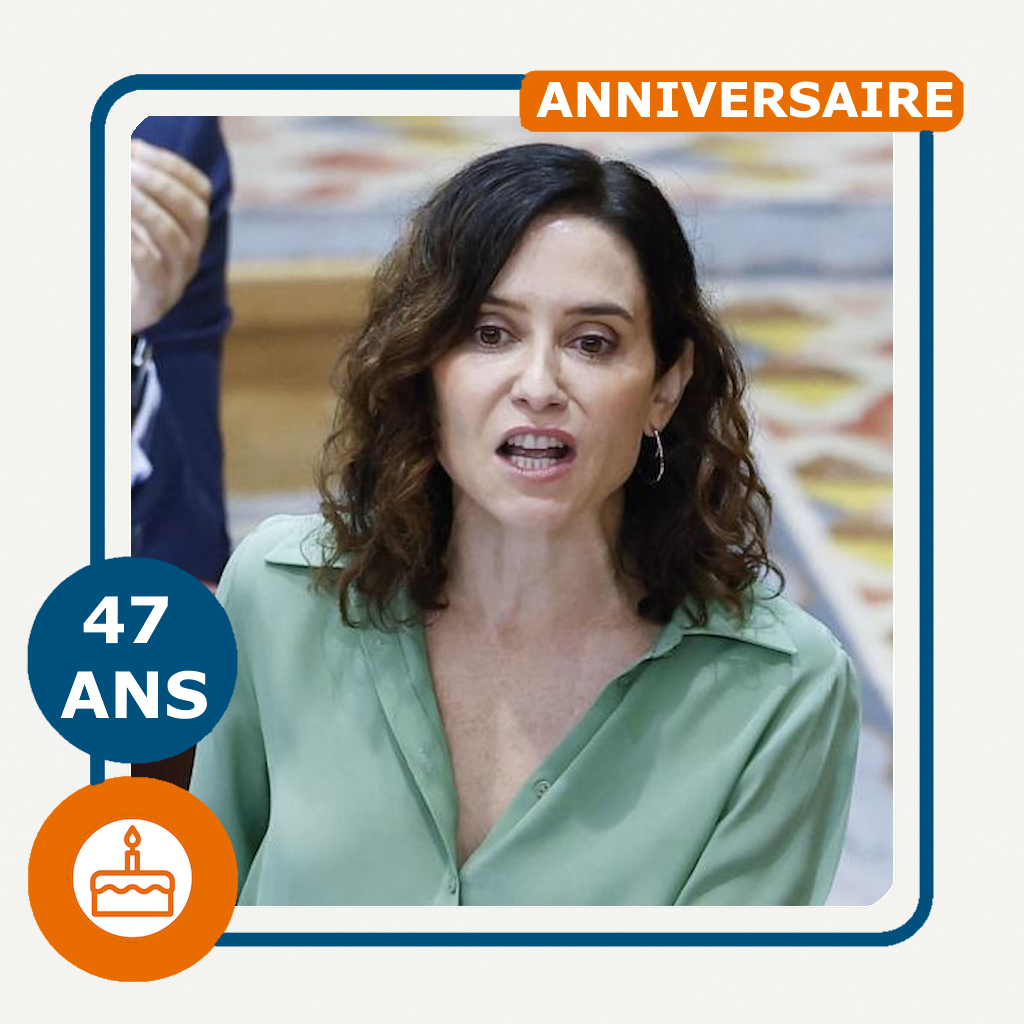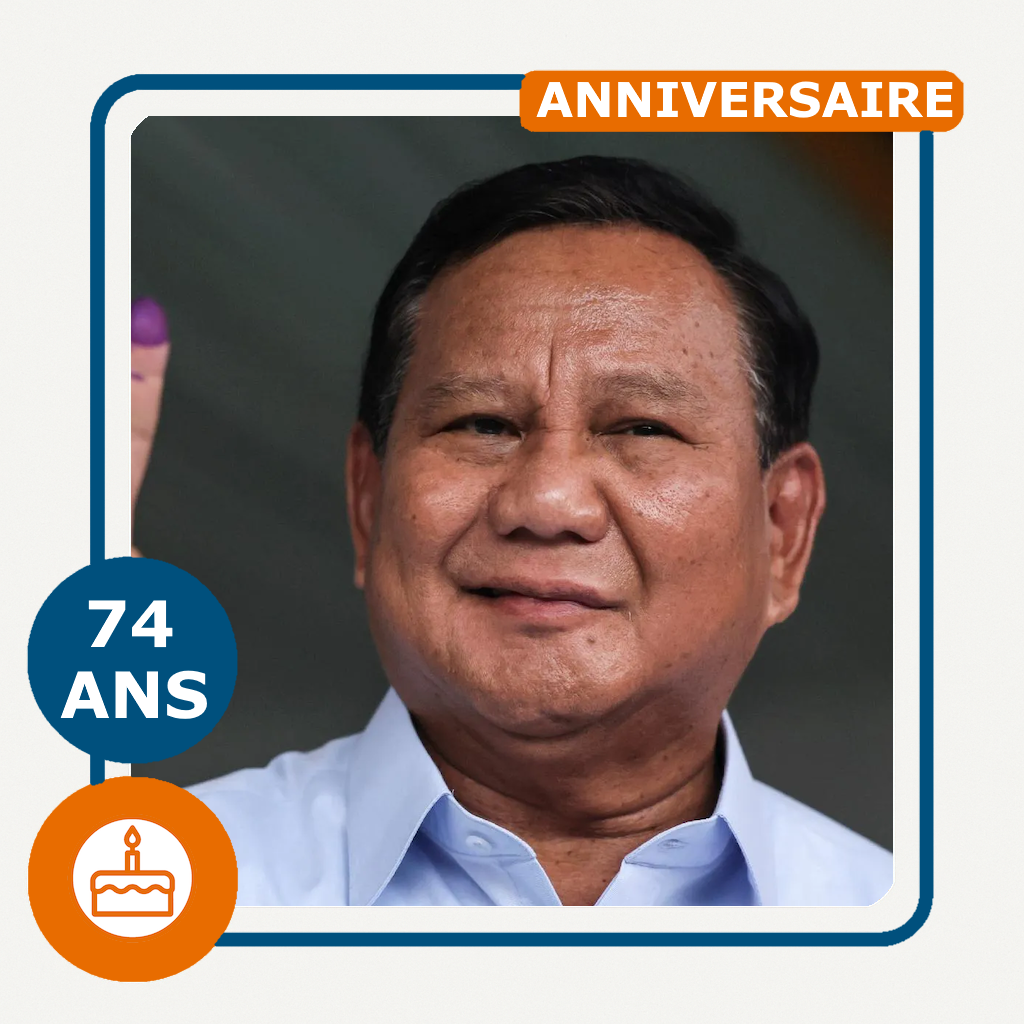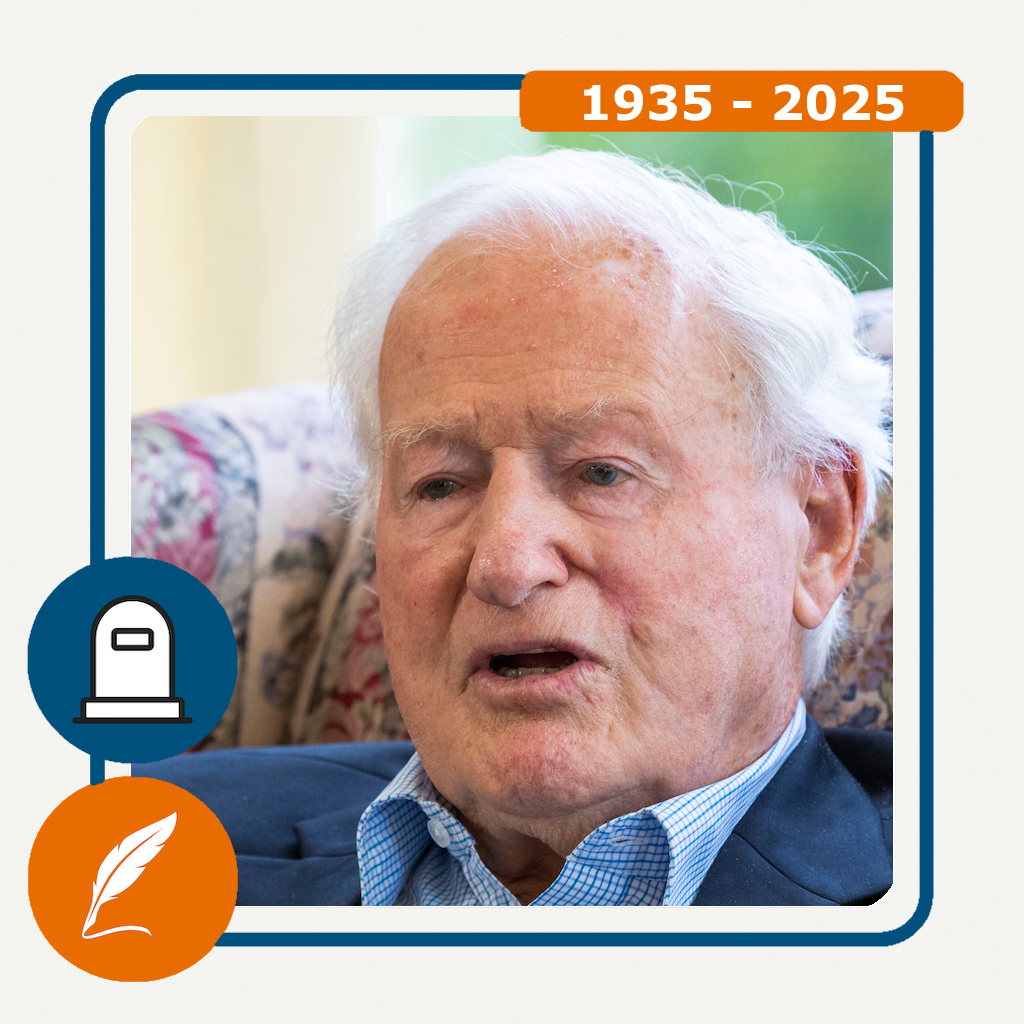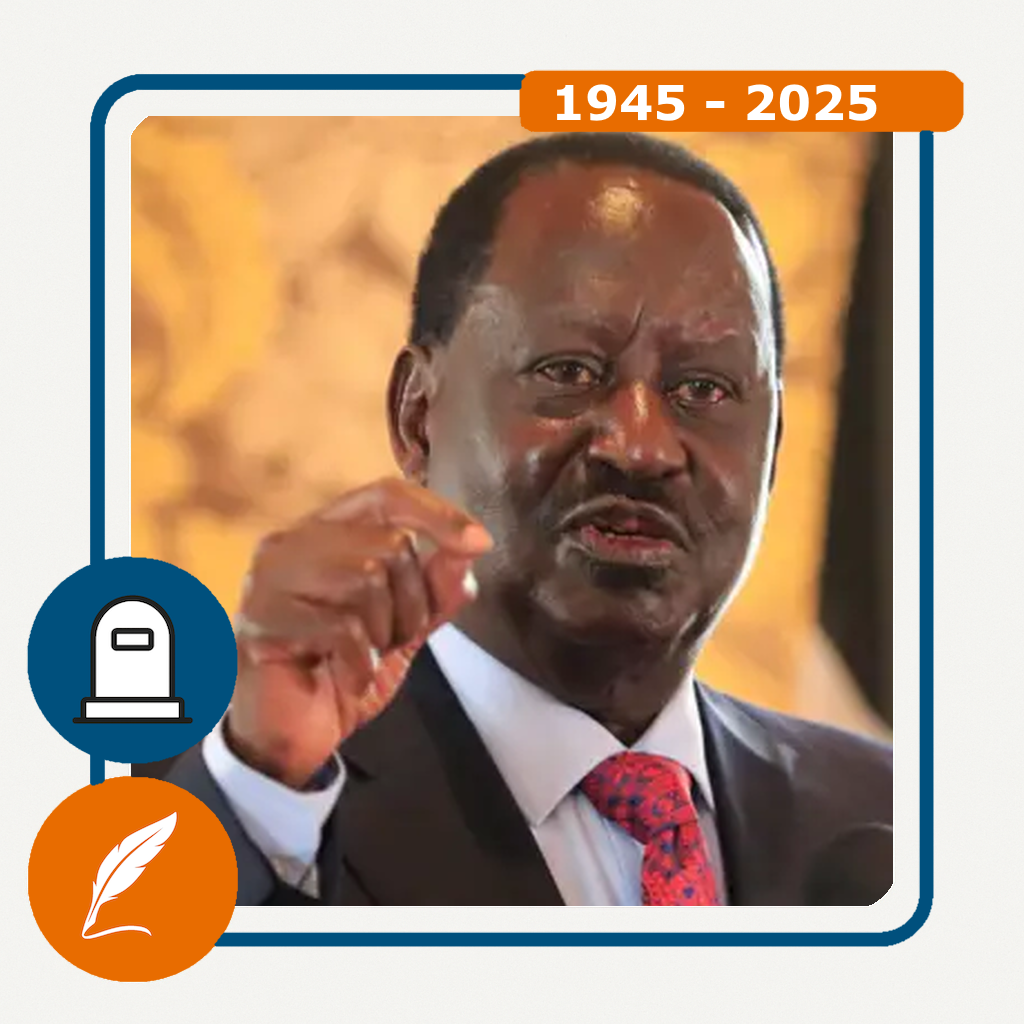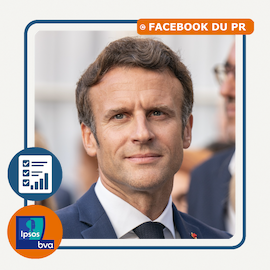FRANCE - ANNIVERSAIRE
FRANCE - ANNIVERSAIRE
Joseph Laniel, un conservateur de la reconstruction

Né le 12 octobre 1889 à Vimoutiers, dans l’Orne, Joseph Laniel grandit au cœur du pays d’Auge, dans une famille où l’industrie textile rythme la vie et les ambitions. Nous célébrons aujourd'hui le 136ème anniversaire de sa naissance.
Son père, Henri, conjugue manufacture et mandat parlementaire, transmettant à la maison une culture de gestion, d’épargne et de responsabilité publique. L’enfant observe les ateliers, les marchés, la prudence des comptes, et comprend qu’un territoire se gouverne comme une entreprise: par l’attention portée aux flux, aux hommes et aux outils. Élève sérieux plutôt que brillant, il acquiert une méthode, faite de patience et de calcul mesuré, qui deviendra sa signature.
La Première Guerre mondiale fracture cette enfance ordonnée. Appelé, officier d’abord en cavalerie puis en artillerie, il découvre la chaîne logistique de la guerre moderne, où le mouvement des troupes dépend du rail, du charbon et des munitions. Il sort du conflit capitaine et décoré. De la mêlée, il garde une conviction: un pays se tient par sa discipline financière autant que par le courage de ses soldats. Démobilisé, il reprend l’affaire familiale, puis se porte vers les mandats de proximité. Conseiller général de Livarot dès 1919, maire de Notre?Dame?de?Courson à partir de 1922, il apprend à administrer la voirie, le budget, les réparations, avec la parcimonie des régions rurales.
L’entrée au Palais?Bourbon, en 1932, prolonge ce parcours. Député du Calvados, il siège au centre droit, attaché à la stabilité monétaire et au libéralisme économique. Les années 1930 bousculent la prudence provinciale: crise, déflation, tensions internationales. En mars 1940, Paul Reynaud l’appelle comme sous?secrétaire d’État aux Finances. Il défend l’assainissement des comptes dans une situation militaire désormais désespérée. La débâcle entraîne le choc de Vichy. Le 10 juillet 1940, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, persuadé qu’il faut préserver l’État et l’ordre. Installé avec sa famille à proximité de la nouvelle capitale administrative, il manifeste toutefois des réserves à l’égard du régime, visite Paul Reynaud détenu, interpelle Laval. Après l’invasion de la zone sud, il regagne Paris. En mai 1943, approché par des réseaux de Résistance, il assiste, au titre de l’Alliance démocratique, à la réunion fondatrice du Conseil national de la Résistance. C’est moins une conversion qu’un calcul de salut public: il s’agit d’adosser la légitimité combattante à des traditions parlementaires.
À la Libération, Laniel siège à l’Assemblée consultative. Son obsession redevient la réparation. Le Calvados a été ravagé; il plaide pour l’indemnisation intégrale des dommages, refuse les demi?mesures qui ruineraient les propriétaires déjà sinistrés. Sur Bretton Woods, il accepte la contrainte internationale au nom du retour à la concurrence et de la modernisation. Hostile aux nationalisations généralisées, il admet les nécessaires appuis d’État. Il participe en 1945 à la fondation du Parti républicain de la liberté, qui tente d’organiser une droite parlementaire non gaulliste. Vice?président des deux Assemblées constituantes, puis de l’Assemblée nationale, il demeure un député de commissions: finances, reconstructions, assurances, toujours attentif aux sinistrés et aux équilibres régionaux.
Les portefeuilles s’enchaînent par épisodes courts. En 1951, il devient ministre des PTT dans le gouvernement Pleven, puis ministre d’État aux Finances après la mort de Maurice Petsche, et conserve cette compétence dans l’éphémère cabinet Edgar Faure de 1952. Son style reste le même: notes précises, peu de gestes, une priorité au solde. 1953 ouvre une crise d’investiture sans fin. Après l’échec successif de plusieurs candidats, le président Vincent Auriol se tourne vers lui. Le 28 juin 1953, Joseph Laniel devient président du Conseil. Il obtient une large investiture, forme un gouvernement mêlant indépendants, modérés et anciens du RPF, installe à la présidence du Conseil un centre de gravité budgétaire. Mais la première secousse vient de l’intérieur: l’été 1953 voit éclater une grève d’ampleur dans les services publics, provoquée par les décrets d’économie et d’allongement d’âge de départ à la retraite. La paralysie du pays révèle le coût social de la rigueur. Un accord est trouvé fin août, sans apaiser durablement les tensions.
À l’extérieur, deux dossiers dominent. Le premier est marocain: en août 1953, le résident général fait déposer le sultan Mohammed Ben Youssef. La décision, entérinée a posteriori, choque, fragilise la position française au Maghreb et alourdit le passif du cabinet. Le second est indochinois. Laniel n’espère plus une victoire totale; il veut négocier depuis une position de force. Dans ce cadre, l’état?major met en œuvre le plan Navarre et concentre des moyens à Diên Biên Phu. En février 1954, le camp est encerclé; le 7 mai, il tombe. La défaite militaire devient une crise politique. L’opinion, lasse, renonce à l’hypothèse d’une sortie par la victoire. La conférence de Genève s’ouvre; la France cherche une issue qui ménage l’honneur et limite les pertes. Au Parlement, les attaques se multiplient. En juin, la confiance est refusée. Laniel démissionne. Pierre Mendès France, conduit par une autre méthode et d’autres priorités, conclura les accords de Genève et mettra fin à la guerre d’Indochine.
L’après?gouvernement est une pente douce. Laniel retrouve son banc de député mais a perdu l’initiative. En 1956, ses résultats électoraux s’érodent. Il soutient néanmoins les pouvoirs spéciaux en Algérie, approuve la loi?cadre Defferre et la ratification des traités de Rome. En 1958, il vote l’investiture du général de Gaulle, puis la révision constitutionnelle et les pleins pouvoirs, convaincu que l’autorité exécutive et la stabilité institutionnelle valent, cette fois, l’abandon d’une part de la culture parlementaire où il a fait sa carrière. Sous la Ve République, il ne joue plus de rôle de premier plan. Il consigne ses souvenirs dans des mémoires, entre « jours de gloire » et « jours cruels », où il entend répondre aux critiques, assumer ses choix et rappeler sa méthode.
Sa vie privée reste discrète. Marié en 1920 à Lucienne Fougerolle, il s’enracine dans une sociabilité de notables normands faite de fidélités, de bienfaisance locale et de rigueur domestique. On le voit à Glos, aux abords de Lisieux, veiller sur l’entreprise, rendre des arbitrages, tenir la parole donnée. La famille, sans se confondre avec la politique, en demeure l’atelier moral. Dans le pays d’Auge, on retient son attachement aux sinistrés, sa défense opiniâtre des agriculteurs et des petites industries, son aversion des improvisations coûteuses. Le portrait d’époque le montre peu disert, tenace, parfois rugueux: un administrateur plus qu’un orateur, un stabilisateur plus qu’un visionnaire.
En longue durée, sa trajectoire éclaire un mouvement profond. La France des notables industriels provinciaux a fourni, jusqu’aux années 1950, des cohortes de parlementaires qui portaient à Paris le souci des budgets locaux, des assurances, des banques, des coopératives. Laniel en fut un modèle: il fit tenir l’État par l’épargne, l’impôt et la négociation, dans un temps où l’on construisait la Sécurité sociale, où l’on débattait de planification et de marché, où l’empire se défaisait. Son vote de 1940, que l’on peut juger à l’aune des ruines et des peurs, le suivit comme une ombre; sa présence au CNR, fruit d’un calcul utile, lui donna une part de légitimité dans la France libérée. Au pouvoir, il affronta la collision de la rigueur budgétaire et du conflit colonial, collision qui emporta son cabinet. Il s’effaça ensuite devant une nouvelle grammaire de l’exécutif.
Il meurt à Paris le 8 avril 1975, âgé de quatre?vingt?cinq ans. Il laisse l’image d’un homme de comptes, de réparations et de compromis, fidèle à sa région et à ses réseaux, constant dans ses priorités. À qui cherche une formule, sa vie en propose une, simple: compter, concilier, continuer. Elle dit ce que fut une partie de la IVe République, fragile mais tenace; elle dit aussi ce que furent les provinces qui l’alimentèrent en cadres, méthodes et corrections. Dans l’histoire de la France du xxe siècle, Joseph Laniel ne fut ni un inventeur ni un tribun; il fut un conservateur de la reconstruction, et cette fonction, modeste en apparence, fut parfois décisive.