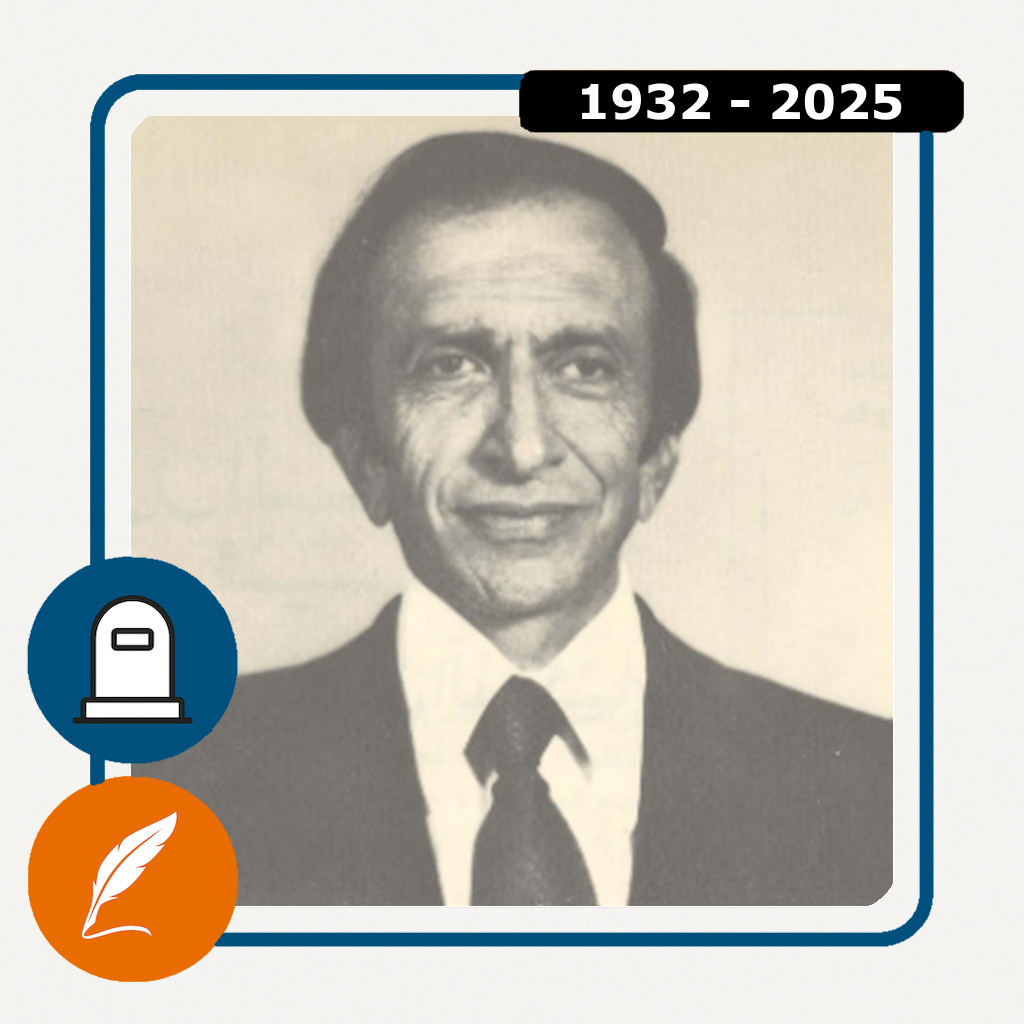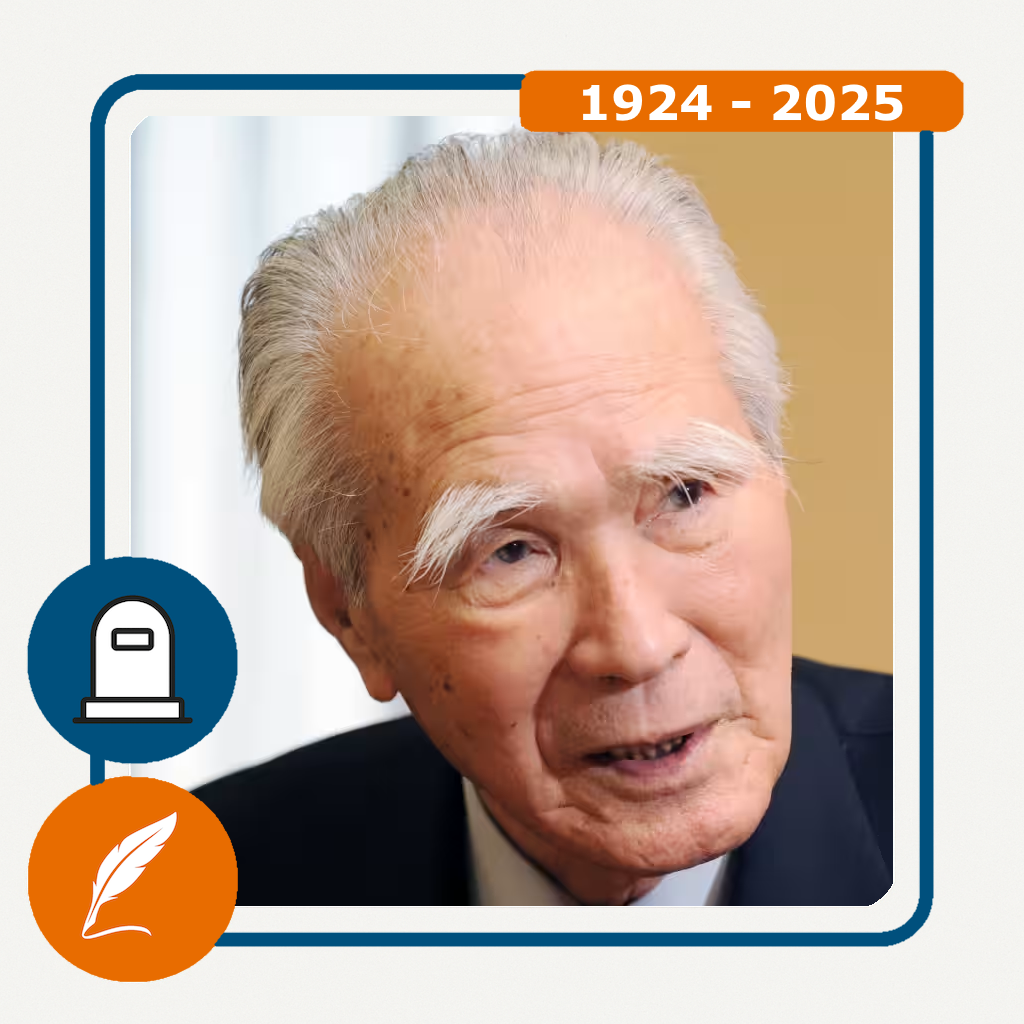ARGENTINE - ANNIVERSAIRE
ARGENTINE - ANNIVERSAIRE
Javier Milei, le lion face à la caste

Né le 22 octobre 1970 à Buenos Aires, Javier Gerardo Milei grandit au rythme des crises argentines. Il fête aujourd'hui ses 55 ans.
Enfant de Palermo, puis de Villa Devoto et de Sáenz Peña, il vit dans une famille de classe moyenne où l’effort compte plus que les héritages. Son père, ancien chauffeur devenu entrepreneur, incarne l’ascension difficile dans une économie qui chancelle; sa mère tient la maison et protège la fratrie des secousses d’un pays instable. L’adolescent s’absorbe dans le football, la lecture, la musique rock, et découvre l’économie par la voie des chiffres et des controverses. Dans les années d’hyperinflation, il apprend que la monnaie n’est pas qu’un moyen d’échange: elle peut être une promesse brisée. Cette intuition, presque intime, oriente ses études et ses choix.
La vie privée de Milei demeure longtemps celle d’un célibataire concentré sur le travail intellectuel et la joute médiatique. Il chante un temps dans un groupe amateur, compose, imite sur scène les excès d’une énergie qui deviendra sa marque. Au cœur de sa sphère intime se trouvent ses mastiffs: d’abord Conan, compagnon fétiche, puis des clones obtenus après la mort de l’original. Il les présente comme des « enfants à quatre pattes », signe d’un attachement qui frappe les observateurs. On y lit à la fois le besoin de fidélité et la volonté d’ériger des symboles personnels. Sa sœur Karina occupe, dans cette intimité élargie, une place nodale: confidente, organisatrice, gardienne des temps et des priorités. Les liens affectifs, rares mais absolus, y structurent l’action plus sûrement que les sociabilités classiques.
Avant d’entrer en politique, Milei suit un parcours académique et professionnel classique pour un économiste argentin des années 1990 et 2000. Diplômé à Buenos Aires, titulaire de masters, il enseigne la macroéconomie, conseille des entreprises, publie des tribunes. Il travaille pour des groupes privés, discute de productivité, de coûts, de coordination monétaire. À l’écran, il gagne une notoriété fulgurante en défenseur d’un libertarianisme sans concessions, dénonçant la pression fiscale, la bureaucratie et le privilège réglementaire. Le plateau de télévision devient pour lui ce que fut jadis la chaire: un lieu de diffusion d’idées et un laboratoire de style. Il bâtit un langage de rupture, simple et brutal, qui tranche avec la liturgie prudente des technocrates.
La bascule s’opère au début des années 2020. Buenos Aires est saturée de colère sociale et d’épuisement démocratique. Avec la coalition La Libertad Avanza, Milei transforme l’audience médiatique en capital électoral. En 2021, il entre à la Chambre des députés; en 2023, il gagne la présidence après une campagne courte et tranchée qui oppose « caste » et « lions ». Sa promesse est radicale: équilibrer le budget, réduire l’État à ses fonctions régaliennes, libérer les prix, ouvrir les marchés, réformer le droit du travail, et, si les conditions le permettent, refonder la monnaie. Le pays arrive au rendez-vous avec une inflation annuelle inédite depuis des décennies, une pauvreté lourde, des réserves exsangues, un État captif de déficits répétés. Le vote qui le porte exprime l’épuisement d’un cycle plus que l’adhésion parfaite à un catéchisme économique.
Le début de mandat prend la forme d’un ordonnancement de choc. Dévaluation du peso, libération de tarifs, resserrement budgétaire, coupes dans les subventions, réduction des ministères, recentrage des entreprises publiques, règles simplifiées par décrets. Les unions appellent à la grève; des tribunaux retoquent des articles; des provinces protestent contre l’assèchement des transferts. L’inflation, d’abord, accélère sous l’effet de l’ajustement; puis les hausses mensuelles ralentissent et reculent. Cette séquence de « choc puis reflux » redessine les attentes, sans dissiper d’emblée les privations. Les paniers de base augmentent, les salaires réels tardent à se réparer, la pauvreté gagne un cran avant de refluer si la désinflation s’installe. La politique économique, ici, est une traversée: elle exige un temps que la démocratie compte en mois.
La politique extérieure s’aligne sur un axe assumé. Milei resserre les liens avec les États-Unis et Israël, promet de déplacer l’ambassade à Jérusalem, défend une diplomatie des affinités idéologiques plus que des équilibres régionaux. Il s’éloigne des initiatives sud-sud et garde ses distances avec la Chine tout en ménageant la relation commerciale. À l’ONU, ses déclarations dénoncent le terrorisme et exaltent la liberté individuelle; dans la région, il bouscule les usages du Mercosur, préfère les accords précis à l’intégration vague. L’alliance avec des partenaires financiers devient décisive pour recomposer les réserves, stabiliser les attentes et rouvrir l’accès aux marchés. Dans cette géopolitique des contraintes, il cherche un ancrage extérieur qui crédibilise l’effort intérieur.
Sur le terrain intérieur, l’épreuve est sociale et politique. Le « plan tronçonneuse » taille dans l’emploi public, fusionne des structures, revisite les contrats. Des hausses temporaires de taxes à l’export et la réforme de retraites spéciales renforcent la trésorerie. Les opposants invoquent l’atteinte aux droits sociaux et l’appauvrissement; les partisans applaudissent la rupture avec l’économie d’exception permanente. Dans un Congrès fragmenté, l’exécutif négocie, amende, retente des textes, assemble des majorités mouvantes avec des gouverneurs, des blocs libéraux-conservateurs et une fraction de l’ancienne droite. La fabrique de la loi devient un terrain de patience: un décret desserre, une loi consolide, un veto protège, une transaction débloque.
Le personnage demeure théâtral, mais la méthode se précise. Milei utilise les réseaux sociaux comme un banc d’essai de réformes et un thermomètre d’adhésion. Il cite Friedman, Hayek, Mises, Lucas, et revendique un langage de guerre contre l’inflation. Il rejette le terme de « justice sociale », qu’il considère comme une spoliation légalement organisée, et promeut les bons éducatifs, la liberté d’enseigner, la concurrence en santé, la propriété comme droit fondamental. Sa sœur Karina, « el Jefe », organise la garde rapprochée, filtre l’accès, règle l’horloge du pouvoir. La communication n’est pas un vernis: c’est un instrument de gouvernement, un moyen d’ordonner les priorités et de forcer l’agenda parlementaire.
Pour situer sa trajectoire, il faut la replacer dans la longue durée argentine. Depuis un siècle, le pays oscille entre industrialisation protégée et tentations d’ouverture, entre plans de stabilisation et rechutes. La dette réapparaît au gré des cycles mondiaux; l’épargne fuit la monnaie locale; la politique utilise la dépense comme amortisseur. Le péronisme a structuré un imaginaire de droits et de verticalité; les expériences libérales ont péché par impatience ou par inégalités non traitées. Milei cristallise un moment où la société accepte l’idée d’un coût immédiat pour une promesse de stabilité. Il parle au souvenir des années d’hyperinflation et aux classes moyennes fatiguées de l’érosion lente des salaires. Son récit oppose la discipline budgétaire aux privilèges d’intermédiation et promet des règles simples là où l’empilement réglementaire a produit la rente.
Trois chantiers conditionnent son héritage. D’abord la monnaie et la banque centrale: stopper le financement monétaire du déficit, reconstruire la courbe en pesos, accumuler des réserves, puis, seulement si les conditions le permettent, réformer l’ancrage de la monnaie. Ensuite les règles: simplifier pour attirer le capital sans abolir les contre-pouvoirs, créer des marchés du travail plus fluides sans accroître l’insécurité, lutter contre les rentes sans casser les territoires productifs. Enfin l’alliance politique: additionner les droites, convaincre une partie des péronistes provinciaux, stabiliser des coalitions régionales et convertir la désinflation en votes. Ce triptyque est une mécanique fragile où l’échec d’un pilier menace l’ensemble.
Dans la quotidienneté du pouvoir, les compromis s’empilent. La dollarisation glisse du mot d’ordre au cap; elle devient une option conditionnelle qui exige désinflation, actifs liquides et crédibilité. Les relations avec les partenaires varient au rythme des marchés et des échéances: une ligne de soutien extérieur offre de l’oxygène; les négociations avec l’IMF balisent les étapes; les investisseurs scrutent chaque vote, chaque décret, chaque chiffre d’inflation mensuelle. Les ministères se reconfigurent, des départs marquent l’apprentissage du collectif, une équipe resserrée prend la main. À mesure que les chocs initiaux s’estompent, l’exécutif tente de passer d’une stratégie de coupe à une stratégie de règles, de la hache au Code.
Il reste, sous la surface, une dimension intime qui éclaire le personnage public. Les chiens, omniprésents jusqu’à figurer sur le bâton présidentiel, disent la fidélité, la mémoire et l’idée d’éternité que nourrit la pratique des clones. La solitude choisie, entourée d’un petit noyau de proches, raconte une relation particulière au pouvoir, vécue comme mission plus que comme carrière. Des liaisons médiatisées s’interrompent sans détour, comme si le temps privé devait s’effacer devant l’agenda. La religion personnelle prend la forme d’une éthique de la responsabilité: ne pas promettre ce que le budget ne peut tenir, ne pas dépenser ce qui n’existe pas, faire de l’équilibre une norme et non un événement.
Quoi qu’il advienne, le nom de Milei restera lié à une tentative de refondation par l’austérité et la déréglementation. Si la désinflation s’enracine et que l’activité reprend, il aura ouvert un cycle nouveau où l’État vivra selon ses moyens et où l’investissement privé dessinera la trajectoire.