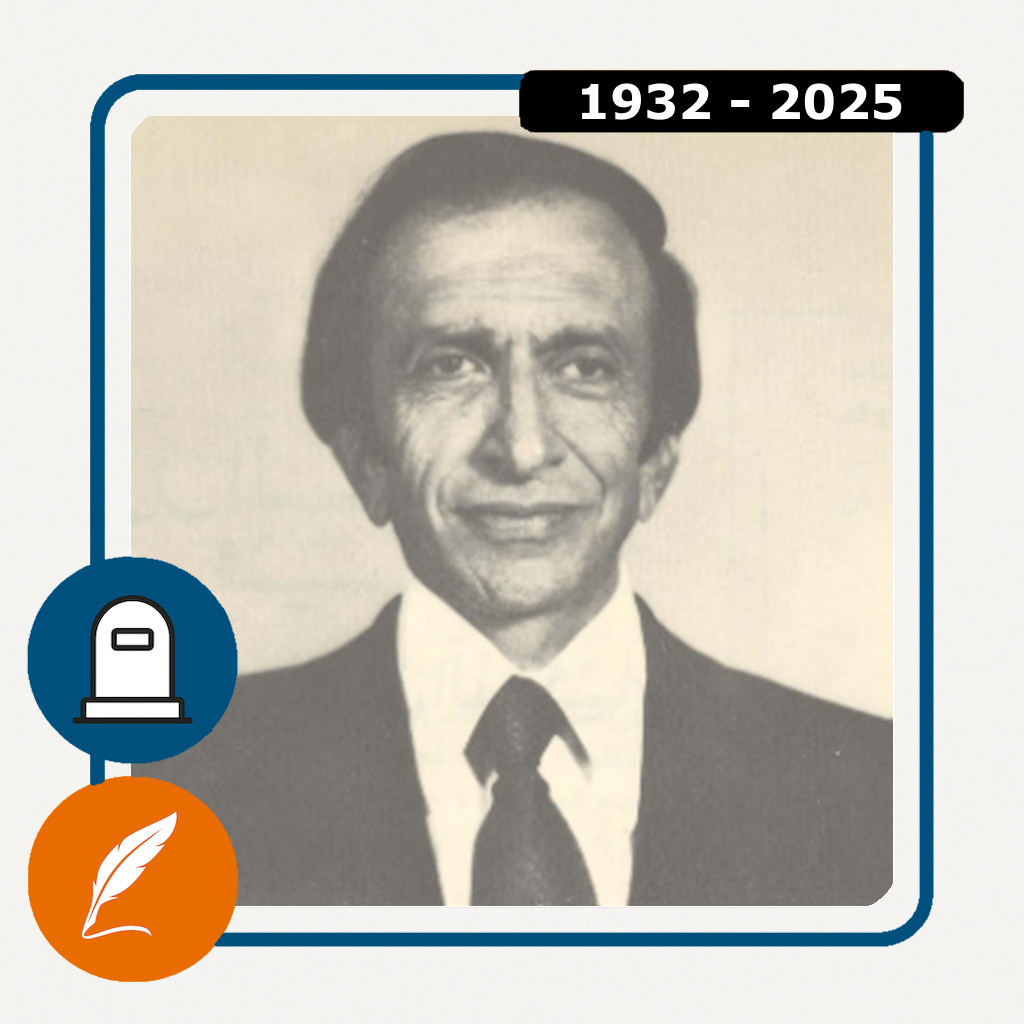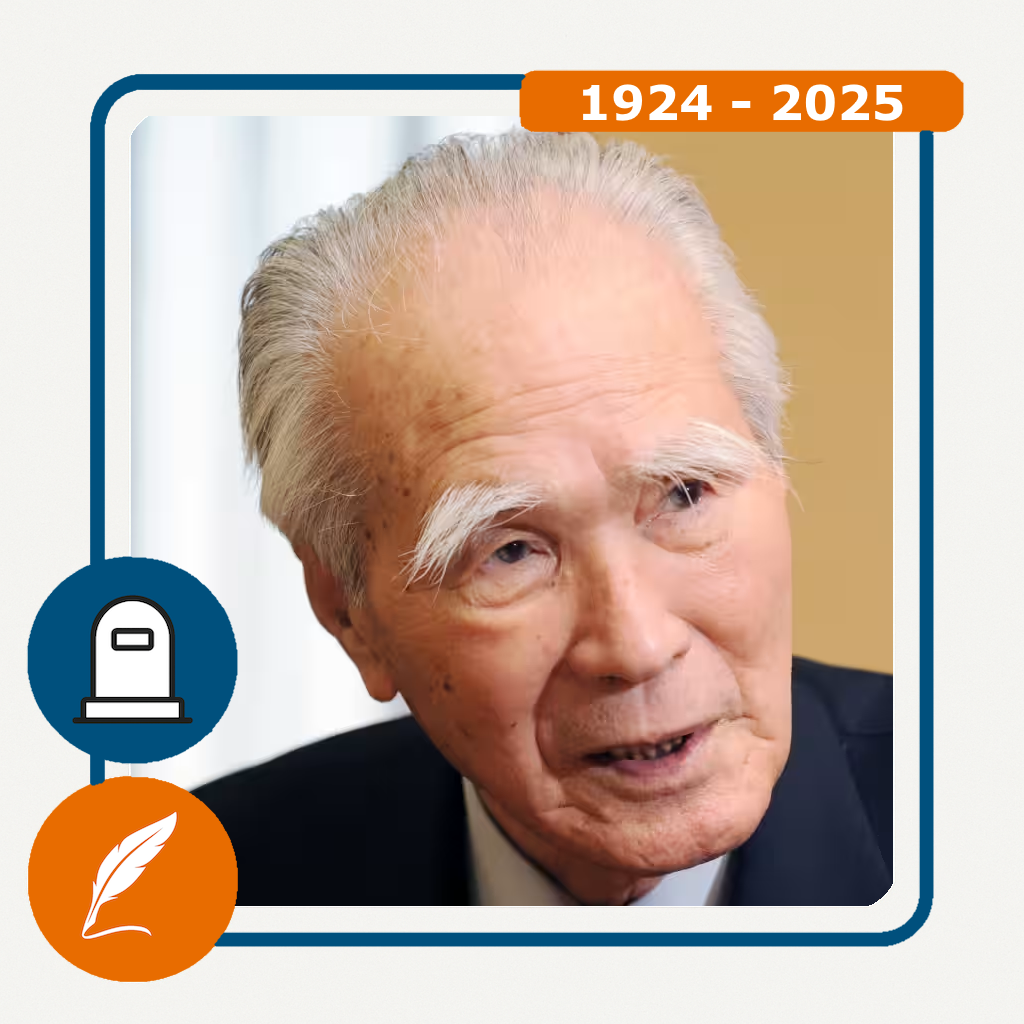SYRIE - NECROLOGIE
SYRIE - NECROLOGIE
Abdul Rauf al-Kasm, bâtir sous la contrainte
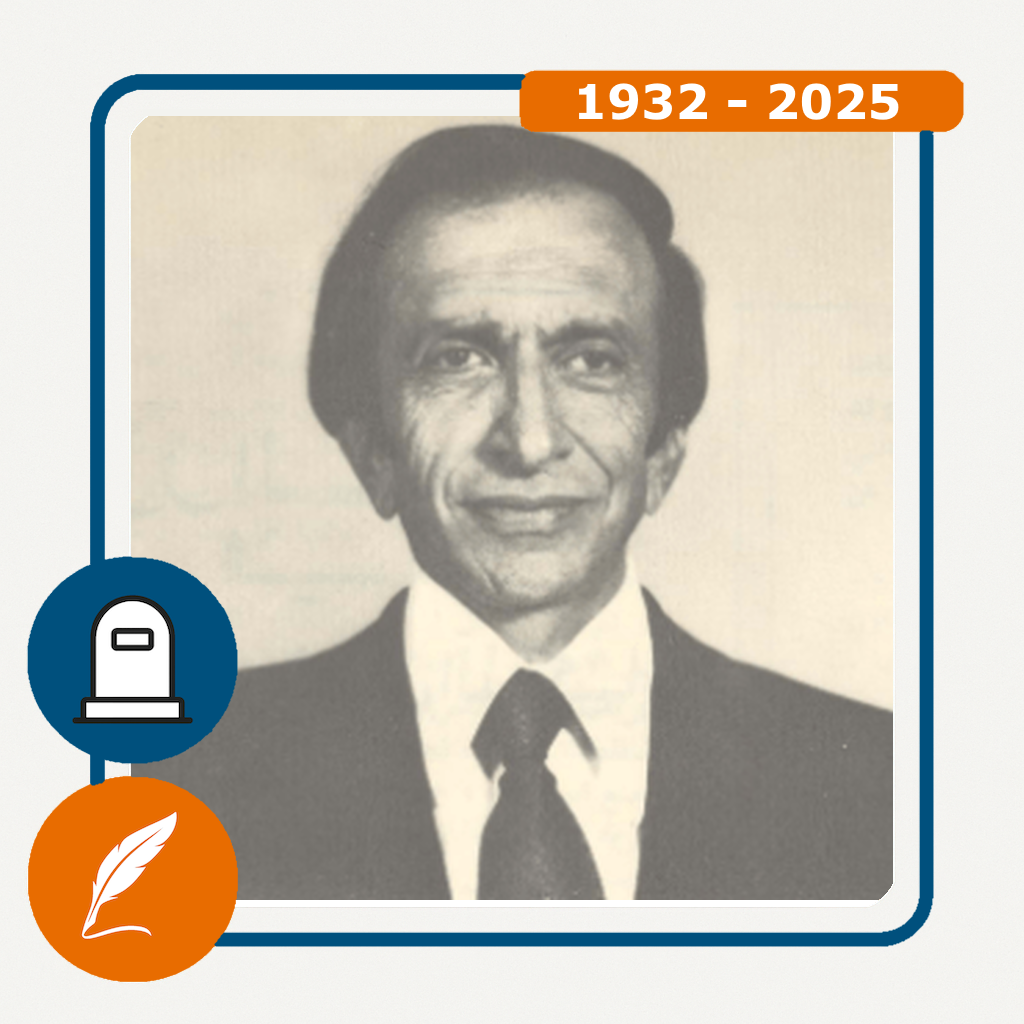
Né à Damas dans une famille sunnite de notables, Abdul Rauf al-Kasm voit le jour au cœur d’une ville où les pierres parlent et où l’art de bâtir constitue une seconde langue. Fils du mufti Muhammad Atallah al-Kasm, disparu en 1938, il grandit entre les bibliothèques familiales, les cours intérieures et l’ombre de l’autorité religieuse. L’enfance se déroule dans une Syrie encore marquée par le mandat puis entraînée vers l’indépendance et ses promesses. Les récits de droit, de foi et de jurisprudence qui entourent la maison donnent au garçon un sens précoce des hiérarchies, des rituels et des cadres. Le deuil du père imprime un sérieux que ses proches décrivent comme sans emphase, porté par une discipline silencieuse et une curiosité tournée vers l’étude.
Au début des années cinquante, l’Université de Damas lui offre un premier champ d’étude. Il choisit la philosophie, discipline de méthode et de doute, qui lui transmet la patience de la lecture et l’attention aux structures. Diplômé en 1953, il bifurque vers l’architecture, comme si la spéculation devait rencontrer la matière. Istanbul l’accueille pour l’apprentissage des savoirs techniques, du calcul et de la composition. Genève parachève la formation en 1963 par un doctorat à la faculté d’architecture, où se consolident une esthétique de sobriété et un goût des plans mesurés. Cette formation composite, entre spéculation et chantier, le prépare à une carrière où l’on négocie avec la forme autant qu’avec la règle.
De retour en Syrie, il ouvre un cabinet d’études et enseigne. À la Faculté des beaux-arts de Damas, il dirige le département d’architecture, puis anime au sein de l’ingénierie civile des promotions de jeunes praticiens soucieux d’articuler modernité et continuité. On lui attribue une part dans la réalisation de projets universitaires et culturels, dont la nouvelle faculté des beaux-arts, symbole d’une capitale qui veut cadrer ses métamorphoses. Sa semaine se partage entre jurys, visites de chantier et débats sur la protection du vieux Damas. Sa vie privée reste discrète, réglée par un emploi du temps d’enseignant exigeant, des lectures, quelques cercles professionnels. Dans ses cours, il prône une architecture de la mesure, attentive aux usages et aux rythmes collectifs.
L’engagement partisan vient tôt. Il rejoint le parti Baas, persuadé que l’État peut être l’architecte d’une société plus ordonnée. Les secousses de l’union égypto-syrienne, la rupture de 1961 puis la consolidation baasiste à partir de 1963 forment l’horizon de sa génération. À mesure que l’appareil prend forme, l’homme d’école devient homme de la ville. En 1979, on le nomme gouverneur de Damas. Les dossiers sont concrets, parfois prosaïques, mais décisifs dans une capitale qui croît vite : voirie, logements, marchés, circulation, police des constructions. Le gouverneur se tient dans le quotidien, entre arrêtés municipaux, arbitrages fonciers et promesses d’extension maîtrisée.
Le 9 janvier 1980, Hafez al-Assad le charge de former le gouvernement. Le pays entre dans une mécanique régionale et interne lourde. La confrontation avec les Frères musulmans gagne en intensité, la guerre Iran-Irak redistribue les ressources et les alliances, les soutiens financiers arabes se raréfient. À l’intérieur, les rigidités du secteur public rencontrent la chute de la devise. Al-Kasm préside trois cabinets successifs jusqu’en 1987. Il incarne un style administratif ascétique, plus proche du dossier que du discours, parlant chiffres et procédures, distribuant notes et circulaires plutôt que promesses.
L’austérité devient doctrine. Rationnements, contrôle des importations, écoulement des stocks des entreprises publiques, priorisation sectorielle, relèvements de prix parfois spectaculaires répondent à la raréfaction des devises. Les salaires suivent mal. Les Syriens patientent dans des files pour du pain, du sucre, des denrées simples. Les bazars bruissent de rumeurs, l’économie informelle se faufile, la contrebande alimente des étals parallèles. L’agenda du Premier ministre se peuple de comités, de commissions et de réunions interministérielles où l’on répartit le manque. Cette gestion de la pénurie, pensée comme un amortisseur, produit une mémoire sociale durable : hausses de prix, carnets de rationnement, colères rentrées.
Au même moment, la décennie connaît ses drames. En 1982, Hama devient l’épicentre d’une répression qui fixe pour longtemps la mémoire nationale. Premier ministre civil au milieu d’un appareil sécuritaire hypertrophié, al-Kasm ne détient pas les leviers de la force. Pourtant, son nom accompagne ces années de plomb, car la Syrie est alors gouvernée par un faisceau d’instances où le chef du gouvernement siège à côté des décideurs militaires et sécuritaires. L’histoire, qui ne sépare pas facilement les compétences, associe sa trajectoire à ce moment sombre. La ville qui l’a formé, Damas, poursuit malgré tout ses transformations : extensions, densifications, arbitrages entre patrimoine et besoins d’une capitale sous pression.
L’économie raconte, chiffres à l’appui, un autre pan de la période. L’arrêt de nombreuses importations, l’effort d’autosuffisance, le redéploiement de la dépense publique et les arbitrages entre industrie d’État et consommation courante composent un paysage de rareté organisée. Les hausses de prix frappent les matériaux de construction, les huiles, la viande. Les pouvoirs publics, soucieux d’éviter une débâcle monétaire, restreignent l’accès au dollar et resserrent la circulation des biens. Les ménages inventent des substituts, ressuscitent des savoir-faire d’économie domestique, s’initient à l’art d’acheter tôt ou d’attendre longtemps. Dans les campagnes, l’autoconsommation progresse et l’État multiplie les injonctions à produire et à livrer.
À l’intérieur de l’appareil, les relations personnelles pèsent lourd. En 1983, la maladie du président fait apparaître des scénarios de succession. Un directoire provisoire de figures sunnites civiles et militaires administre l’ordinaire pendant l’hospitalisation de Hafez al-Assad, et le Premier ministre en fait partie. Rifaat al-Assad tente alors de s’imposer. Les fidélités se recomposent, les nerfs se tendent. Les relations entre al-Kasm et le ministre de la défense, Mustafa Tlass, se crispent au fil des arbitrages. À l’automne 1987, le chef du gouvernement est remercié. La scène officielle lui attribue la dureté du moment ; ses adversaires voient en lui un visage commode de l’austérité ; ses partisans parlent d’un gestionnaire qui a tenu les digues.
Commence une seconde carrière, moins visible. Il est nommé à la tête du Bureau de la sécurité nationale, organe de coordination qui irrigue et surveille l’appareil. Le professeur d’hier devient l’un des gardiens du système, plus proche des notes que des micros. Jusqu’en 2000, il circule dans ces lieux où l’on lit, rassemble, transmet et cadre. Sa méthode demeure la même : sobriété, dossiers ficelés, préférence pour la synthèse. Après la mort de Hafez al-Assad et l’accession de son fils, il se retire des premiers rôles. Le silence devient sa manière de durer.
À côté de l’État, demeure l’architecte. La capitale conserve des traces de son passage entre administration, enseignement et chantiers. La faculté des beaux-arts, certains débats sur la protection du vieux Damas et des interventions urbaines modestes témoignent d’une sensibilité à la durée longue des formes. Ses étudiants se souviennent d’une exigence méthodique, d’une aversion pour les effets, d’un goût pour l’alignement précis et la coupe mesurée. Dans un monde arabe tenté par le spectaculaire, il prône l’économie de moyens et le respect des usages.
Sa vie privée reste d’une opacité voulue. Les sources parlent peu des alliances familiales, des amitiés ou des loisirs. Tout indique une existence disciplinée, réglée par les horaires administratifs et universitaires, par des réunions où l’on ne parle que de choses utiles, par des soirées de lecture. Cette réserve protège autant qu’elle éloigne. Elle correspond à une culture de fonctionnaire qui distingue nettement la scène publique et la sphère domestique, et qui préfère le retrait aux confidences.
Lorsque les soulèvements de 2011 éclatent, al-Kasm garde le silence. On ne l’entend pas commenter la répression, ni les exils, ni la militarisation du conflit. Le retrait nourrit un voile et préserve le vieil homme. De loin, il voit se défaire nombre de compromis qui avaient structuré son époque. Les villes continuent de changer ; Damas étend ses quartiers, perd des habitants, en accueille d’autres, subit les à-coups d’une économie épuisée. On retrouve là, tragiquement, la centralité des questions matérielles qui avaient marqué son passage.
Sa mort survient à Munich le 19 octobre 2025 à l'âge de 93 ans, dans une Europe qui fut jadis l’atelier de sa formation. La nouvelle réveille une mémoire ambivalente. Les uns retiennent les files devant les boulangeries, les coupons, le sentiment d’étouffement. D’autres évoquent un Premier ministre sans faste, absorbé par l’ingrat quotidien de l’État. Les jugements personnels importent moins que les mécanismes. Pour comprendre l’homme, il faut restituer le système et ses contraintes : un gouvernement civil au service d’un régime où la décision se concentre ailleurs, une économie administrée heurtée par la guerre régionale et la raréfaction du crédit extérieur.
Reste la question de la responsabilité. Le chef du gouvernement n’était pas le maître de la sécurité, ni l’architecte de la diplomatie. Il fut le comptable de décisions prises plus haut, parfois le relais, parfois le filtre. L’histoire, cependant, n’efface pas les noms. Elle associe les trajectoires aux épisodes, et la décennie qu’il a dirigée demeure l’une des plus dures pour la société syrienne. Le poids d’Hama et des années de plomb colle à sa mémoire. L’austérité, devenue nécessité d’État, a eu ses coûts sociaux et son héritage de prudence et de méfiance.
À l’heure de la nécrologie, la figure qui se dégage est celle d’un bâtisseur devenu gestionnaire de disette. Sa vie résume une époque où l’État prétend régir l’orientation des récoltes, la trajectoire des prix et la forme des villes, et où chaque décision se payait en files, en rumeurs et en silence. Il y a, dans ce destin, moins de romanesque que d’index statistiques, moins d’éloquence que d’ordonnances budgétaires. Le Damascène de 1932 aura traversé les promesses du nationalisme arabe, l’institutionnalisation d’un État-parti, la guerre régionale et la réforme par la contrainte. Il aura connu la salle de cours, la préfecture, la présidence du Conseil et l’arrière-scène des comités, avant de se retirer dans l’ombre qu’il avait toujours cultivée.
Ainsi s’achève la trajectoire d’Abdul Rauf al-Kasm, élève des écoles damascènes, professeur d’architecture, gouverneur de sa ville, chef d’un gouvernement en temps d’orage puis vigie discrète au cœur des instances. La Syrie, façonnée par des décennies de centralisation, se souviendra de lui comme d’un gestionnaire de l’ordinaire en temps extraordinaires. On pourra contester ses choix, peser ses silences, discuter ses marges de manœuvre. Mais on reconnaîtra que sa biographie se lit d’abord comme une histoire de contraintes : devises rares, alliances fluctuantes, monopoles publics fatigués, société jeune et urbaine à nourrir. Le nom d’al-Kasm renverra durablement aux années d’austérité, à l’idée d’un État qui tient la boutique quand l’orage bat les façades, et aux questions que tout pays affronte lorsque la politique et l’économie convergent vers la pénurie. Dans ses fonctions de gouverneur comme à la présidence du Conseil, sa boussole demeura urbaine. Il répétait que la capitale devait respirer, que l’extension sans service public fabriquait des crises lentes, et que la planification n’était pas une manie mais une éthique. Cette manière de raisonner l’amena à regarder les marchés comme des espaces à organiser plus qu’à libérer. Il n’était pas un théoricien des réformes mais un homme de cadres, de calendriers et de listes d’approvisionnement, pour qui l’ordre matériel précédait la politique et conditionnait la crédibilité de l’État. Au quotidien aussi.