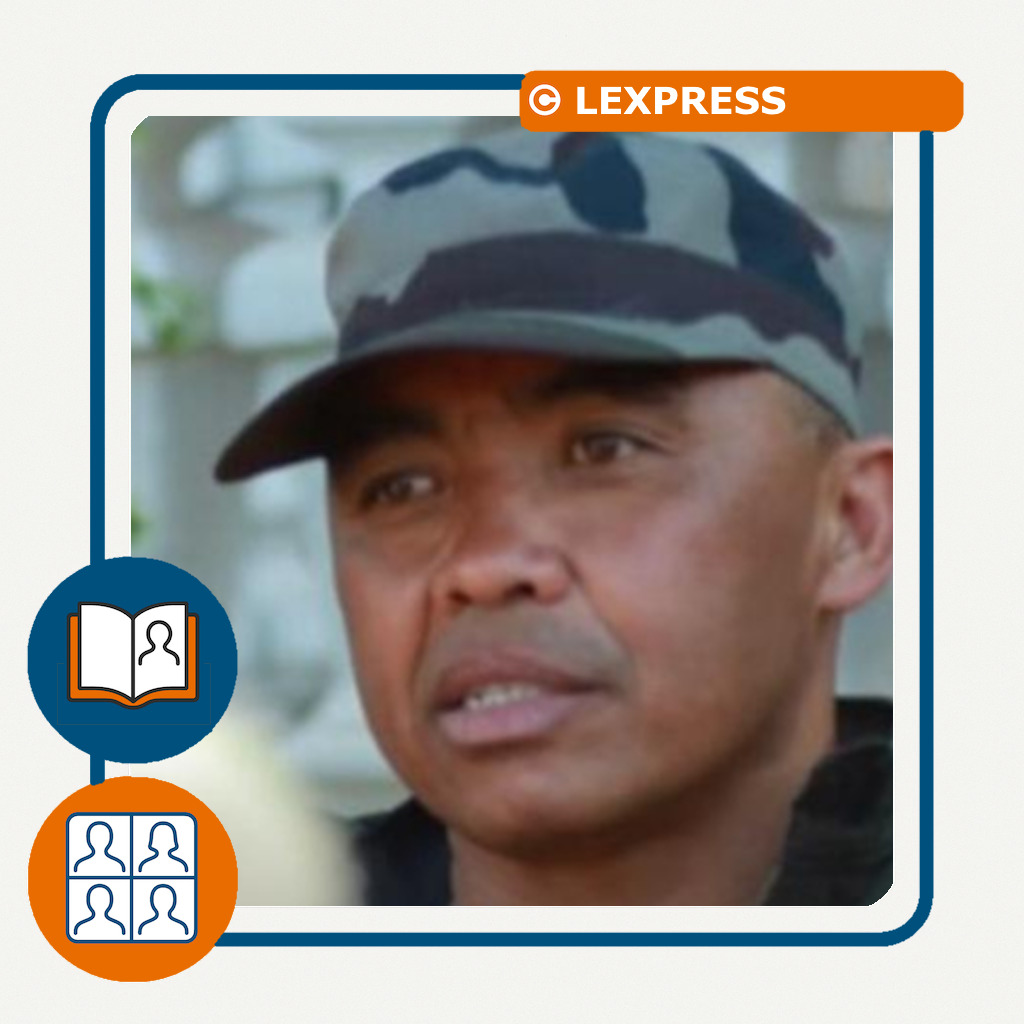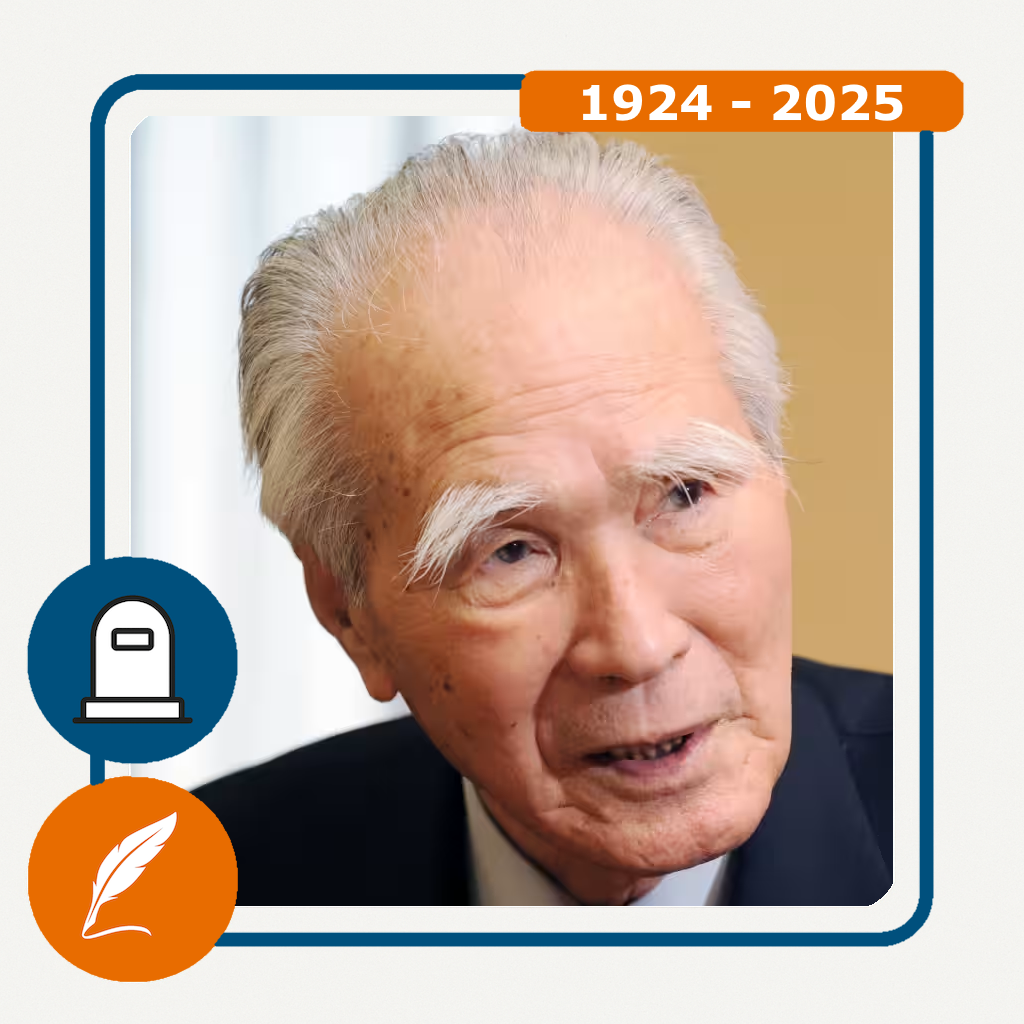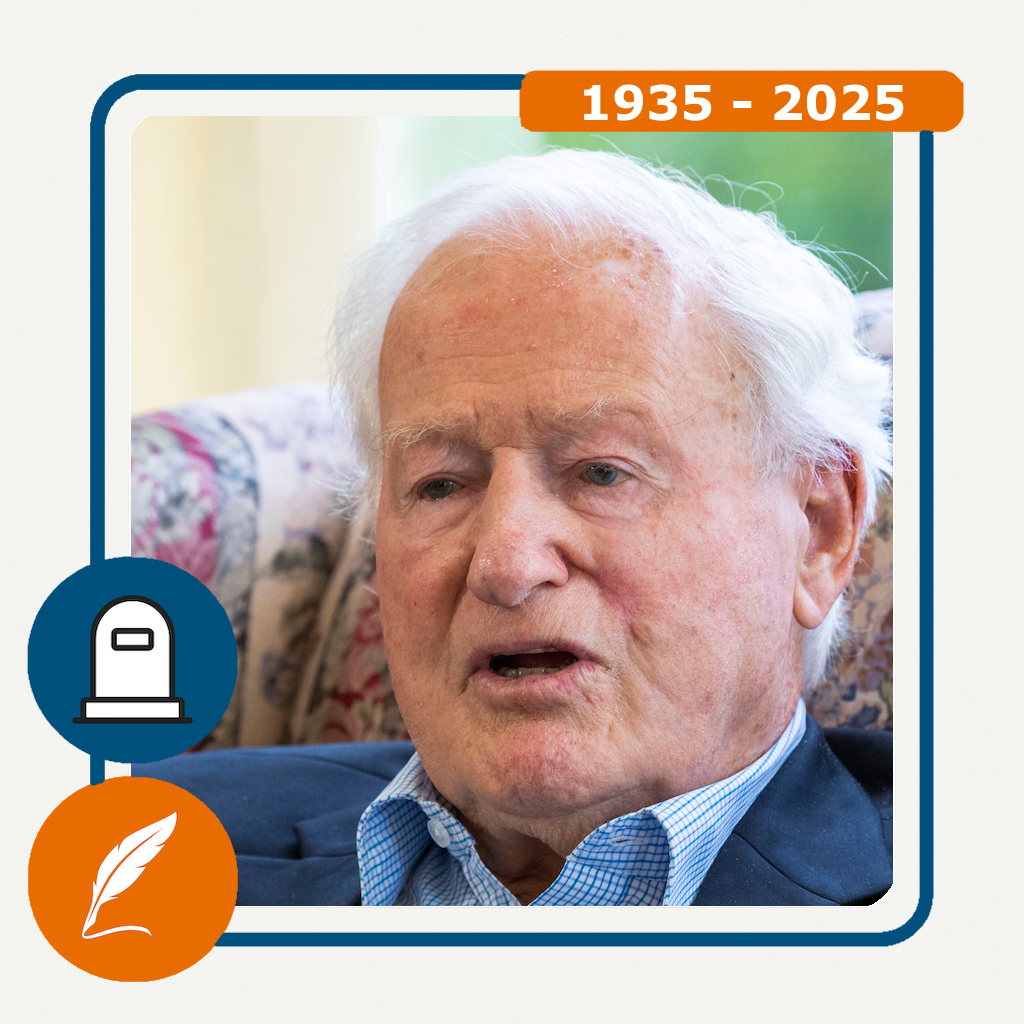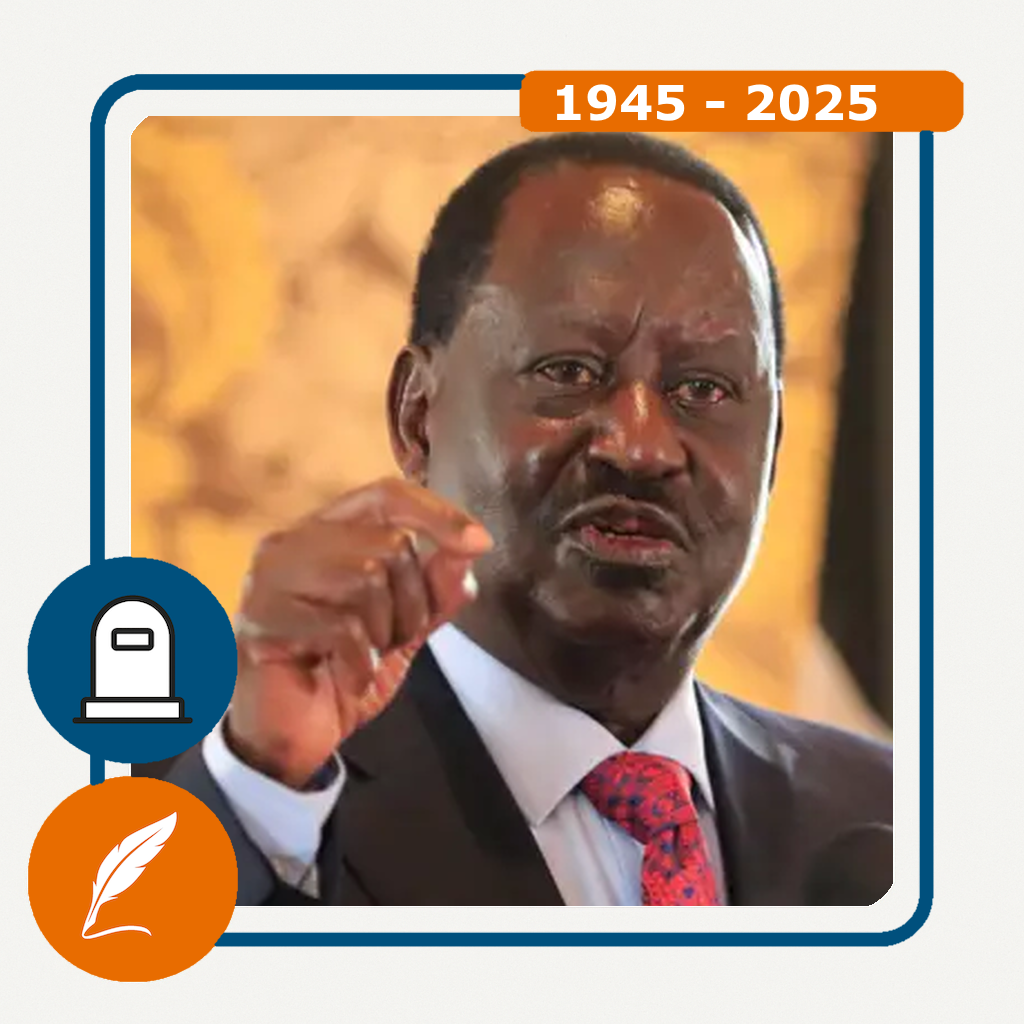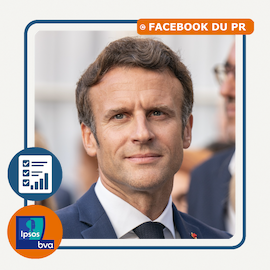COTE D'IVOIRE - PRESIDENTIELLE DU 25 OCTOBRE
COTE D'IVOIRE - PRESIDENTIELLE DU 25 OCTOBRE
Ballotage serré, paix en jeu

Règles fixées, nerfs à vif
À deux semaines du vote du 25 octobre 2025, la Côte d’Ivoire aborde l’échéance présidentielle avec un mélange de confiance institutionnelle et de nervosité politique. Le Conseil constitutionnel a arrêté une liste de cinq candidats autorisés à concourir : le président sortant Alassane Ouattara, l’ancienne Première dame Simone Ehivet Gbagbo, l’homme d’affaires et ex-ministre Jean-Louis Billon, l’ancienne ministre Henriette Lagou et l’ingénieur Ahoua Don Mello. La même décision a écarté plusieurs figures majeures de l’opposition pour des motifs d’inéligibilité ou de parrainages insuffisants, relançant le débat sur l’égalité d’accès à la compétition. Dans un pays où les épisodes de 2010 et 2020 restent vivaces, la clarification des règles et la lisibilité du calendrier sont devenues des enjeux autant politiques que psychologiques.
Ce cadre juridique posé, la rue demeure un baromètre impitoyable. À Abidjan, des rassemblements de l’opposition ont été interdits par les autorités préfectorales au nom de l’ordre public, ce qui a nourri de vifs échanges sur l’équilibre entre sécurité et libertés publiques. Des organisations de défense des droits rappellent qu’une manifestation encadrée vaut mieux qu’une colère souterraine, et demandent des itinéraires négociés, des services d’ordre mixtes et des médiateurs visibles. Le gouvernement assure qu’il n’interdit pas la politique mais protège les personnes et les biens. Sur les réseaux sociaux, militants et contre-militants rivalisent de narratifs que les rédactions locales tentent de vérifier avant publication.
Dans les états-majors, on guette un paramètre clef : la participation. Le pays a déjà connu des scrutins où l’abstention a pesé sur la légitimité du vainqueur. Chaque camp active ses relais communautaires pour convaincre les électeurs de retirer leurs cartes et de voter près de chez eux. Chefs traditionnels, leaders religieux et associations de quartier multiplient les messages de responsabilisation, parfois dans des langues nationales, afin de désamorcer les rumeurs et d’encourager la civilité. Des universités et organisations de jeunesse organisent des forums pour expliquer le bulletin unique et la conduite à tenir en cas d’incident.
La Commission électorale indépendante martèle qu’elle a renforcé la formation des agents, l’acheminement du matériel sensible et les procédures de compilation. Elle annonce des contrôles croisés entre procès-verbaux et données agrégées, et l’ouverture des centres de consolidation aux représentants des candidats, accrédités à l’avance. Elle promet aussi des points d’information publics pour éviter le vide communicationnel. Les partis surveillent ces promesses et disent disposer d’équipes juridiques prêtes à introduire des réclamations dans les délais. Des coalitions citoyennes déploient des observateurs nationaux et des médiateurs, avec des lignes téléphoniques dédiées au signalement des tensions locales.
Au-delà des procédures, l’atmosphère est chargée d’un souvenir persistant : celui des crises post-électorales qui ont profondément meurtri le pays. C’est ce spectre qui donne à la présidentielle 2025 une dimension quasi existentielle. D’un côté, le pouvoir met en avant la stabilité, l’investissement public et des chantiers structurants ; de l’autre, l’opposition réclame alternance, réforme de la gouvernance et rééquilibrage territorial. Entre ces pôles, une majorité silencieuse, attentive aux prix, à l’emploi et à la sécurité quotidienne, pèse sur l’issue plus que les slogans. Les campagnes tentent d’adresser cette demande par des programmes lisibles et des engagements de calendrier.
Dans ce contexte, chaque geste compte. Une déclaration trop martiale, une dispersion mal calibrée ou un incident isolé peuvent devenir des symboles nationaux à l’ère de la viralité. Les autorités affirment qu’aucune provocation ne justifie un usage disproportionné de la force ; les organisateurs de meetings promettent de bannir les mots d’ordre ambigus. Des radios locales testent des débats chronométrés, tandis que des télévisions privées misent sur des vérifications en direct. Le climat se jouera à la marge, avec des micro-signaux que capteront surtout les électeurs indécis.
Reste une évidence : le verdict des urnes ne suffira pas à lui seul à éteindre les controverses. Le soir du 25 octobre, la transparence de la proclamation, la lisibilité des chiffres et l’accès aux procès-verbaux seront aussi importants que la performance des candidats. Les Ivoiriens ont appris à lire les tableaux de résultats ; ils attendent que les institutions les traitent en citoyens majeurs. L’élection est un moment ; la confiance, un processus. C’est sur ce fil tendu que s’avance la démocratie ivoirienne, décidée à conjuguer pluralisme et stabilité. Le pays en a pleine conscience aujourd’hui.
Cinq voix, cinq récits
Dans les meetings, les plateaux télé et les marchés, les cinq candidats rivalisent d’images et de mots d’ordre. Alassane Ouattara structure son discours autour de la continuité et de la stabilité. Il rappelle les routes bitumées, les ponts, les universités créées et les programmes de santé publique, en promettant d’achever les chantiers et d’accélérer l’industrialisation. Son équipe met en avant investissements, électricité et services numériques. Pour toucher la jeunesse, elle insiste sur emplois, stages et financement de projets, avec un argument central : la paix conditionne la croissance.
Jean-Louis Billon se présente comme l’entrepreneur qui veut « changer la méthode ». Son message tient en trois ressorts : apaisement politique, souveraineté économique et partage plus équitable de la croissance. Il promet une gouvernance moins verticale, une lutte systémique contre la corruption et un environnement d’affaires plus lisible pour les investisseurs comme pour les petites entreprises. Dans ses prises de parole, il détaille des mesures de pouvoir d’achat, des incitations industrielles, une modernisation du secteur agricole et une diplomatie économique plus régionale. Son style, plus managérial que lyrique, cherche à séduire la classe moyenne urbaine et les jeunes entrepreneurs.
Simone Ehivet Gbagbo mise sur l’énergie militante de ses bases et sur un récit de relèvement. Elle mobilise la mémoire d’un camp longtemps tenu à l’écart du pouvoir et plaide pour la réconciliation. Son programme met l’accent sur les libertés publiques, la justice sociale et le partage du pouvoir avec les collectivités locales. Au-delà des symboles, ses équipes martèlent des priorités sociales : subventions ciblées pour les ménages les plus vulnérables, amélioration de l’école primaire, relance de l’emploi féminin et soutien aux activités de revenus dans les zones rurales. Elle appelle les électeurs à se réapproprier l’espace civique, à voter massivement et à défendre chaque bulletin dans la légalité.
Henriette Lagou se pose en pédagogue de la décentralisation. Elle défend un transfert effectif de compétences et de budgets vers les régions, la professionnalisation de l’administration locale et la participation des citoyens aux décisions locales. Sa proposition centrale est d’utiliser la décentralisation comme levier d’équité : rapprocher l’école et la santé des villages, accélérer l’entretien des pistes rurales, adapter les réponses sécuritaires aux réalités locales. Elle lie cette réforme à une revalorisation du statut des élus locaux et à des contrôles renforcés contre les clientélismes. Son ton, méthodique, vise les électeurs qui veulent voir des changements concrets dans leur commune avant les grands discours nationaux.
Ahoua Don Mello articule sa candidature autour de la souveraineté technique et de la valorisation du génie local. Ingénieur de formation, il promet une politique d’infrastructures plus inclusive, attentive aux besoins des régions enclavées, et une montée en compétences des entreprises ivoiriennes. Il défend un État stratège, planifiant sur vingt ans l’eau, l’énergie, le transport et l’habitat. Dans son récit, la jeunesse devient la première force de conception des projets publics, et l’expertise nationale mieux rémunérée remplace les dépendances coûteuses.
Derrière ces lignes de force, tous cherchent à polariser sans fracturer. Foules, bénédictions de chefs traditionnels et alliances locales donnent de la profondeur sociale à chaque campagne. Le calendrier serré pousse à des choix tactiques : investir les circonscriptions peuplées, ancrer un récit cohérent et éviter les dérapages. Les équipes digitales occupent le terrain, avec vidéos brèves, synthèses quotidiennes et réponses rapides aux rumeurs. Mais la bataille se jouera aussi sur la logistique : recrutement des représentants dans les bureaux, formation, remontée des résultats et vigilance sur les contentieux.
Le contraste des styles est net. Ouattara capitalise sur la sécurité et sur la promesse d’achèvement des chantiers. Billon met en avant l’efficacité et le partage. Gbagbo parle de dignité retrouvée et de libertés garanties. Lagou défend la proximité, la pédagogie et l’équité territoriale. Don Mello propose de reconquérir la planification et les savoir-faire. Les électeurs trancheront entre continuité ou alternance, centralisation ajustée ou décentralisation poussée, régulation pro-marché ou pilotage plus étatique. Dans les meetings comme dans les marchés, derrière les slogans, une même impatience traverse la société : trouver un chemin d’apaisement durable qui tienne dans la durée. Au fil des jours, l’écart se mesurera moins au volume sonore qu’à la crédibilité des feuilles de route, à la discipline des appareils et à la capacité d’embrayer, dès novembre, sur des décisions immédiatement perceptibles.
Emploi, État, territoires
Au cœur de la campagne, trois blocs d’enjeux dominent : emploi et coût de la vie, gouvernance et justice, équilibre territorial et services de base. Sur le premier volet, tous promettent d’accélérer la création d’emplois formels, de soutenir les très petites entreprises et de sécuriser les parcours des jeunes. La discussion porte sur le passage d’une croissance tirée par les chantiers à une croissance d’opportunités capable d’absorber des dizaines de milliers de nouveaux actifs. Les propositions varient : défiscalisation ciblée de l’embauche, programmes d’apprentissage, fonds de garantie pour les crédits productifs, incitations à l’industrialisation légère et meilleure intégration des filières agricoles. Les ménages espèrent des réponses tangibles sur le coût des denrées, le logement et le transport, notamment dans le grand Abidjan.
Le deuxième bloc touche à la gouvernance. Les candidatures d’alternance promettent une lutte anticorruption, la transparence des marchés publics et l’évaluation des politiques. Elles plaident pour une administration plus ouverte, avec des données publiques accessibles, des inspections qui publient leurs rapports et des sanctions effectives. Le camp présidentiel rétorque qu’un socle de réformes existe déjà et qu’il faut le consolider pour préserver l’attractivité. Tous s’accordent toutefois sur l’urgence de simplifier la relation entre l’État et les citoyens : actes d’état civil, titres fonciers, procédures fiscales, immatriculations, tout ce qui ralentit la vie économique doit être traité vite.
La question judiciaire s’invite aussi dans le débat. Des avocats et des organisations demandent plus d’indépendance des magistrats, des délais réduits et l’exécution des décisions. Les entreprises veulent des tribunaux commerciaux plus rapides et des mécanismes d’arbitrage et de médiation. Les défenseurs des droits exigent un encadrement clair du maintien de l’ordre, une meilleure formation des forces et la protection des libertés. Ce chapitre touche à la confiance collective : plus la justice est lisible, plus l’investissement se déploie et plus le contrat social se stabilise.
Troisième bloc : la carte des territoires. Dans de nombreuses régions, les citoyens demandent des routes entretenues, des dispensaires, des enseignants et de l’eau potable. Le débat sur la décentralisation prend ici une tournure très concrète. Les partisans du transfert de compétences veulent des budgets locaux, des contrôles citoyens et des préfets accompagnateurs. Les plus prudents redoutent des baronnies et une dépense sans résultat sans garde-fous stricts. La ligne de crête consiste à rapprocher la décision du terrain tout en harmonisant les standards, pour que l’ouest, le nord et le sud aient des services comparables.
Ces enjeux s’entrecroisent avec les secteurs productifs. Dans l’agriculture, rémunération des planteurs, diversification, transformation locale et routes de collecte restent déterminantes. Dans l’énergie, l’arbitrage entre production, coût pour l’usager et investissement privé aiguise les divergences. Dans l’éducation, qualité des écoles, formation des maîtres et orientation vers les métiers techniques font consensus, mais l’exécution budgétaire reste la grande inconnue. Dans la santé, la couverture maladie, l’équipement des hôpitaux régionaux et la maintenance reviennent.
Le financement de la politique publique ne peut être évacué par slogans. Les candidats évoquent une meilleure mobilisation des recettes, la lutte contre la fraude, des dépenses mieux ciblées et un usage plus sélectif de l’endettement. Certains proposent d’examiner les exonérations, d’autres prônent la stabilité. L’opinion, elle, demande surtout des résultats visibles : classes avec maîtres présents, centres de santé fonctionnels, routes praticables et éclairage public durable. Elle jugera les gouvernants au service rendu plutôt qu’aux annonces.
La sécurité intérieure et la cohésion sociale complètent le tableau. Si le territoire national est globalement calme, des tensions existent dans des zones à forte compétition foncière ou politique. Prévention, médiation communautaire et prudence dans les discours identitaires deviennent des marqueurs d’aptitude à gouverner. Les chefs religieux et coutumiers rappellent la primauté de la paix et s’engagent dans des dialogues entre jeunes de partis opposés. À l’échelle régionale, la stabilité du pays demeure un actif stratégique ; elle suppose des forces professionnelles et une coopération soutenue avec les voisins.
En filigrane, un consensus se dessine : il faudra, quel que soit le vainqueur, gouverner par priorités claires, avec des calendriers crédibles et des comptes rendus réguliers. Les électeurs ne réclament pas un catalogue, mais des séquences d’exécution : telle réforme au premier semestre, tels ouvrages livrés avant la saison des pluies, tel programme social vérifiable. Cette exigence de lisibilité, désormais portée par les médias, les élus locaux et les organisations professionnelles, pourrait bien être la véritable nouveauté politique de 2025.
Après-vote : cap et garde-fous
À mesure que l’échéance se rapproche, trois scénarios dominent les conversations. Le premier, porté par le camp présidentiel, est celui d’une victoire dès le premier tour. Il suppose une mobilisation forte du socle du RHDP, la fragmentation de l’opposition et une abstention contenue. Dans cette hypothèse, l’exécutif devrait s’employer à ouvrir un dialogue politique, à associer des sensibilités extérieures à la formation gouvernementale et à annoncer très vite un calendrier d’actions mesurables. Le risque serait de confondre vitesse et précipitation : une communication trop triomphale pourrait raviver les blessures, tandis qu’un temps mort prolongé créerait un vide anxiogène. La clé serait d’ancrer la victoire dans la légalité, la pédagogie et des gestes symboliques d’apaisement.
Le second scénario postule un second tour. Il ouvrirait un espace de négociations, d’alliances locales et de coalitions d’idées. Les deux finalistes se disputeraient le centre sociologique du pays : les urbains préoccupés par leur pouvoir d’achat et la sécurité, les jeunes en quête d’opportunités, les milieux professionnels sensibles à la gouvernance. Dans cette phase, la logistique électorale deviendrait décisive : couverture des bureaux, qualité des remontées, avocats mobilisés pour les contentieux, discipline dans les déclarations publiques. Les partenaires régionaux et les observateurs civiques plaideraient pour des messages de retenue et un arbitrage strictement institutionnel. Ce scénario est jugé plus incertain, mais il aurait l’avantage de tester la capacité des élites à composer sans rompre.
Le troisième scénario est celui de la contestation. Il prendrait corps si l’écart annoncé était faible, si des incohérences apparaissaient dans les compilations ou si des incidents graves survenaient le jour du vote. Dans ce cas, la paix publique dépendrait de trois choses : la transparence des organes électoraux, la responsabilisation des leaders politiques et l’attitude des forces de sécurité. Les premiers devraient publier vite des chiffres vérifiables, les seconds éviter des mots qui enflamment et privilégier les voies légales, les troisièmes garder le sang-froid et la proportionnalité. Des plateformes de médiation, testées pendant la campagne, pourraient servir de soupapes pour canaliser les crispations locales. Un appel conjoint des autorités religieuses et coutumières pourrait apaiser les quartiers les plus sensibles.
Au-delà de ces bifurcations, l’après-scrutin ne sera pas moins exigeant que la campagne. La légitimité se construira par la preuve, à partir de quelques décisions simples et immédiatement perceptibles : des classes ouvertes et équipées, des centres de santé dotés en personnel et médicaments, des routes secondaires entretenues avant la saison des pluies, des démarches administratives raccourcies et prévisibles. Le prochain pouvoir devra aussi maîtriser l’arithmétique budgétaire : prioriser, phaser, renoncer si nécessaire, expliquer les choix, publier les résultats. La communication officielle gagnera à privilégier les rapports d’étape illustrés de données plutôt que les slogans. Les ministres les plus exposés devront accepter le débat contradictoire et rendre des comptes réguliers aux élus locaux.
Le rôle des médias sera déterminant. Les rédactions devront continuer à vérifier les chiffres, confronter les programmes et signaler les manipulations. Les chaînes et radios offrant des espaces contradictoires de qualité contribueront à apaiser la vie publique. Les médias numériques, très présents dans les quartiers populaires, pourront faire progresser la culture du doute méthodique en expliquant simplement les procédures, du bureau de vote à la proclamation. La pédagogie citoyenne reste la meilleure assurance contre les emballements.
Reste l’insertion régionale. Dans un environnement ouest-africain travaillé par des chocs politiques, la stabilité ivoirienne demeure un bien précieux. Elle suppose une diplomatie active, une coopération sécuritaire et une économie capable d’absorber des aléas extérieurs sans brutaliser les ménages. Le prochain président devra préserver les équilibres avec les voisins, ménager la confiance des investisseurs et parler le langage de la responsabilité avec l’opinion. Les Ivoiriens n’attendent pas des miracles ; ils exigent de la cohérence, des preuves et une direction lisible.
Au fond, la présidentielle de 2025 met à l’épreuve un pacte implicite : la promesse que la compétition politique peut se dérouler sans casser la maison commune. Si les institutions tiennent le cap et si les candidats acceptent que la défaite n’est pas une indignité, le pays tournera une page. Sinon, il lui faudra encore réparer, expliquer, recoller. Comme en démocratie, la technique compte, mais l’esprit du jeu compte davantage. Le 25 octobre dira moins qui gagne que ce que la nation souhaite devenir ensemble.