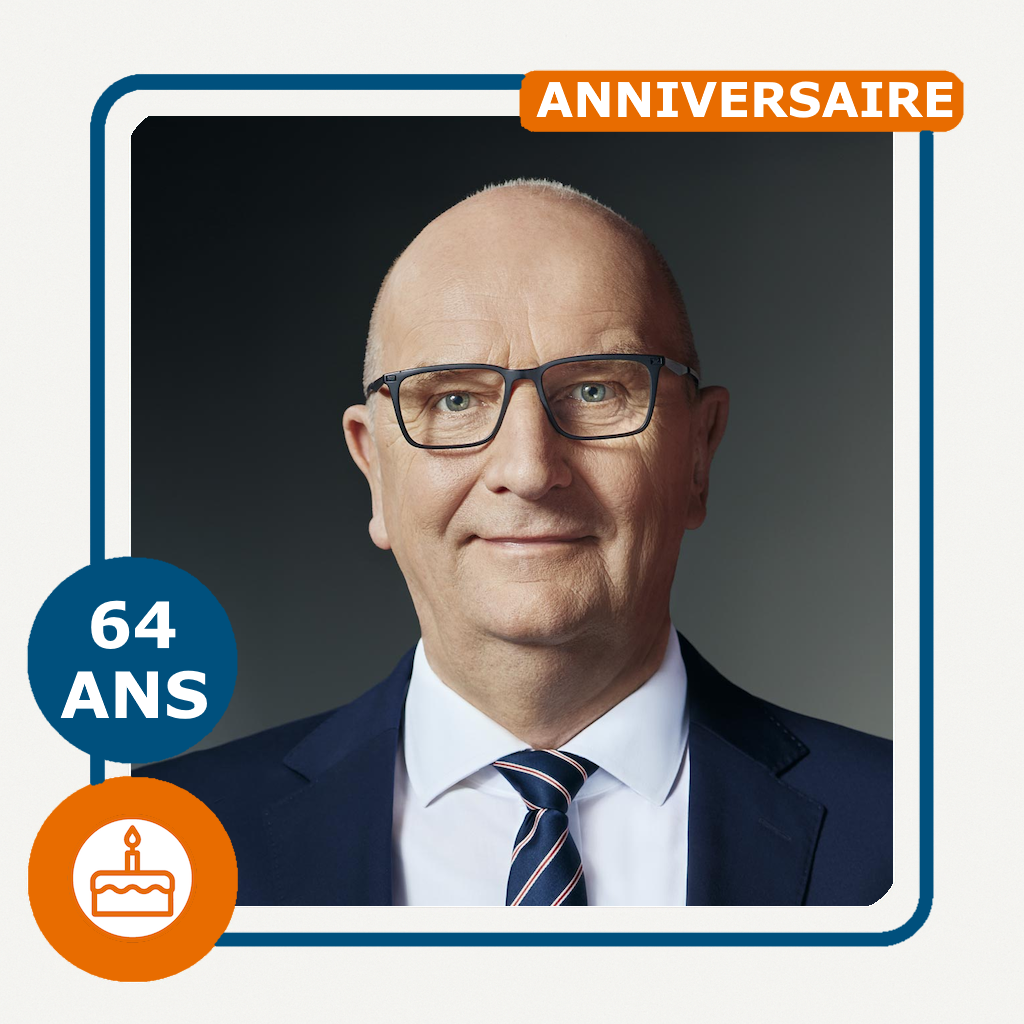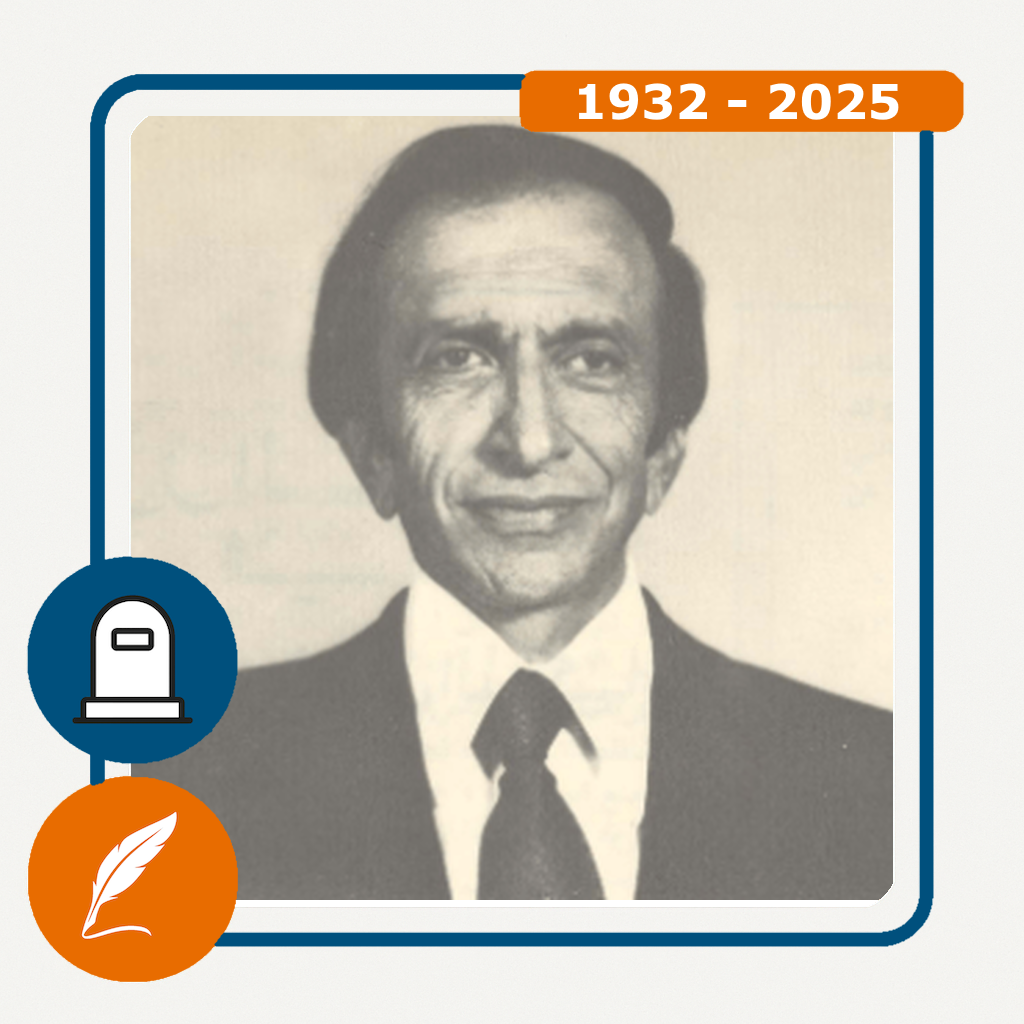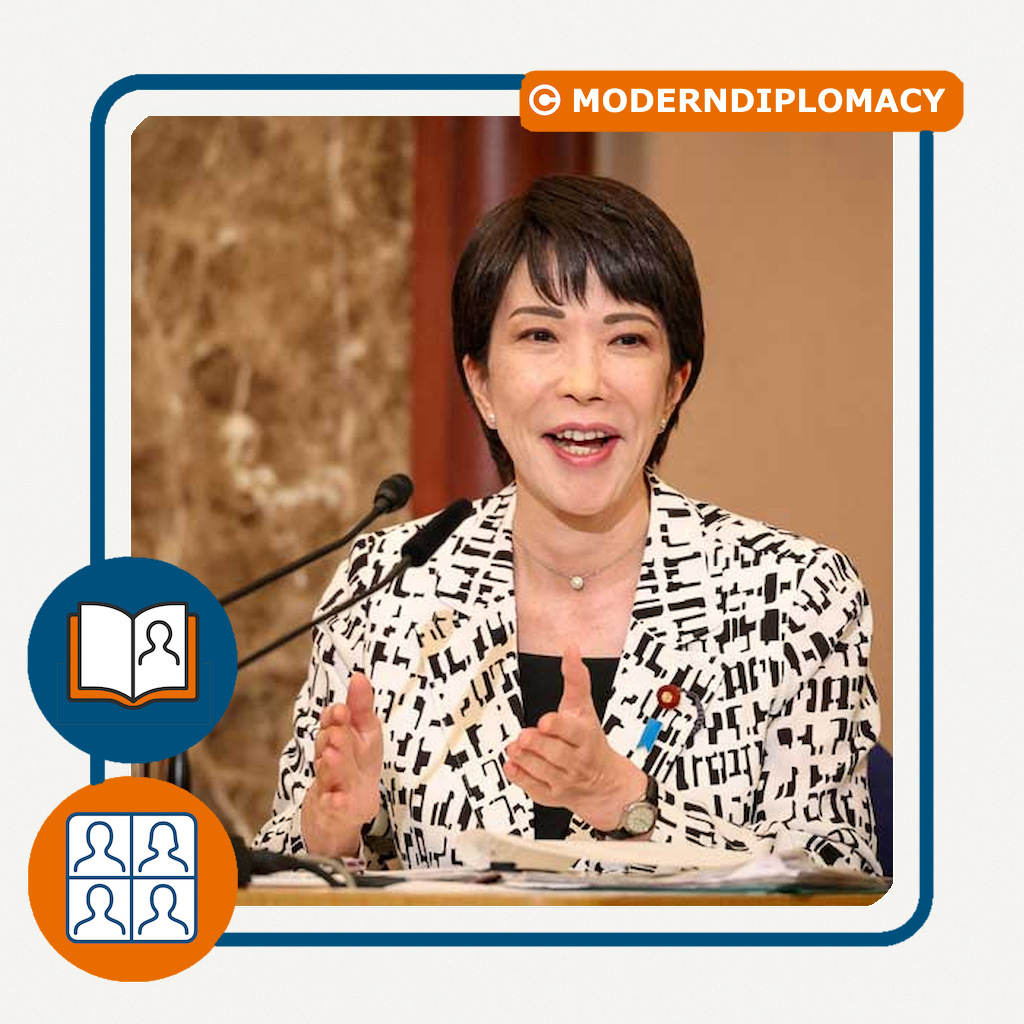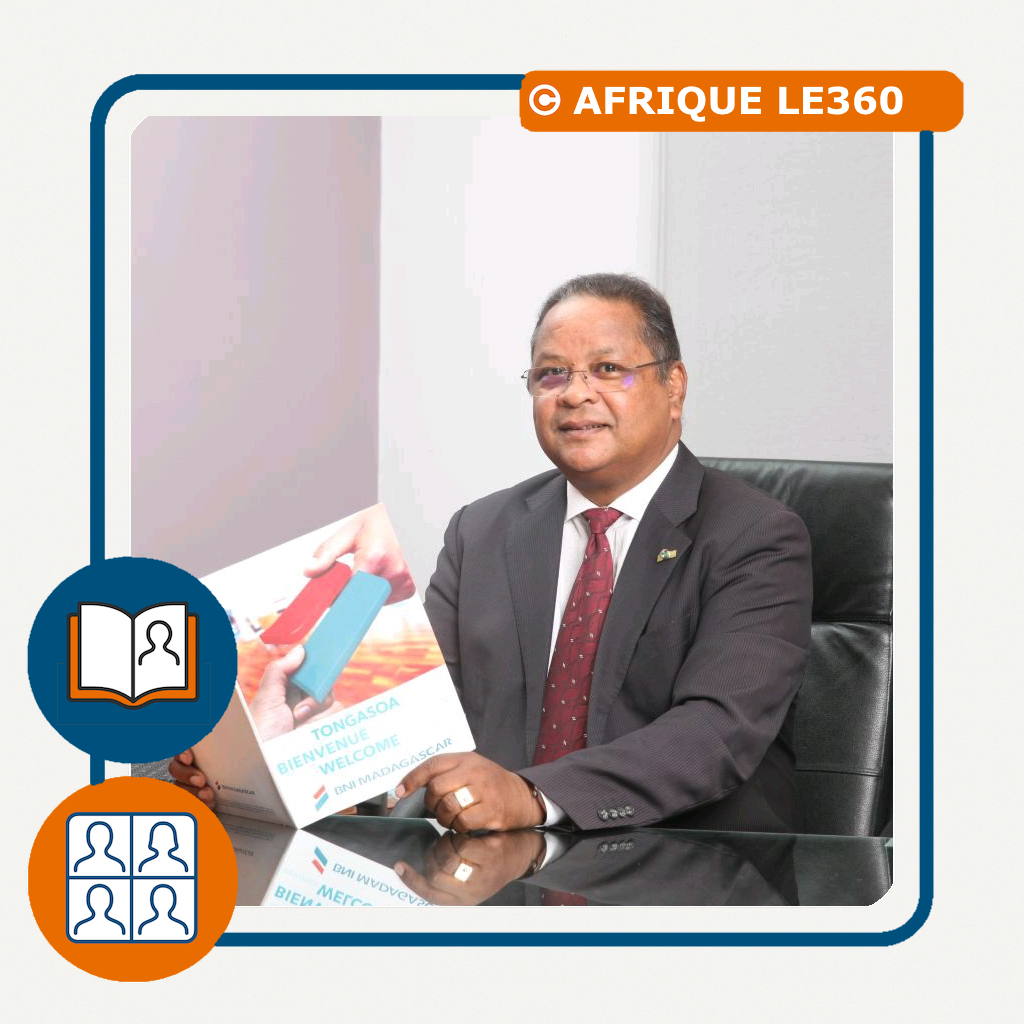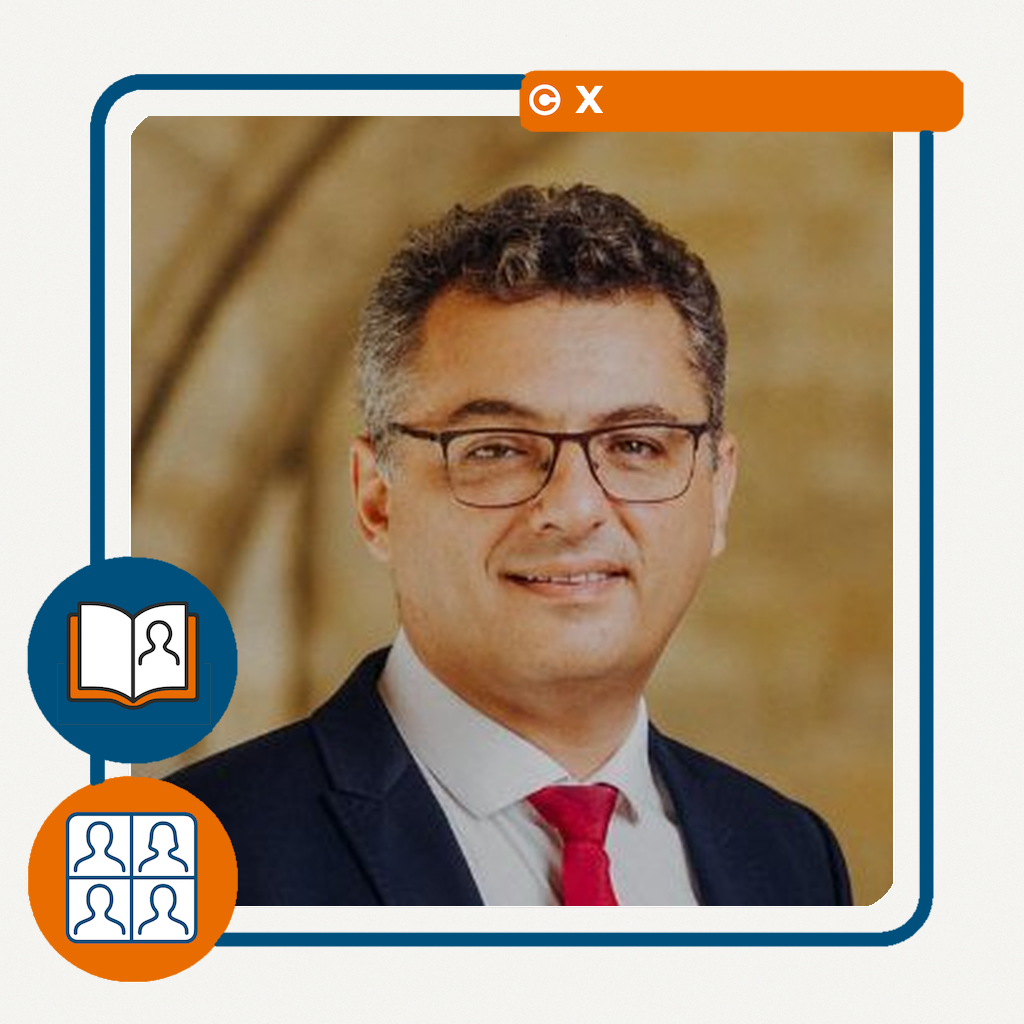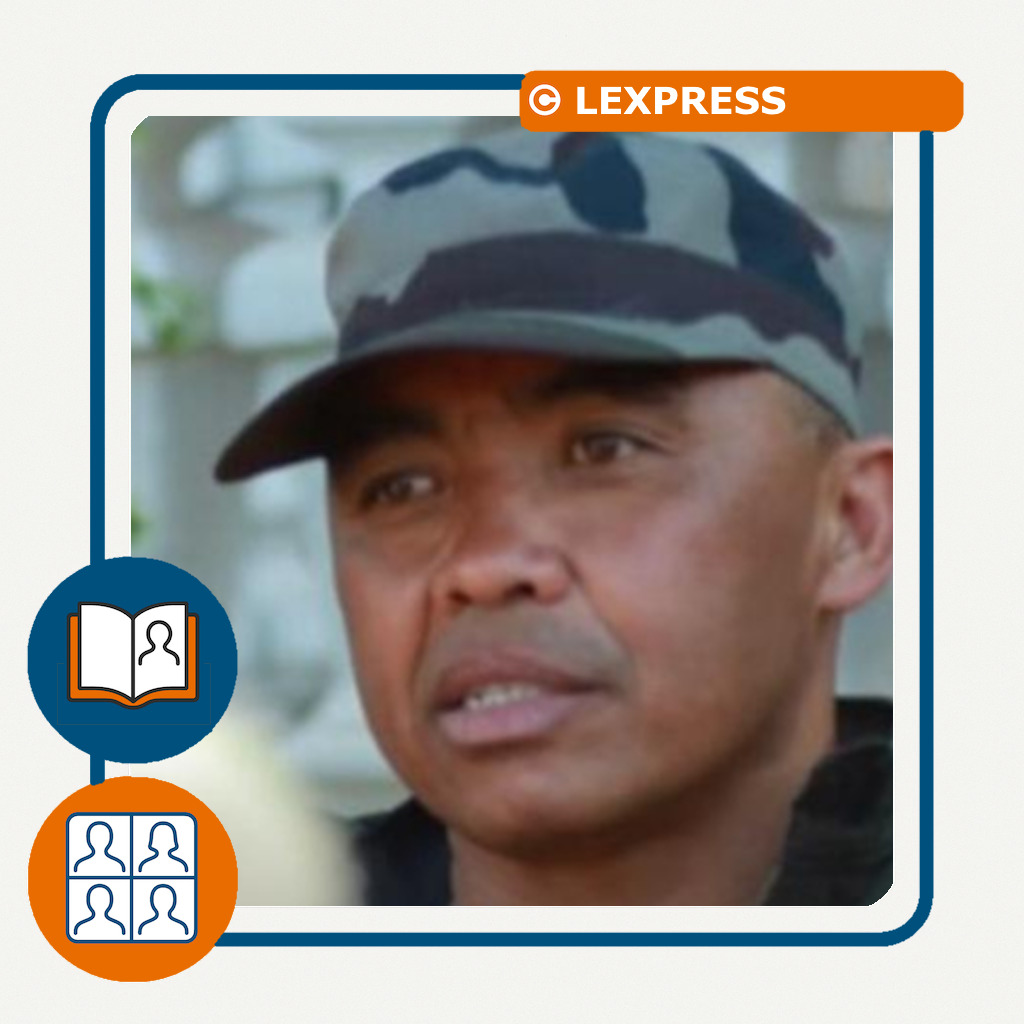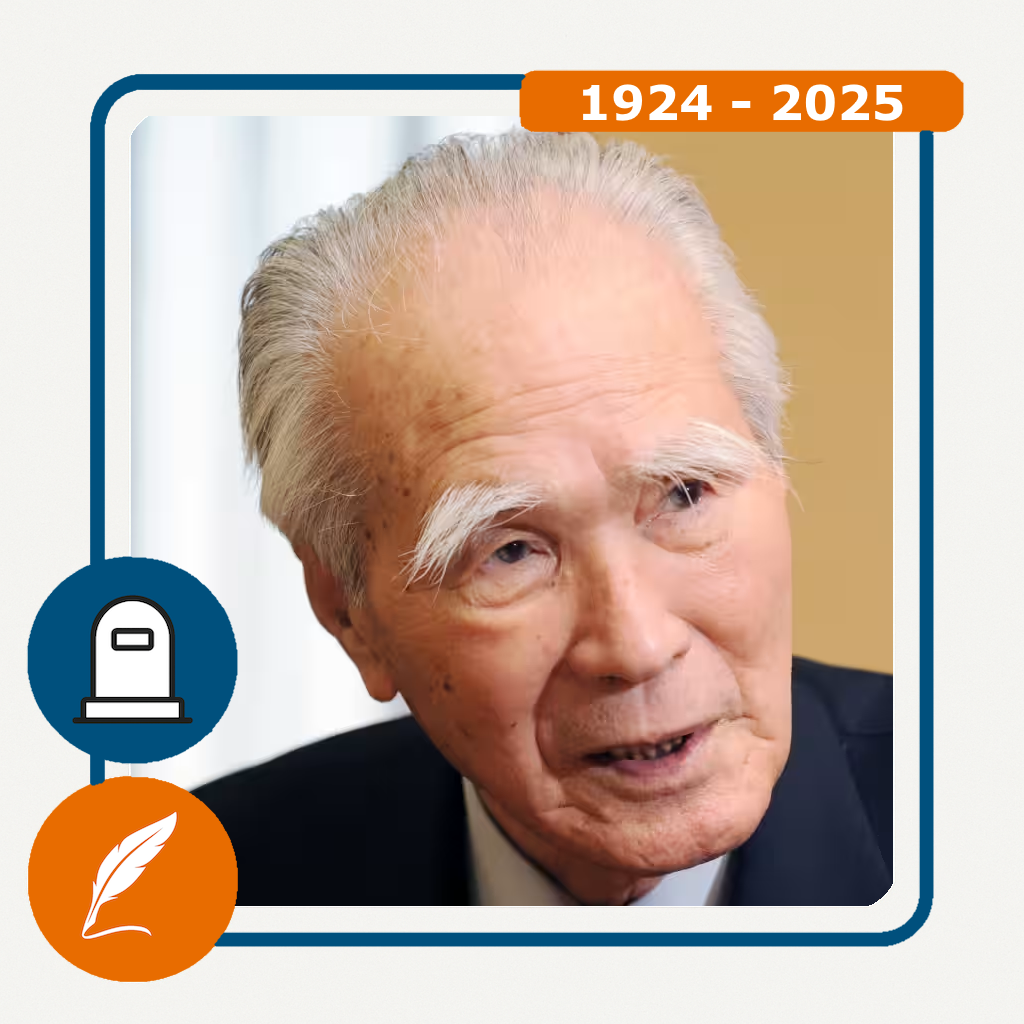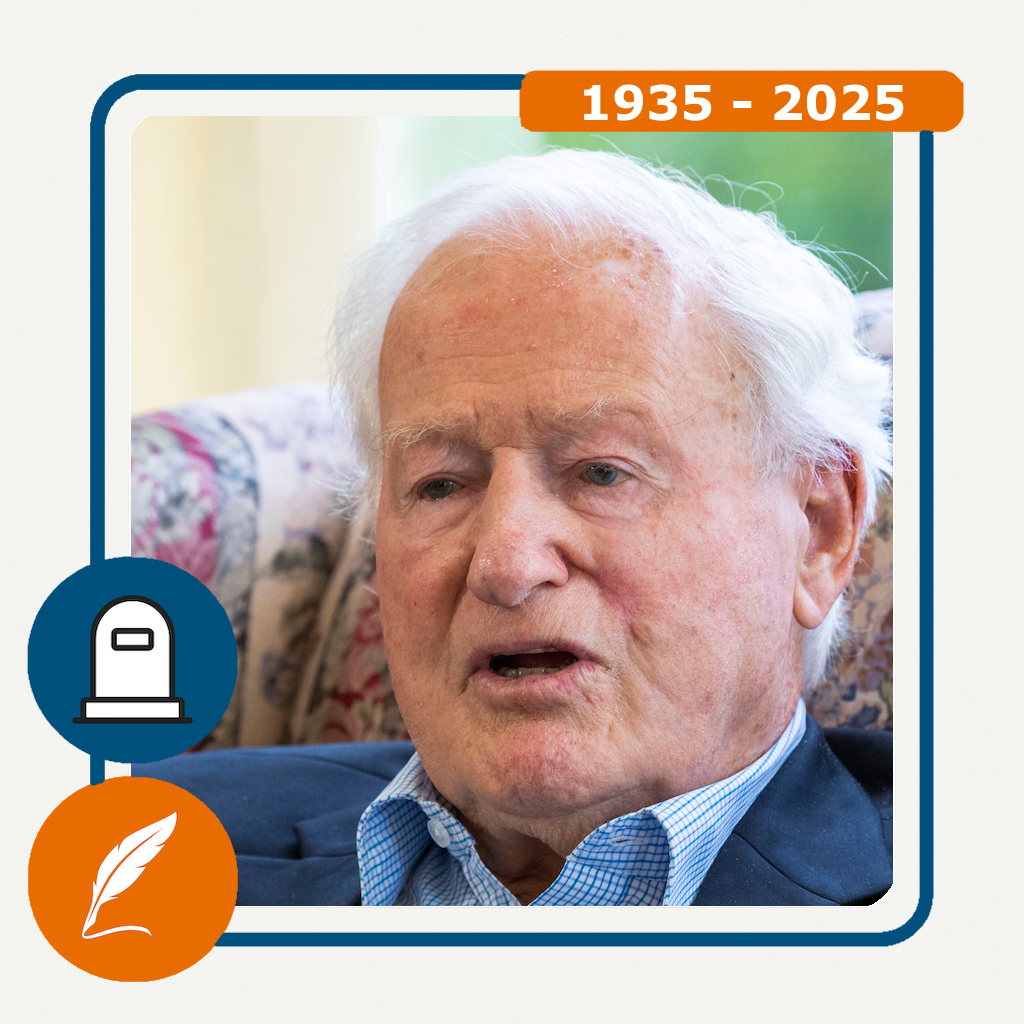HISTOIRE D UN JOUR - 20 JUILLET 1974
HISTOIRE D UN JOUR - 20 JUILLET 1974
L’île fragmentée, Chypre à l’épreuve de l’histoire

20 juillet 1974. En cette journée brûlante de l’été méditerranéen, l’histoire de Chypre s’apprête à basculer une nouvelle fois. À l’aube, sur les plages du nord de l’île, résonne le fracas des barges de débarquement et le grondement sourd des blindés : la Turquie, invoquant la protection de la communauté chypriote turque, lance l’opération militaire baptisée “Attila”. La décision d’Ankara, mûrie dans les semaines d’une crise internationale aiguë, plonge Chypre dans une réalité dont elle ne se relèvera pas : la partition durable de son territoire, cristallisée sur la ligne verte qui coupe Nicosie en deux, fait désormais entrer l’île dans une ère nouvelle, lourde de conséquences pour la Méditerranée orientale, l’Europe et au-delà.
Pour comprendre l’irruption de la violence armée ce 20 juillet, il faut d’abord revenir sur les profondes fractures historiques et identitaires de Chypre, cette île au carrefour des mondes grec et turc. Depuis la fin de la domination ottomane au XIXe siècle et l’intégration de Chypre à l’Empire britannique, l’île n’a jamais connu de paix véritablement durable. Les tensions entre les deux principales communautés, les Chypriotes grecs et turcs, se sont exacerbées dans la première moitié du XXe siècle. L’énosis — le rêve d’un rattachement à la Grèce — anime une large partie de la population chypriote grecque, tandis que la minorité chypriote turque s’inquiète pour sa sécurité et son identité.
Après la Seconde Guerre mondiale, la revendication de l’énosis se fait plus pressante. La Grande-Bretagne, soucieuse de ses intérêts stratégiques, refuse l’indépendance et le rattachement à la Grèce. En 1955, l’EOKA, une organisation nationaliste chypriote grecque, déclenche une insurrection contre la présence britannique, plongeant l’île dans une spirale de violence. Les accords de Zurich et de Londres de 1959 mettent fin à la tutelle britannique et aboutissent à la proclamation de la République de Chypre en 1960, un État indépendant, mais fragile, bâti sur un équilibre institutionnel précaire entre les deux communautés.
La nouvelle République, placée sous la garantie conjointe du Royaume-Uni, de la Grèce et de la Turquie, n’échappe pas à la logique des affrontements. Très vite, le partage du pouvoir tourne à l’avantage de la majorité grecque, provoquant la marginalisation progressive de la minorité turque. Des violences intercommunautaires éclatent dès 1963, obligeant les Nations unies à déployer une force de maintien de la paix (UNFICYP) qui s’enracine durablement sur le territoire chypriote.
Au fil des années 1960 et du début des années 1970, la crise s’enlise. La société chypriote reste divisée, la confiance absente, la cohabitation minée par la peur et les souvenirs sanglants. Dans ce contexte fragile, la Grèce connaît elle-même de profonds bouleversements. En 1967, la prise du pouvoir par la junte des colonels à Athènes accentue la pression sur Chypre, où l’archevêque Makarios III, président de la République, tente de préserver l’équilibre sans céder à l’extrémisme.
Tout bascule le 15 juillet 1974. Un coup d’État, organisé par la garde nationale chypriote avec le soutien direct de la junte grecque, renverse Makarios et installe au pouvoir Nikos Sampson, partisan déclaré de l’énosis. Pour Ankara, l’option militaire se dessine comme une réponse à la perspective d’une unification de Chypre à la Grèce, qui menacerait la minorité turque. La Turquie invoque alors les droits que lui confèrent les accords de garantie de 1960 et prépare, dans l’urgence, une intervention militaire.
Le 20 juillet à l’aube, l’opération “Attila” débute. Des commandos turcs parachutés près de Kyrenia, bientôt suivis par des chars et des troupes débarquées sur les plages du nord. L’armée chypriote grecque et la garde nationale, mal préparées, opposent une résistance désorganisée. Les combats se concentrent autour de Kyrenia et sur la route de Nicosie. Pendant trois jours, la progression turque bouleverse l’équilibre militaire, tandis que la population civile, prise de panique, fuit les zones de combat. Les Nations unies et les grandes puissances appellent à un cessez-le-feu, obtenu le 23 juillet, mais la situation reste explosive.
Pourtant, le débarquement du 20 juillet ne signe pas la fin de l’opération turque. Profitant de la vacance politique à Athènes — la chute de la junte grecque le 23 juillet réinstalle un gouvernement civil — Ankara relance l’offensive le 14 août. En quelques jours, l’armée turque occupe environ 37 % du territoire chypriote, dont la région de Famagouste et Morphou. Ce second acte de l’opération Attila enterre toute perspective de retour au statu quo ante.
La conséquence la plus visible de cette intervention demeure la partition de Chypre. Plus de 200 000 Chypriotes grecs sont contraints de fuir le nord, tandis que 40 000 Chypriotes turcs se regroupent au sein des territoires occupés. La “ligne verte”, surveillée par l’ONU, sépare désormais l’île en deux entités. Nicosie, la capitale, incarne tragiquement cette division avec son centre-ville coupé par des murs, des barbelés et des miradors. La République turque de Chypre du Nord est proclamée unilatéralement en 1983, mais n’est reconnue que par la Turquie. Au sud, la République de Chypre survit tant bien que mal, intégrant l’Union européenne en 2004 mais restant confrontée à la permanence de la division.
L’impact régional et international de l’événement du 20 juillet 1974 s’inscrit dans la durée. La crise chypriote devient l’un des points chauds de la Guerre froide, attisant les rivalités entre la Grèce et la Turquie, deux membres de l’OTAN. La présence durable de l’armée turque sur l’île nourrit l’incompréhension et la colère dans le monde grec, tandis que la population chypriote turque, marginalisée et isolée diplomatiquement, se voit contrainte à l’autosuffisance. Les pourparlers de paix se succèdent sans aboutir à une réunification.
Au fil des décennies, la partition de Chypre façonne la géographie humaine et urbaine de l’île. Les villages abandonnés du nord, les maisons murées, les églises et mosquées désertées, témoignent de la violence du déplacement des populations. Les familles séparées, les récits de la fuite ou de l’exil, nourrissent une mémoire douloureuse, encore vive aujourd’hui.
Le débarquement turc du 20 juillet 1974 a non seulement transformé la carte politique et démographique de Chypre, mais il a aussi marqué un tournant dans l’histoire de la Méditerranée orientale. L’île, prise entre les logiques d’affrontement nationaliste et les intérêts stratégiques des puissances extérieures, demeure à l’épreuve d’une réunification qui se fait attendre. La “question chypriote” survit dans les négociations diplomatiques, dans le travail des commissions de réconciliation, dans la vie quotidienne de deux peuples séparés par des frontières visibles et invisibles. Plus de cinquante ans après l’été 1974, la fracture persiste, rappelant à chaque génération les conséquences d’une histoire dont la page, à ce jour, n’a pas encore été tournée.